|
Hommage Guy Goffette
(1947-2024)
|
|
 |
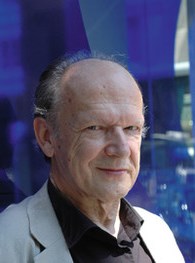
Catherine Hélie © Éditions Gallimard |
|
Guy Goffette est un trouvère des temps
modernes, jonglant avec les mots avec toute la magie de la poésie.
Accords subtils, jubilation des images du quotidien comme tremplin vers
d’autres horizons, c’est dans le mouvement, intérieur et extérieur, que
sa poésie se construit pour mieux se déplacer en d’autres lieux. Guy
Goffette nourrit l’art d’une poésie communicative qui à sa seule écoute
ou lecture donne naissance à des réseaux insondables auxquels succèdent
sans limite de nouveaux tableaux. Art subtil du mot, mais surtout poésie
polyphonique dont chaque voix trouve un écho en notre for intérieur.
C’est une des nombreuses qualités d’un des plus grands poètes
contemporains que notre revue a eu l’immense plaisir de rencontrer !
(interview Paris, 04 août 2019).

 a
Lorraine belge, votre pays natal, semble avoir une influence durable sur
votre poésie… a
Lorraine belge, votre pays natal, semble avoir une influence durable sur
votre poésie…
Guy Goffette : "Plus
que la Lorraine belge, la campagne. Plus que la campagne, l’enfance. Ou,
pour le dire autrement, mon enfance un milieu des prés et des bois dans
cette partie de la Lorraine française jetée en 1848 dans les bras de la
jeune Belgique. Une enfance singulière, frontalière, buissonnière. Ayant
passé dans cette région plus de la moitié de ma vie, on comprendra que
je lui reste attachée".
Vous êtes souvent sur le fil
des frontières, en équilibre, toujours en mouvement, vous n’aimez pas
être enfermé !
Guy Goffette : "J’ai
toujours vécu dehors. Je ne m’enferme que pour écrire".
Sans être un poète naturaliste
pour autant, les éléments de la nature et les lieux trouvent une place
privilégiée dans votre poésie telle la colline, le paysage… qui touche
le lecteur par les nombreuses images qu’ils font naître.
Guy Goffette : "La
Nature a été mon premier livre de lecture, un livre immense et
inépuisable, sensible, sonore et superbement coloré. À la maison, il n’y
avait pas de livre, mais au-dehors quelle bibliothèque, toujours ouverte
pour celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C’est
là que ma poésie a trouvé ses couleurs et ses rythmes".
 
Votre poésie se rapproche
également de la musique (très perceptible d’ailleurs lorsque vous lisez
vos propres poèmes en public) et semble nourrie des couleurs de la
peinture, comment percevez-vous ces deux arts ?
Guy Goffette : "Comme
essentiels l’un et l’autre pour moi. Le goût des couleurs, c’est le
monde autour de moi qui me l’a donné, toute cette beauté champêtre
variant selon les saisons. Il faut croire que j’étais doué pour la
recevoir, la ressentir et l’exprimer par le dessin et, plus tard, par la
poésie. Pour ce qui est de la musique, les chansons de l’école et de la
rue, les airs de mon père, les berceuses de ma mère et la musique de la
radio m’ont tourné progressivement vers ce qu’on appelle aujourd’hui la
world music et en particulier le fado, le blues et tout un corpus de
chants populaires à dominante mélancolique. C’est la même dominante que
j’ai cherchée dans la musique dite classique. Je précise que pour moi
Il n’y a pas de petite musique, comme je l’ai écrit quelque part
sous ce titre". |
Jacques Borel dans une préface à l’un de
vos recueils (Éloge pour une cuisine de province) parle d’une
poétique de la simplicité, comment comprendre cette image chère
également à Claudel ? Vous ne semblez guère goûter la sophistication
pour la sophistication, n’est-ce pas ?
Guy Goffette : "C’est
vrai, je n’aime pas ce qui est sophistiqué. J’emploie les mots de
tous les jours, comme dit Claudel, ceux que tout le monde emploie et
comprend. Les mots simples, c’est-à-dire naturels, plutôt que familiers,
qui me chantent et m’enchantent par leur sonorité et leur couleur. Ma
poétique s’apparente donc d’une certaine manière à la composition d’un
bouquet de simples".
Vos illustres prédécesseurs ont également
une part importante dans votre poésie, vous n’hésitez pas à leur rendre
hommage tel Verlaine, Auden, Claudel, Jammes…
Guy Goffette : "On
subit naturellement, à des degrés divers, l’influence des poètes qu’on a
beaucoup fréquentés et admirés. Et je n’ai jamais manqué de leur rendre
hommage par ce que j’appelle des « dilectures », néologisme formé sur
dilection et prédilection".
 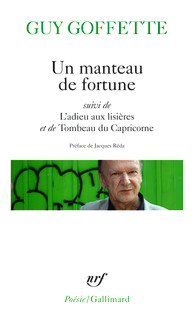
Vous avez également consacré
votre écriture à des romans tels « Un été autour du cou » et «
Géronimo a mal au dos » où votre biographie s’immisce. Comment
situez-vous cette forme d’écriture comparée à votre poésie ? Avez-vous
l’impression d’être une tout autre personne en prenant cette plume de
romancier ou de poète ou au contraire se rejoignent-elles ?
Guy Goffette : "La
conception que j’ai de la poésie rejoint celle de Henri Michaux qui
disait que le seul fait de se mettre à table pour écrire un poème
suffit à le tuer. J’attends donc que les « muses », si je puis
encore utiliser ce terme, me visitent ; que la poésie m’attrape par la
langue, comme on attrape un ami par le cou; bref, que le premier vers me
saute à l’esprit, qu’il me soit donné. L’attente peut durer
longtemps, créer ce que j’appelle un désert poétique. C’est lui
que je comble en écrivant des textes en prose, romans ou biographie du
genre Verlaine d’ardoise et de pluie. La langue n’y est pas
traitée de la même façon que dans le poème. Pour distinguer l’écriture
poétique de l’écriture romanesque, je dirai que la poésie m’écrit, me
traverse, me surprend tandis que c’est moi qui écris, compose, traverse
le roman. En dire plus nous entraînerait trop loin".
 
Vous vous présentez souvent comme un
poète vitaliste, peu enclin au passé et encore moins aux supputations
sur l’avenir, mais la gravité peut poindre dans certains de vos vers ou
de vos romans. Quel rapport entretenez-vous avec le tragique et votre
part d’ombre ? La poésie peut-elle être un remède sur ce qui voile la
vie ?
Guy Goffette : "C’est
notre existence qui est tragique : nous naissons pour mourir. En être
conscient est source de souffrance. D’où notre part d’ombre. Être
vitaliste signifie pour moi aimer la vie, la respecter du début à la
fin, à la fin de l’existence, je veux dire. Car la vie pour moi n’a pas
de fin, elle est le souffle qui permet à l’homme d’exister. Quand le
souffle se retire, le vivant meurt, mais la vie continue, nourrie de
tout ce que l’homme lui a donné. C’est ce que je crois.
Que la poésie aide à vivre, qu’elle puisse consoler et réjouir le cœur
et l’âme, comme la musique et tous les arts, c’est certain. C’est dans
ce sens-là, à mon avis, qu’on peut dire qu’elle est un remède".
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
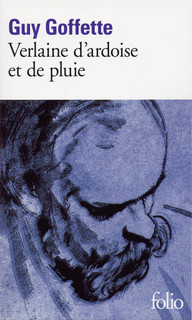  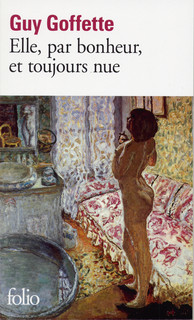 |
|
Interview Emmanuel Godo
31/05/23
|
|

Poète et essayiste de talent, Emmanuel Godo
nous invite à aller à contre-courant de notre société du simulacre en
redécouvrant la beauté de l'aujourd'hui, une espérance du quotidien qui
élève notre regard vers les réalités d'en haut... Rencontre avec le poète
à l'occasion de la parution de son dernier recueil "les Egarées de Noël"
aux éditions Gallimard.
Comment avez-vous découvert la poésie ?
Emmanuel Godo :
"La poésie est venue me chercher durant les nuits de mon enfance. Des vers
apparaissaient, qui me bouleversaient. L’entrée de la poésie dans
ma vie se fait sur ce mode étrange – nocturne et visuel. Je vois des mots,
des paroles, qui me font, tout en dormant, connaître une joie
inimaginable. Un monde se révèle, dont le lendemain matin, revenu à l’état
de veille, j’essaie, maladroitement, de consigner dans des carnets, les
fragments entraperçus qui, sitôt écrits, deviennent décevants, comme si le
charme de la nuit était irrémédiablement perdu. J’ai une douzaine
d’années. C’est ma première expérience d’écriture, entre enchantement et
sentiment d’impossibilité. Élection vague et ratage chronique.
Après mes essais, brouillons, de l’adolescence, la poésie ne déserte pas
ma vie : elle l’irrigue, mais à la façon d’une rivière souterraine.
J’écris des textes qui se retrouvent dans ce que j’ai appelé, dans Je
n’ai jamais voyagé (Gallimard, 2018), le « Sac à poèmes », un sac de
cuir où ils s’amassent. Ma poésie est alors protégée par une forme de
paresse – elle n’était sans doute pas prête à affronter le jour. Pour des
raisons qui ne relèvent pas seulement de l’intime ou du personnel, mais
d’une blessure qui est celle de mon siècle, ma parole a dû puiser des
forces dans le silence et l’inaccompli. Il a fallu qu’elle cultive ses
devoirs et ses pauvretés, qu’elle s’arme et se désarme, pour pouvoir
jaillir avec l’exigence nécessaire en 2018.
Nous sommes abreuvés par la mauvaise langue, défigurés par les choix
déshumanisants de la collectivité : pour répondre à la guerre que l’homme
fait à l’homme, il faut que le poème s’affirme dans toute sa puissance. La
question du temps devient secondaire, comme celle de la publication.
J’aurais pu être un écrivain posthume. Je le suis, à bien des égards. Le
poète vient nécessairement à contretemps dans un monde qui ne croit pas à
la poésie : qui, même lorsqu’il feint de la célébrer, la méprise au plus
haut point, comme il fait la chasse à toute véritable intériorité. Nous
vivons dans un monde massifié qui a fait le vœu d’asservir les esprits, en
les vidant de leur substance.
Le poème, avec la prière, le silence intérieur, l’amour du beau, constitue
une des dernières aventures authentiquement humaines. On est alors très
au-delà de « l’envie » : c’est une nécessité vitale. Pas seulement au plan
individuel mais comme responsabilité vis-à-vis de soi et de ses semblables
: la vie n’est pas ce simulacre qu’on en fait, cette fête triste qui ne
nous demanderait de fonctionner qu’à bas régime. La poésie est comme une
insurrection qui sollicite les parties les plus nobles de notre
être. Celles qui nous permettent, littéralement, d’accomplir notre
destinée d’homme.
La poésie nous ramène à la nécessité de faire croître nos vies en les
exposant à la vertu d’un haut langage".
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le titre retenu de votre
dernier recueil « Les Egarées de Noël » et ces étoiles dorées qui leur
sont associées ?
Emmanuel Godo :
" Le titre du recueil fait entendre une contradiction où se croisent les
deux lignes de notre destin contemporain : un égarement, une
désorientation qui peut nous conduire, collectivement, à un anéantissement
déjà largement engagé ; une fidélité, une mémoire, le vestige d’une
célébration de la splendeur de l’être, d’un possible salut. Le poème « À
quel feu allumeras-tu tes mots ce matin ? » raconte que les « égarées de
Noël » sont les étoiles dont on décore la table de la fête. On en retrouve
tout au long de l’année, sous les meubles, au détour d’un ménage. Elles
deviennent l’emblème de notre condition. Nous sommes perdus, pris dans une
machinerie mortifère, mais nous sommes aussi comme ces assoiffés qui
meurent de soif auprès de la fontaine. Car les livres qui brisent la glace
en nous, selon le mot de Kafka, existent, comme les fragments, épars, du
Royaume. Il suffit de peu de choses pour que nous puissions retrouver le
bon rythme, l’accord, la décence, le visage fraternel.
Le recueil est dédié aux « ouvriers de l’espérance » car les poètes sont,
avec les hommes de foi, les philosophes, les artisans de longue haleine,
les derniers veilleurs qui nous restent. Ils sont loin du théâtre obscène,
de l’égout à ciel ouvert de l’information en continu, le flux d’images, de
discours où il est impossible d’enraciner un acte et une parole
véritables.
Chacun des poèmes est, à sa manière, comme une égarée de Noël : il vient
dans la nuit où nous sommes scintiller un instant pour nous rappeler que
le bon feu existe. Il ne tait rien de notre misère – sinon il serait une
faute, il voilerait notre malheur, il s’inventerait un pouvoir qu’il n’a
pas. Comme ces enthousiastes patentés qui viennent proclamer la bouche en
fleur que la beauté ou la poésie sauveront le monde, comme si le mal dont
nous souffrons après le cataclysme du XXe siècle était soluble à coup de
chansonnettes et de placebos. L’encre de la poésie contemporaine est d’un
noir de basalte absolu : c’est à cette condition que son chant peut
s’élever au-dessus des ruines que nous avons trop vite recouvertes des
couleurs de la fête.
Le poème est l’anti-divertissement par excellence : il nous reconduit à
l’endroit où nous sommes les plus blessés – donc potentiellement les plus
vivants. Ce que le roman ne sait plus faire, sauf exception. Le poème nous
ramène là où nous avons tout à reconstruire – et d’abord nous-mêmes. Ne
surtout pas être « comme tous ces hommes / Qui n’ont jamais su / Demander
à un poème / Leur chemin » (« Tu passes tes nuits à penser »).
Votre recueil s’inscrit résolument dans notre quotidien et, en
contrepoint, l’idée surgit d’un ailleurs d’où rayonne la transcendance.
Emmanuel Godo :
" Le quai de la gare, la rue, le métro, la ville sont les lieux où, pour
l’essentiel, je vis. La poésie est d’abord un ici. Un ancrage dans
la contingence du tableau, parisien ou autre. C’est là que les grandes
questions viennent nous fouailler, nous saisir dans l’indépassable de
notre lieu. Nous sommes assignés à ces espaces-là. Et la poésie a à rendre
compte de cette vérité. Elle ne vient pas faire miroiter des ailleurs.
Elle nous prend où nous sommes, dans ce que j’appelle, dans le poème
liminaire du recueil, la « maison dévastée-merveilleuse ». J’entends
l’épithète comme un seul adjectif, qualifiant exactement où nous sommes,
dans la tension entre les postulations contraires : nous habitons
l’intenable, le déchiré. |
Le poème obéit, chez moi, à une dramaturgie qui prend en écharpe ces deux
aspects contradictoires de l’existence dans l’aujourd’hui blessé : d’une
part, la désolation, la claire conscience de vivre dans le toc, le
low-cost, le simulacre inepte ; de l’autre, la possibilité de l’épiphanie,
le rappel des oiseaux, le déplacement du regard qui nous reconduit vers
une terre habitable à nos pensées les plus hautes.
La poésie n’a rien à gagner à promettre plus qu’elle ne peut tenir : elle
part toujours d’où nous sommes. Et tente une percée : nous ne sommes pas
ces servitudes épuisées, il reste, en nous, de quoi refaire un monde
hospitalier et juste. La promesse, c’est nous. Le poème travaille à nous
raccorder à cette conscience oubliée. Lui aussi nous rabaisse quand nos
orgueils inconsidérés nous élèvent de façon mensongère et nous relève
quand le Barnum social nous étrique et nous rançonne.
« Nos vies sont des poèmes et nous le voyons pas » : ce vers qui ouvre
l’un des poèmes de la dernière section pourrait servir d’aiguillon – comme
une poétique portative – à ma poésie".
Vous partagez avec Claudel une pensée en
lutte tout autant qu’une insatiable espérance.
Emmanuel Godo :
" Oui, j’aime quand Claudel nous dit que Dieu est l’hôte qui ne nous
laisse pas en repos. Vous avez raison, Claudel est l’un des plus grands
lutteurs de notre littérature. Il a joué un rôle considérable dans ma vie,
d’homme et de poète. Il y a un aspect extraordinairement libérateur chez
Claudel. Lorsqu’il rappelle que les mots du poète sont ceux de tous les
jours, mais entendus autrement. Ou lorsqu’il traduit la formule latine :
quantum potes, tantum aude, par « vite fait, mal fait ». N’empêche
pas la musique de passer par toi. N’aie pas peur de la mort, ce n’est pas
un gouffre vide, mais un grand ciel étoilé, une prairie. Claudel c’est
l’homme qui tord le cou aux chimères qui nous cadenassent, il nous propose
d’envoyer une brique sur les bulles de savon que produit notre esprit pour
mieux végéter paresseusement dans le néant ou dans ses antichambres.
J’aime cela car, oui, il y a un confort du désespoir, une facilité du
désenchantement : on peut être un rentier de la perte, un fonctionnaire du
négatif. Rien de plus contraire à la promesse que d’écouter les voix, en
nous et hors de nous, qui nous répètent à l’envi : « C’est trop tard, il
n’y a plus rien à tenter ». Dans le désert ou dans le chaos de l’Histoire,
il y a ces esprits qui se dressent, comme Dante, Péguy ou Claudel, pour
nous rappeler que le chemin existe et qu’il se nomme espérance.
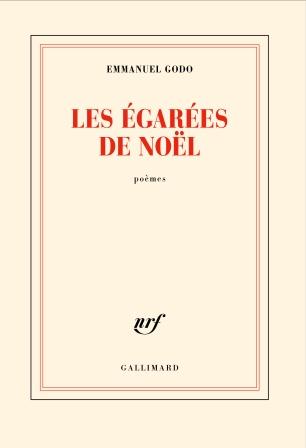
Notre présent est si mal en point que nous ne pouvons négliger aucune voix
pour reconstituer une parole digne de ce nom. Je rends hommage, dans
Les Égarées de Noël, à Yves Bonnefoy, qui a beaucoup compté dans mon
acheminement à la poésie. Les gardiens vétilleux des chapelles aiment
ériger des frontières infranchissables là où l’écriture obéit à un
principe de perméabilité, qui est sa liberté suprême. On rappelle souvent
que Bonnefoy situe la poésie, résolument, « après les dieux ». Ce qui
semble renvoyer le poète chrétien à une sorte d’archaïsme. Or ma poésie a
besoin de Bonnefoy pour penser le poignant de la présence, de la vie
exposée à la mort : le Verbe fait chair n’est pas une assurance tous
risques, c’est même exactement le contraire !
L’espérance n’est pas un baume qu’on glisse sur la morsure du vivre. Elle
est l’horizon qui aimante la vie et la destine. Dans son mouvement propre,
tout poème est aiguillonné par le principe espérance. Écrire, c’est
toujours espérer. Même l’écrivain le plus refermé sur sa négation, à
partir du moment où il écrit, il ouvre, il tente et, même à son corps
défendant, il espère".
Comment percevez-vous personnellement cette voix d’espérance et comment
l’appréhender en notre époque souvent si sombre ? Trouve-t-elle sa
parfaite illustration dans « Prière », poème que vous adressez au terme de
votre recueil ?
Emmanuel Godo :
" La prière que vous mentionnez est un sonnet qui clôt la dernière section
du recueil : « On appellera cela la maison ». Elle est placée sous le
signe de Bach, avec une épigraphe extraite de la Passion selon saint
Jean. Mes deux premiers recueils se terminaient eux aussi par une
prière : « Supplique pour mourir dans un merci » (Je n’ai jamais voyagé)
et « Mon pauvre Dieu je te fais vivre / Dans un bien pauvre cœur / Qui ne
sait plus mendier ta parole » (Puisque la vie est rouge, Gallimard,
2020).
Dans Les Égarées de Noël, j’ai choisi de ne pas clore le recueil
par une prière. Le dernier poème est un moment suspendu – comme une coda
en forme de prélude :
« Le jardin ne dort pas
Les fleurs regardent la nuit
Les oiseaux ronronnent
Sur le toit de la maison
Le silence tend son arc
J’écoute le poème
S’écrire doucement
À qui appartient-il ? »
Nous ne sommes pas « loin » de la prière, une nouvelle fois, mais il n’y a
pas toujours besoin de nommer le destinataire ultime de ce que nous
écrivons. La page blanche, seul le poète peut en éprouver pleinement le
tragique. Il n’a le support d’aucun personnage, d’aucun récit, d’aucune
action, d’aucun propos. Il est dans le nu de la vie. Avec tout à
réinventer. C’est le premier homme qui regarde le ciel et découvre, en
lui, un reflet de l’infini, comme une plaie, heureuse-malheureuse, au sein
de sa finitude.
Pour répondre plus directement à votre question, l’époque où nous vivons
nous fait la guerre en nous expropriant de nos terres intérieures. Elle le
fait par tous les moyens dont elle dispose : d’un côté un grand discours
catastrophiste (qui revient à dire : vous n’êtes plus le nom d’une
aventure spirituelle hors du commun mais un problème à résoudre), de
l’autre un grand discours infantilisant (qui revient à dire : amusez-vous,
arrêtez de vous faire du tort, gorgez-vous de virtualité, ne vivez surtout
pas pour de bon, le jeu de toute façon n’en vaut plus la
chandelle). Deux manières de nous divertir, au sens pascalien, de nous
excentrer, de nous priver de notre point de gravité, c’est-à-dire de la
conscience que nous sommes quelque chose d’invendable et de proprement
inguérissable – des âmes.
Il nous faut beaucoup lutter, nous donner à nous-mêmes de grandes
disciplines, et un aliment de haute exigence, pour garder une chance de ne
pas passer à côté de notre vie dans l’esprit. La poésie, quand elle se
préserve des défigurations qui la rongent, est là pour nous y aider".
propos recueillis par Philippe-Emmanuel
Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite |
| |
|
Hommage Philippe Sollers
(1936-2023) |
|
Interview Philippe Sollers
Lettres à Dominique Rolin 1958-1980
Paris – Gallimard, 04 décembre 2017. |
|

©
F. Mantovani |
|
Philippe Sollers épistolier, c'est avant tout un cœur, une âme au
diapason de la beauté du
monde, et une femme, Dominique Rolin, avec laquelle il communie aux
valeurs qui les réunissent. Philippe Sollers, c'est bien entendu une plume
qui déjà appréhende le monde avec l'habileté d'un escrimeur, la souplesse
du bambou et la fluidité d'une encre... de Chine. Les paysages, les
"situations" défilent sous nos yeux au rythme d'une actualité filtrée par
ces deux voix qui crient parfois dans le désert de leurs contemporains.
Rencontre à l'occasion de la publication des Lettres à Dominique Rolin
avec l'écrivain dans son petit bureau des éditions Gallimard !
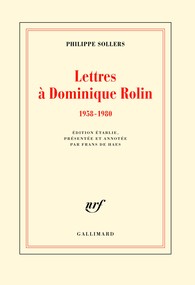
 os
lettres à Dominique Rolin s’inscrivent dans l’art de correspondre, un art
qui suppose une harmonie – en l’occurrence amoureuse - et un média, la
lettre. Comment vous est venue cette attraction pour le genre épistolaire
? os
lettres à Dominique Rolin s’inscrivent dans l’art de correspondre, un art
qui suppose une harmonie – en l’occurrence amoureuse - et un média, la
lettre. Comment vous est venue cette attraction pour le genre épistolaire
?
Philippe Sollers :
« Il faut situer les choses de façon
précise. Quand je rencontre Dominique Rolin, nous avons immédiatement une
relation amoureuse qui se traduit par un grand nombre de conversations.
Aussi, lorsque nous sommes séparés, la lettre surgit, bien plus que le
téléphone auquel nous aurons recours également très souvent. C’est un acte
nécessaire, acte qui ne correspond pas à une correspondance suivie par
laquelle on se donnerait des nouvelles, mais renvoie à ce que chacun fait
de son côté fondamentalement, à savoir le livre qui est en cours tant pour
elle que pour moi. C’est la singularité, je crois, de cette correspondance
dans laquelle les épistoliers ne se répondent pas, mais traitent de ce qui
est en train de les préoccuper le plus. Pour correspondre, c’est très
facile, on peut parler, on peut se téléphoner, etc. Là, c’est autre chose.
Il faut prévenir tout de suite qu’il s’agit là d’une correspondance de
deux écrivains qui sont tout à fait impliqués dans leur art, non seulement
de vivre, mais également d’écrire. C’est très visible parce que vous
n’avez pas de lettres de Venise puisque nous y sommes ensemble, printemps
et automne, pendant quarante ans. En revanche, vous avez des lettres de
l’été lorsque je suis à l’île de Ré, ou de Dominique lorsqu’elle se trouve
en vacances chez Florence Gould à Juan-les-Pins. Il est curieux de lire
une correspondance qui n’est pas faite pour répondre à l’autre sur des
sujets divers, encore que l’actualité rentre à flots dans mes lettres
parce que Dominique me sollicite sur le changement de régime en 1958, sur
la guerre d’Algérie, puis la Chine, etc. Vous avez là un document, je
crois, tout à fait exceptionnel sur la façon dont on peut s’écrire sans
avoir une conversation, mais une preuve de fond sur ce que l’on est en
train de faire et de vivre. J’entends dire souvent : « Pourquoi ne pas
avoir mis les lettres de Dominique Rolin dans le même volume ? », telle la
correspondance entre Camus et Maria Casarès. Je trouve que c’est un gros
livre tout à fait étouffant dans lequel on ne voit pas se dégager la
personnalité des sujets. Il m’a semblé plus intéressant de publier nos
lettres séparément, car elles ont été écrites avec la quasi-certitude
qu’elles seraient lues de manière intense, particulièrement intense par la
personne qui va recevoir le courrier. J’ai à cette époque vingt-deux ans,
elle, quarante-cinq, même si elle en paraît dix de moins.

Si vous prenez cette photo où
Dominique est un peu plus jeune que lorsque je l’ai rencontrée, vous
constaterez que cette image parle beaucoup dans la mesure où vous voyez
apparaître quelqu’un d’absolument réfractaire et sauvage avec un côté
gitane. Il faut bien comprendre que Dominique Rolin est d’origine
polonaise juive, et qu’un long parcours l’amènera vers la Hollande, puis
la Belgique ; c’est d’ailleurs l’Académie royale de Belgique qui a acheté
cette correspondance ».
Il apparaît manifeste à la
lecture de vos échanges avec Dominique Rolin que non seulement une
complicité vous unit sur bien des domaines, mais qu’en plus un plan – «
axiome » dites-vous - vous engage plus encore.
Philippe Sollers :
« Ce mot est en effet important car axiome revient à organiser la vie,
sentimentale, physique et métaphysique selon des lois mathématiques
auxquelles on ne peut pas se soustraire quels que soient les aléas et les
circonstances de l’existence, et il y en a eu beaucoup. L’action ! »
C’est ce qui a guidé très tôt vos
échanges…
Philippe Sollers :
« Absolument, c’est très important parce
que c’est à chaque fois le fait d’aller vers un but qui est tout
simplement une œuvre, pour elle, et pour moi. »
Vos lettres naissent souvent de
l’absence de l’un de vous deux. Cet éloignement était-il réduit par votre
correspondance ?
Philippe Sollers :
« Rapprochement par l’éloignement ! Les
lettres sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus fiévreuses que les
conversations ou les rencontres quasi quotidiennes. Que faisions-nous
lorsque nous nous rencontrions ou dînions ensemble rue de Verneuil ou « Le
Veineux » comme nous nommions ce lieu ? Avant tout, un très grand silence.
La preuve même d’avoir atteint quelque chose résidait dans le fait que
nous écoutions systématiquement de la musique ensemble. Si vous voulez
savoir si vous vous entendez avec quelqu’un, il suffit de mettre de la
musique et de voir si l’écoute est systématiquement parallèle ! J’espère
aussi que l’on pourra reproduire certains des dessins de Dominique dans
son volume de correspondance car elle était une merveilleuse dessinatrice.
Elle voyait la peinture avec une acuité particulière, ce que je ne
manquais pas de remarquer lorsqu’elle m’envoyait des cartes postales
reproduisant des œuvres d’art qu’elle me commentait. Elle voit mieux que
moi et j’entends mieux qu’elle. Ensemble, c’est la peinture et la musique
avec la littérature en commun de toutes les façons possibles. Je crois lui
avoir fait découvrir tout le continent musical, et chaque fois que nous
étions en face de tableaux, c’est elle qui voyait le plus précisément
possible. Je me souviens par exemple d’une grande rétrospective Poussin
que nous avons vue ensemble et j’étais complètement ébloui par ce qu’elle
voyait ! Mais j’entendais un peu plus qu’elle ! (rires…)
Les lieux ont, semble-t-il, toute
leur importance dans cette correspondance…
Philippe Sollers :
« Il y a une expression que j’aime beaucoup
qui s’appelle le génie du lieu, et il y a dans l’île de Ré, un lieu
tout à fait exceptionnel que je dois à un ancêtre navigateur qui a voulu
se poser là parce qu’il laissait son bateau pour la pêche et pour le tir
au canard devant les marais salants… |
Les marais, premier livre de
Dominique qu’elle m’envoie, et pour lequel, je lui réponds être un peu
embêté de l’admirer, nous sommes fin décembre 58 et février de l’année
suivante, je lui écris : « Dominique chérie ! » (rires)… Le type est en
effet passé à l’action assez vite, j’ai vingt-deux ans, je sais un peu
écrire avec une reconnaissance de Mauriac, Aragon, etc. L’autre livre de
Dominique s’appelle Artémis, cette déesse grecque que les Latins
ont transformée en Diane, une déesse extrêmement redoutable et très rapide
dans ses interventions dont le lieu préféré est précisément la zone des
marais.
Vous voyez qu’immédiatement quelque chose fonctionne en mythologie comme
en relation personnelle. Paris est également important, mais là, on ne
s’écrit pas, c’est vécu. L’autre génie du lieu qui va être vécu de manière
très intense pendant des années, c’est Venise. C’est non seulement le
lieu, mais également la formule, le lieu et la formule appartient à
Rimbaud et est parfaitement adapté à l’illumination très précise. Ce qui
m’a frappé en relisant ces lettres est qu’il y a tout le temps de ma part
une situation où la nature prend une dimension très importante : le temps
qu’il fait, la nature, la végétation, les fleurs… La nature est divine
comme l’a dit Spinoza à qui cela a d’ailleurs posé pas mal d’ennuis !
(Rires)
Le lieu, c’est aussi la nature. C’est ainsi que le chinois est apparu très
tôt dans ma vie, je suis vraiment un admirateur inconditionnel de la
poésie et de la peinture chinoise.

Crédit : art press 266, mars 2001
Si vous regardez cette calligraphie (Philippe Sollers pointe du doigt
une calligraphie chinoise accrochée sur le mur de son bureau), vous «
voyez » le geste immédiat et tout à fait fondamental avec le souffle, le
poignet… Je deviens chinois assez vite et j’ai réalisé qu’il fallait
apprendre un peu la langue si l’on voulait comprendre ce que les jésuites
ont compris tel le peintre Giuseppe Castiglione et Matteo Ricci. Ils ont
malheureusement été stoppés après par Rome. Cela a été une occasion
unique, et vous voyez le temps qu’il a fallu par la suite pour redécouvrir
toute cette richesse. Quand j’ai ouvert un jour mes volets à l’île de Ré,
j’ai cru avoir une hallucination. Je voyais au loin des formes auprès des
marais, c’était des Chinois qui venaient se renseigner sur la manière de
recueillir la fleur de sel ! Un peu après, j’apprends qu’ils sont à
Bordeaux et qu’ils achètent tous les châteaux, c’est extraordinaire. La
civilisation chinoise m’a travaillé beaucoup plus profondément que
l’américaine.
L’Histoire de la deuxième partie
du siècle transparaît dans vos échanges épistoliers. Une Histoire qui ne
peut être vécue indépendamment des « passions fixes » qui vous
animent.
Philippe Sollers :
« Je crois en effet que cette
correspondance est une façon de se renseigner autrement sur la deuxième
moitié du XXe siècle. Il y a des correspondances qui paraissent en ce
moment, celle de Nabokov, de Claudel qui est une folie énorme avec
l’histoire peu connue de sa maîtresse en Chine, celle de Camus que je
trouve un peu lourde, mais nos échanges avec Dominique concernent plus
particulièrement la deuxième partie du siècle dernier ; mais, en même
temps, si vous la lisez attentivement, c’est déjà une correspondance qui
se prolonge sur le XXIe siècle comme style d’interrogations, de
profondeur, c’est une autre Histoire. Lorsque l’entente arrive à ce point,
ce qui est rare, c’est un concert ! Il ne s’agit pas d’une aventure - vous
savez que j’ai eu une vie assez agitée comme mes romans le prouvent - mais
une relation qui s’inscrit dans la durée, très impressionnante de ce point
de vue, et ce jusqu’à la mort de Dominique. Une aussi longue durée est
très étrange, et je crois que c’est unique. La différence d’âge est très
importante parce qu’il fallait presque obligatoirement recourir à la
clandestinité, même si je n’arrive pas du tout innocent, j’ai à vingt-deux
ans déjà un peu voyagé dans l’univers féminin. Cette différence d’âge à
l’époque est extraordinairement taboue, vous êtes immédiatement dans la
convocation d’un inceste possible entre mère et fils. Le point de vue est
donc essentiellement clandestin, profondément antisocial, cela est
essentiel, avec cette composante anarchiste de base qui est tout à fait
explicite, j’oserais même dire révolutionnaire d’une certaine façon avec
des jugements très caustiques sur l’actualité.
Vous faites même référence à Guy
Debord
Philippe Sollers :
« Absolument. Debord surgit en 1966 avec
La Société du spectacle, ce qui a été très important. Mais il n’a pas
écrit de roman, ni écrit sous l’angle de la passion amoureuse, ce qui en
fait confère une liberté considérable.
Nourrir une telle correspondance
sur plus de cinquante années impose une discipline certaine. Comment
percevez-vous cette discipline à l’heure des emails, sms et autres
échanges numériques ?
Philippe Sollers :
« Il m’est bien difficile de vous répondre,
c’est l’avenir qui tranchera cette question, la seule à mon avis qui
mérite d’être sondée. Qui sait encore lire aujourd’hui ? Pour savoir lire,
il faut savoir écrire… Nous sommes dans une mutation numérique, et qui est
encore capable de lire pendant un certain temps plus d’un paragraphe ? Mon
épouse, Julia Kristeva, est psychanalyste. Elle m’a dit récemment :
c’est très étrange, j’ai beaucoup de patients qui se plaignent de ne pas
pouvoir mémoriser le paragraphe qu’ils viennent de lire ! Et là, tout
à coup, la « baleine blanche » surgit à l’horizon, je me dis : « c’est
cela le problème, la lésion de la mémorisation, c’est-à-dire la mémoire
qui devient un muscle flasque si elle n’est pas entraînée ». J’ai
d’ailleurs un remède que je ne cesse de rappeler : avoir recours à la
poésie apprise par cœur ! Ouvrons Les Fleurs du Mal de Baudelaire
et apprenons cette poésie « Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus
tranquille. Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici… » ; C’est le
meilleur antidépresseur…
La mémoire, cette humanité mécanique qui est devenue la prothèse de ses
instruments, voilà le sujet de l’avenir historique humain, et je crois que
l’on est confronté aujourd’hui à cette question. On peut vous parler d’un
grand nombre de choses : de la biologisation, de la reproduction, choses
dont je m’occupe également depuis longtemps et qui d’ailleurs
n’intéressent guère de monde. S’il est un livre que j’aurais du mal à
publier aujourd’hui c’est bien Femmes… Lorsque je vois toute cette
mutation fondamentale, pour moi, c’est le vrai sujet, même si l’on vous
amuse avec une pléthore de faits divers. Ce volume de lettres dont nous
parlons n’est pas de la communication, c’est véritablement un texte qui
demande à être lu avec l’intensité avec lequel il est écrit. Il serait
difficile de faire l’équivalent sur un texto ! Nous sommes aujourd’hui
dans une époque réactionnaire alors que ces lettres ont été écrites à une
époque pré et révolutionnaire, parce que 68 va arriver même si l’on ne
parle plus de toutes ces choses… De nos jours, nous sommes dans une
implosion de remises en ordre, ce qui fait que vous avez l’impression
quelquefois de revenir au rigorisme moral du XIXe siècle, ce à quoi je
suis très hostile comme vous pouvez l’imaginer ! Je vous ferai remarquer
qu’avec la vie assez aventureuse que j’ai menée, pour l’instant il n’y a
pas de plaintes contre moi ! (rires)… Il y a là une sorte de choc, une
impression que la guerre entre les sexes date d’avant-hier, alors qu’il
n’en est rien, cela fait des millénaires que cela dure. Et ce n’est pas
fait pour s’arranger de toute façon ! Il faut essayer de décrire cela
parfois avec des pauses, pauses qui s’imposent de temps en temps. C’est un
témoignage sur la pause, pause étrange qui tient au génie du lieu et de
ceux qui savent utiliser l’espace et le temps…".
propos recueillis par Philippe-Emmanuel
Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite
(Philippe Sollers Lettres à Dominique Rolin
(1958-1980)
Édition de Frans De Haes Collection Blanche, Gallimard, 2017) |
|
Lettre n° 48
(avec l'aimable
autorisation de l'auteur, toute reproduction interdite) |
|
48
Bordeaux, Vendredi
(28 décembre 1962).
Amour,
J’aimerais que tu aies un signe de moi en rentrant au Verneuil, mais les
journaux sont pleins, maintenant, de « perturbations affectant les PTT ».
Tant pis : ce mot parmi l’avalanche. La situation, aujourd’hui, est un peu
meilleure. Je crois avoir coupé à la grippe, et je me suis remis au
travail, cet après-midi, avec une sorte de bonne humeur. Les séjours à
Bordeaux ont pour moi leur couleur particulière (très différente de ceux à
Ré, par exemple). Il faut dire que je retrouve très exactement, ici, les
bases mêmes, les dimensions de mes projets d’« adolescent ». C’est à la
fois ancien et proche. Je tâtonnais, il me semble, dans un désespoir plein
d’enthousiasme et de mauvais goût : persuadé d’être appelé à une destinée
hors pair (une parenté naturelle, et sans le moindre humour, avec le «
génie »), conscient d’une déficience et d’une faiblesse – d’un ennui
d’être – représentées parfaitement par une architecture noire et rigide
parmi laquelle j’allais sans rien voir. Le problème le plus grave que je
me suis posé – que je me pose toujours – revient, depuis cette époque, à
celui-ci : comment est-il possible, alors qu’on a logiquement et
concrètement l’expérience du meilleur, la certitude évidente d’une vérité
absolue ; comment est-il possible qu’on en soit malgré tout réduit à
rester dans le décor archi-connu et gâteux du temps ? Bien entendu, une
telle question appelle aussitôt sa réponse – naturelle, claire : c’est que
l’expérience dont on se réclame, la vérité qu’on prétend avoir ne sont
pas, justement, celle qui, etc... Et pourtant... je ne sais s’il existe
beaucoup d’esprits comme le mien, que leur existence irrite par ce qu’elle
a de théâtral et d’obligatoire – d’obligatoire surtout. Le suicide ? J’y
pensais beaucoup à cette époque (entre 16 et 20 ans). Mais QUI tue QUI ?
Au nom de quoi (c’est encore attacher trop de prix à la pièce que d’en
être l’attraction se prenant au sérieux) ? Etc... Enfin, le fameux
monologue d’Hamlet – que tout le monde ânonne sans le comprendre – «
to dream « to sleep ? to
dream ? » m’a toujours paru d’une vérité pratiquement physiologique :
peut-être – et je le crois fermement – à cause d’une familiarité précoce,
presque monstrueuse avec la fièvre, le délire, le sommeil. « The pains of
sleep », c’est le titre d’un poëme de Coleridge. Les aventures
inexprimables (et, je dois dire, troubles) qu’il m’arrive de vivre en
dormant – en plongeant – jouent un rôle d’immensité intime, objective
assez inquiétante. Difficile de croire – alors que le corps a disparu de
l’esprit – que l’esprit puisse, lui aussi, disparaître complètement avec
le corps etc... Banalités, mais qui constituent, dans cette ville, le fond
d’un décor ancien, décor que j’ai hanté, que je hante comme le personnage
interchangeable d’une très ancienne histoire... Impression dominante que
quelque chose se jour en nous, à travers nous (cf l’Intermédiaire 1). Quel
problème ! Mais je n’en finirais pas. Tu ES ce qui fait que je peux parler
de ceci, que je peux penser à un point lumineux, immédiat, tangible. Te
rends-tu compte de la chance et de l’importance que tu représentes à mes
yeux ? Les poëtes ont tous eu raison, eux qui s’embarquaient sur cette mer
de l’esprit avec un seul rythme portés, peu importe sous quelle forme, par
l’amour, etc... Finie, la dissertation. Je t’adore – t’embrasse – Ph
________________
1. Philippe Sollers, L’Intermédiaire,
Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 1963. |
|
Philippe Sollers en Folio
 
  |
|
Interview
Philippe
Sollers
14 janvier 2014 - Paris

© LEXNEWS |
|
Lexnews a eu le plaisir toujours renouvelé de rencontrer Philippe
Sollers pour la publication de son dernier roman Médium aux
éditions Gallimard. Avec ce dernier livre, l'auteur nous entraîne en
médiumnité, un parcours initiatique qui nous invite à abandonner la folie
omniprésente de notre époque pour redécouvrir, par une contre-folie, le
sens de notre vie. Partons à Venise, à la Cour du roi Soleil en compagnie
de Saint-Simon, afin de réapprendre à écouter tout ce que ces échos ont à
nous communiquer.
 l ne vous aura
pas échappé que le mot médium ne figure qu’à quelques mots de Médoc,
célèbre région du Bordelais qui vous est cher… Les lieux – dans le cas
présent Venise - semblent avoir une importance déterminante dans cette
évocation de la médiumnité, thème de votre dernier roman. l ne vous aura
pas échappé que le mot médium ne figure qu’à quelques mots de Médoc,
célèbre région du Bordelais qui vous est cher… Les lieux – dans le cas
présent Venise - semblent avoir une importance déterminante dans cette
évocation de la médiumnité, thème de votre dernier roman.
Philippe Sollers :
"Il y a des lieux plus ou moins inspirés, inspirés
négativement, inspirés de façon grisâtre, inspirés par la personne qui se
trouve là. Si vous allez à Guernesey par exemple, vous tombez
irrémédiablement sur Hugo. Nous avons fait en médiumnité beaucoup de
progrès par rapport aux tables tournantes et aux esprits qui étaient
censés répondre. C'est dans la vie de Hugo quelque chose de
particulièrement éclairant. Il y a également des lieux qui sont
privilégiés et qui appellent de tous côtés un médium éventuel, ils peuvent
d'ailleurs attendre très longtemps que cela se produise. Puis, parfois, il
y a de telles concentrations qu’on n’imagine pas qu’il puisse en y avoir
encore plus. En ce qui me concerne, vous voyez très bien où cela se passe,
à Bordeaux et dans la région – Médoc - à travers quelque chose qui est là
comme un savoir-vivre très ancien, qui s'est développé dans la culture du
vin. C'est d’ailleurs pour cela que je me moque de Calvin qui a cru
pouvoir se présenter dans la région du vin, ce qui fait aussitôt penser à
Montaigne qui se plaignait que l'on s'égorgeait sous ses fenêtres lors des
guerres de religion et qui n'appréciait pas les innovations calviniennes.
Cela déterminera d’ailleurs son voyage à Rome, et son pèlerinage à
Notre-Dame-de-Lorette que j’évoque dans mon roman. C'est en effet une
démarche médiumnique qu'il entreprend, attiré par sa curiosité qui
consistait à savoir si le pape de l'époque conservait bien les livres dont
il redoutait l’autodafé par les protestants, à savoir les textes grecs et
latins de l'antiquité qu'il chérissait tant et qui remplissaient non
seulement sa riche bibliothèque, mais également en ornaient les poutres
avec ses belles inscriptions que j'ai eu la chance de découvrir lors d'une
visite à l'âge de 12 ans… Les questions religieuses sont d'ailleurs
importantes en ce qui concerne la médiumnité même si mon livre n'est
absolument pas religieux, mais tient à enregistrer tout de même cette
possibilité d'avoir un contact avec le transcendantal, l'au-delà sans pour
autant être dans le foutoir spirite de Hugo ! Mon enfance à Bordeaux est
pour moi très importante dans la mesure où, dans l'Histoire, c'est un lieu
qui est très en avance sur l'Hexagone. Lorsque la République en 39-40
s'effondre, on se rend alors à Bordeaux, c'est-à-dire le lieu le plus
éloigné de Paris. C'est en effet l'endroit le moins cerné par l'identité
française, c’est la raison pour laquelle cette médiumnité implique un
rapport très particulier avec Londres et l'Angleterre. Pendant deux
siècles, toute cette région a été anglaise. Et comme je suis né dans une
famille très anglophile, cela m'a évité ce pénible sentiment de
culpabilité qui mine la mémoire française, à savoir Vichy et Moscou. C'est
quelque chose que je répète volontiers d'autant plus que personne n'écoute
lorsque j'évoque cela (rires) !
Puis, vient bien sûr Venise, et là il n'est pas besoin d'insister. Vous
faites immédiatement la liste et vous observez qu'il y a en ces lieux une
concentration extraordinaire dans tous les domaines : musique, peinture,
littérature… Il y a donc des lieux, et c'est ce que Rimbaud appelle dans
une formule fameuse sa quête pour trouver le lieu et la formule. Vous
pouvez très bien avoir un lieu sans la formule, et vice versa, mais si
vous réunissez les deux, vous avez alors la percussion juste."
Le mot latin mĕdĭus, dont médium est
issu, évoque cette idée de milieu et de centre, intermédiaire entre deux
extrêmes. Vous avez d’ailleurs placé en exergue de votre livre cette belle
phrase de Pascal : qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien
sans se fâcher du mal contraire aurait trouvé le point. C’est le mouvement
perpétuel.
Philippe Sollers :
"C'est une des phrases les plus fulgurantes de
Pascal qui s'intéressait beaucoup au point, au sens mathématique et divin
du mot. La formule est très étrange parce que se réjouir du bien sans se
fâcher du mal contraire, cela voudrait dire tenir les deux bouts à la
fois, on est par-delà le bien et le mal, donc dans une position très
particulière. C'est pour indiquer que tout cela a un sens métaphysique
très précis. Et puis, « l’Empire du milieu », c’est quand même la Chine !"
___________________
Ce secret
de se réjouir du bien est facilement à la portée d'un grand nombre
d'individus, mais sans se fâcher du mal contraire est une chose beaucoup
plus délicate si vous y réfléchissez
___________________
Il ne s’agit donc pas de prôner un juste milieu.
Philippe Sollers :
« Absolument pas, puisqu'en effet vous avez
trouvé un secret, et cela n'est donc pas évident. Ce secret de se réjouir
du bien est facilement à la portée d'un grand nombre d'individus, mais
sans se fâcher du mal contraire est une chose beaucoup plus délicate si
vous y réfléchissez. Le mal ne me fâchera pas, ce qui est très étonnant.
En effet, tout vous appelle à vous fâcher contre le mal des marchés
financiers, de la mondialisation, etc. la critique sociale évoquée dans ce
dernier livre ne doit pas être prise comme une protestation, ni comme une
indignation, mais de façon bien pire, comme si c'était une dégradation
aussi inévitable que sans importance. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit
pas d'un point d'équilibre, sinon nous serions dans cette idée de juste
milieu, la sagesse, et cela deviendrait du politiquement correct… Ce cas
de figure correspondrait à une position statique, alors que ce qui
m'intéresse, c'est justement le mouvement. Pascal n'y va pas de main morte
d'ailleurs, puisqu'il évoque cette idée de mouvement perpétuel avec cette
idée de quelque chose que l'on n'atteint pas. Alors que dans Médium,
je dis que c'est quelque chose qui est accessible à travers cette formule.
Je trouve alors tout de suite mon héros préféré, après Pascal, en la
personne de Saint-Simon qui est là, au cœur de cette affaire, au temps de
Louis XIV, au centre du monde. C'est en effet de là que va partir une
vague qui va ensuite exploser sur la planète entière, c'est-à-dire la
Révolution française, puisqu'il n'y en a pas eu d'autre... Saint-Simon est
une personne qui se réjouit du bien et qui décrit le mal avec une froideur
tout à fait impressionnante."
___________________
La lucidité sur
la folie peut avoir lieu à n'importe quel moment de l'Histoire, mais il y
a des époques entières où nous n’en savons rien, sauf avec des
personnalités comme celles de Saint-Simon qui la décrit de manière
admirable ou encore Pascal
___________________
Pouvez-vous évoquer pour nous cette folie qui
semble gagner nos contemporains dans les lignes pleines d’humour que vous
écrivez à l’encre de Venise ?
Philippe Sollers :
"Je vais vous citer pour cela un portrait
de Monseigneur, c'est-à-dire aujourd'hui, le Français courant :
« Il était sans vice ni vertu, sans lumières ni connaissances
quelconques radicalement incapable d'en acquérir, très paresseux, sans
imagination ni production, sans goût, sans choix, sans discernement, né
pour l'ennui qu'il communiquait aux autres, et pour être une boule
roulante au hasard par l'impulsion d'autrui, opiniâtre et petit en tout à
l'excès, une incroyable facilité à se prévenir et à tout croire, livré aux
plus pernicieuses mains, incapable de s'en sortir et de s'en apercevoir,
absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres, et, sans avoir aucune
volonté de mal faire, il eût été un roi pernicieux. » (Mémoires, Tome 9,
chapitre VII).
Lorsque vous savez que Saint-Simon a écrit ces
lignes en 1711, c’est tout à fait étonnant. La brièveté, le choix des mots
démontrent la touche de Saint-Simon. Il va même jusqu'à vous dire qu'il
s'excuse de son style qui peut apparaître négligé, alors qu'il en a une
maîtrise totale. Il souligne encore qu'il n'a jamais été un être
académique et qu'il écrit à la diable pour l'éternité ! C'est la concision
du français qui est ramené dans son rythme même, avec des mots
contradictoires, Saint-Simon atteint de cette manière, selon moi, la
vérité. La folie a eu ses heures de gloire. N'oubliez pas que c'est un
titre dont je prends le contre-pied, celui de l'Éloge de la folie
d'Érasme, c'est-à-dire un grand événement dans l'humanisme. Mais cela
n'est venu à l’idée de personne jusqu'à aujourd'hui, sauf Pascal qui
souligne combien ses contemporains ont choisi de ne pas penser à la mort,
qu’ils sont somnambules. Nous vivons dans un grand hôpital de fous et ce
serait encore être fou d'une autre façon de ne se croire pas fou. La
lucidité sur la folie peut avoir lieu à n'importe quel moment de
l'Histoire, mais il y a des époques entières où nous n’en savons rien,
sauf avec des personnalités comme celles de Saint-Simon qui la décrit de
manière admirable ou encore Pascal. Aujourd'hui, vous avez pour la
première fois – d’où mon manuel de contre-folie – une folie qui est
établie partout, à chaque instant, subjectivement ou objectivement.
L'argent fou, le corps… C'est une situation à mon avis tout à fait
nouvelle, une mutation qui correspond à celle que l'Histoire peut
connaître à certaines époques. Il est vrai que Montaigne en son temps
s'inquiétait et se demandait s’il ne devenait pas fou avec ces guerres de
religion qui ravageaient son pays comme nous l’évoquions tout à l’heure.
Mais, à la différence d’aujourd'hui, il ne consentait pas du tout à être
fou ! Les mutations techniques impliquent que le taux de folie est
endémique, sauf que, XXe siècle aidant avec sa gigantesque folie
meurtrière, on atteint aujourd’hui quelque chose qui embarrasse tout le
monde, surtout les Français. Le phénomène est observable déjà dans la
langue c'est-à-dire dans le français lui-même. Vous avez un diagnostic qui
n'appartient à mon avis qu'au français dans sa rapidité. Vous savez, les
grands écrivains français ont toujours été des moralistes, mais qui peut
encore dire aujourd'hui la folie de ces temps-ci ? Où faut-il être ? Dans
quel lieu et avec quelle formule pour l’évoquer ? C'est ce que j'ai essayé
de faire dans ce dernier livre."
|
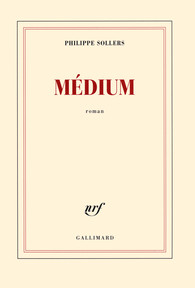
Le dernier roman de Philippe Sollers
...
Médium, Nrf, Gallimard 2014.
MÉDIUM (du latin
mĕdĭus, au milieu) : personne
susceptible, dans certaines circonstances, d'entrer en contact avec les
esprits.
_________________________
Le narrateur n’appelle pas à une résistance
au sens mécanique du terme (l’art de la guerre de Sun Tzu n’est pourtant
jamais loin…), ni même à une indignation pourtant à la mode, mais plutôt à
un examen de conscience avec l’aide de Saint-Simon, Voltaire ou encore
Lautréamont, et souvent à une bienveillance ironique, antidote à cette
torpeur frénétique.
Philippe Sollers : "En
effet, l'indignation gomme les détails, or ce sont justement ces détails
concrets qui sont importants. C'est la preuve par le concret qui importe,
sinon on verse dans les incantations. Je ne pense pas qu'il y ait une
bienveillance de ma part, c'est plutôt une façon de pratiquer
l'affirmation qui n'est pas le contraire d’une négation. C'est une
affirmation évidente, animale, instinctive. Le corps doit participer de
cette fonction affirmative que tout veut lui retirer. Nous vivons dans un
monde – politique, social, etc.- où le corps humain n'est pas bienvenu
dans toutes ses dimensions. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un
personnage de masseuse - j'aurais pu prendre une Chinoise en acupuncture-
afin de savoir qu'est-ce que le corps humain ? où en est-il ? Je me moque
de la PMA, de la GPA, nous n'en sommes pas encore à l'utérus artificiel,
mais cela viendra… Je ne m'indigne pas, je ne manifeste pas contre,
j'essaye de montrer ce que cela veut dire. Bien évidemment, il y a des
personnes que cela choque. Elles pensent qu’il s’agit là de réactions
atrabilaires, réactionnaires, eh bien pas du tout ! C'est pire. Peu
importe qu'on soit pour ou contre, on n'en est là. Regardez où nous en
sommes en France aujourd'hui, entre la quenelle de Dieudonné et le scooter
du Président… Il s'agit donc de savoir s’il y a encore quelqu'un qui est
capable de faire fonctionner son corps avec ses cinq sens et pas seulement
l'œil et le bavardage, ce qui est une façon d'être fou. On vous propose
aujourd'hui à tout instant, de renforcer votre folie. Evidemment, comme
cela est très usant, vous trouvez la plupart de nos contemporains
résignés, déprimés, en dépression profonde. Vous pouvez ainsi considérer
mon livre comme un antidépresseur ! (rires)."
Les médiums de votre roman revêtent en
effet comme vous l’évoquiez la forme inattendue d’une belle masseuse
vénitienne ou de substances favorisant l’envol. Médium, et révélation de
ce qui était caché à nos sens semblent alors entretenir des liens que vous
suggérez dans ces lignes d’une légèreté médiumnique…
Philippe Sollers :
"Il y a deux domaines de l'expérience
humaine qui me sont privilégiés. Tout d'abord la musique, et là-dessus je
me suis beaucoup exprimé, Mozart, etc. Les musiciens ou les musiciennes
sont à mon avis les derniers personnages qui ont droit à une certaine
considération. Si je vous dis par exemple que je vais vous inviter demain
à ma prochaine installation de peinture, c'est quelque chose que je peux
faire sans savoir dessiner, il y aura du monde devant ces barbouillages,
d’où cette folie à propos de l'art contemporain, ce marché de l'art. Dans
l'île de Ré, où je vis souvent, à la limite d'une réserve d'oiseaux, je
reste là, un mois, deux mois à observer les oiseaux. Goéland, aigrettes,
les mouettes rieuses qui sont d'ailleurs également présentes à Venise… Et
la rentrée chez les mammifères m’est toujours extraordinairement pénible,
l’être humain est un mammifère lourd, et il a raison de s'en plaindre
comparé à ce qu'il peut faire verbalement. Alors que vous ne savez jamais
où meurent les oiseaux, d'où ils viennent, à quel moment ils arrivent,
c'est l'éternel retour, car vous avez toujours l'impression que c'est la
même mouette qui est là. Lorsque vous arrivez à Venise, la première chose
que vous voyez, ce sont les goélands fichés sur les piquets qui sont
toujours là, dix ans, vingt ans après… Si vous entrez ensuite dans Venise,
vous pouvez trouver l'endroit, le lieu, et la formule qui vont vous
séparer des mammifères, ce qui est très facile, car si vous faites un pas
de côté, vous êtes tout de suite seul dans les quartiers populaires tels
que je les décris dans mon livre, avec une humanité qui continue ses
tâches quotidiennes et qui n'est pas impressionnée par votre présence.
Vous êtes alors dans une légèreté qui est humaine, et qui amène tout droit
à la question des femmes : où, quand et comment, questions au sujet
desquelles j’ai écrit un certain nombre de récits."
Si le médium révèle, en même temps Philippe
Sollers évoque l’art de l’éclipse et des volets mi-fermés. Entre lumière –
Sollers / Soleil - et pénombre qui a traditionnellement abrité celui ou
celle qui voit plus loin, le point d’équilibre semble sans cesse à
trouver.
Philippe Sollers :
"C'est en effet l'entre-deux. Il faut être
très familier de l'obscurité, cela comporte le sommeil, la nuit noire, le
fait de savoir se déplacer dans le noir, sans quoi vous n'avez pas la
lumière. La lumière est un effet de l'absence de lumière."
A l’image du silence à l’égard de la musique ?
Philippe Sollers :
"Oui, c'est du silence que surgit et que
doit aboutir la musique. La musique doit faire place à un certain silence,
ce qui n'empêche pas des moments d'une grande violence. Le musicien qui a
compris cela très brillamment, c'est Haydn. Si vous écoutez les
interruptions, l’arrêt brusque avec cette musique qui ne va nulle part et
qui repart dans ses sonates et ses symphonies, c'est souvent encore plus
fort que Mozart. C'est le contraire de Wagner, un mammifère extrêmement
toxique (rires)…"
___________________
Je peux ouvrir la
Bible, la tradition chinoise et toute la bibliothèque, mais il faut que
cela surgisse comme option, comme demande. À ce moment-là c'est comme si
les morts me demandaient quelque chose à travers un texte particulier
___________________
Médium propose un véritable
bréviaire de contre-folie. S’il n’est pas forcément à prendre au pied de
la lettre, le détachement qu’il suggère est manifestement inspiré par
cette distance vis-à-vis des choses et des êtres avec de nombreuses
références à Saint-Simon et aux classiques chinois que vous chérissez.
Philippe Sollers :
"Le mot bréviaire me gêne un peu, même s'il
est très beau, car il implique un sacerdoce. J'ai préféré le mot manuel
pour son aspect pratique d’exercices de contre-folie que je recommande et
choisis dans différentes situations : faire du vélo d’appartement à trois
heures du matin, lire des classiques chinois… Le bréviaire s’attache à un
texte qui est classé. Un bréviaire pourrait être pratiqué à l’intérieur
d’un manuel de contre-folie, mais le contraire n’est pas vrai. Je peux
ouvrir la Bible, la tradition chinoise et toute la bibliothèque, mais il
faut que cela surgisse comme option, comme demande. À ce moment-là c'est
comme si les morts me demandaient quelque chose à travers un texte
particulier. J'ai décrit cela dans Passion fixe. Je n'avais pas
compris au début pourquoi c'était Cyrano de Bergerac dont je trouvais le
livre ouvert sur ma table. Voilà une transmission médiumnique qui m’a
interrogé et en cherchant les raisons, cela a fait tout un roman."
Le narrateur encourage ce détachement de la folie
ordinaire et quotidienne avec des références à Saint-Simon et à la
philosophie chinoise.
Philippe Sollers :
"C’est pour cela que j’imagine dans
mon livre - ce qui est tout à fait plausible - des émissions en français
qui sont diffusées depuis Shanghai et que l'on écoute sur les ondes
ultracourtes à Venise et qui vous disent un certain nombre de choses, un
peu comme Radio-Londres qui m’a tant influencé dans ma jeunesse : voici
quelques messages personnels sur fond de brouillage, et c’est sur ce
fond de brouillage qui est le problème, savoir se dessaisir de ce
brouillage… Qui connaît la joie suprême ne craint ni la colère du ciel,
ni la critique des hommes, ni l'entrave des choses, ni le reproche des
morts. Comme c'est beau ! Les morts pourraient vous faire des
reproches ? Mais oui, bien sûr : les morts, les pauvres morts ont de
grandes douleurs, dit Baudelaire… Que les morts soient plus vivants
que les vivants est quelque chose qu’un médium ressent non pas pour faire
tourner des tables, mais comme une perception violente, aujourd’hui."
Pouvons-nous terminer notre entretien avec
ce beau passage énigmatique, presque initiatique, et que l’on verrait bien
inscrit sur quelques linteaux d’un sanctuaire delphique : Je suis le
Médium et le double de quelqu’un qui dure (…) quoi qu’il arrive, il sera
comme il est, le même. En moi, comme moi, plus que moi.
Philippe Sollers :
"Oui, ce passage est intéressant, car il y
a du saint Augustin dans cette évocation, mais aussi la gnose avec
l’Évangile selon Philippe : bienheureux celui qui est avant d'avoir
été, car celui qui est, a été, et sera. Ce qui est extrêmement
intrigant. Quel est le nom de Dieu qui parle à Moïse dans la Bible en Ex
3:13-14 lors de l'épisode du Buisson ardent? Je trouve que l'on n'a pas
assez réfléchi à cela, c’est je suis : « Eyeh Asher Eyeh »,
je serai qui je serai, je serai que je serai… C’est une parole qui est un
drôle de nom ! Comment vous appelez-vous ? Je suis. Je décris
d’ailleurs le Christ dans ce dernier roman d'une manière tout à fait
nouvelle à mon avis, car je l'évoque en athée sexuel, ce qui a l'air assez
irrespectueux, et pourtant il me semble que cela soit très vrai. Il s'est
comporté comme s'il n'y croyait pas, ce qui est un blasphème épouvantable,
surtout de nos jours."
Vous distinguez de cette manière le Christ évoqué
par les textes canoniques de celui décrit pas les apocryphes.
Philippe Sollers :
"Oui, vous avez notamment cette histoire de
la fem
me adultère au cours de laquelle le Christ écrit des signes sur le sol,
que l’on ne comprend pas, et qui conclut en disant va et ne pèche plus.
En ce qui me concerne, je traduis par évites de te faire prendre !"
Propos recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
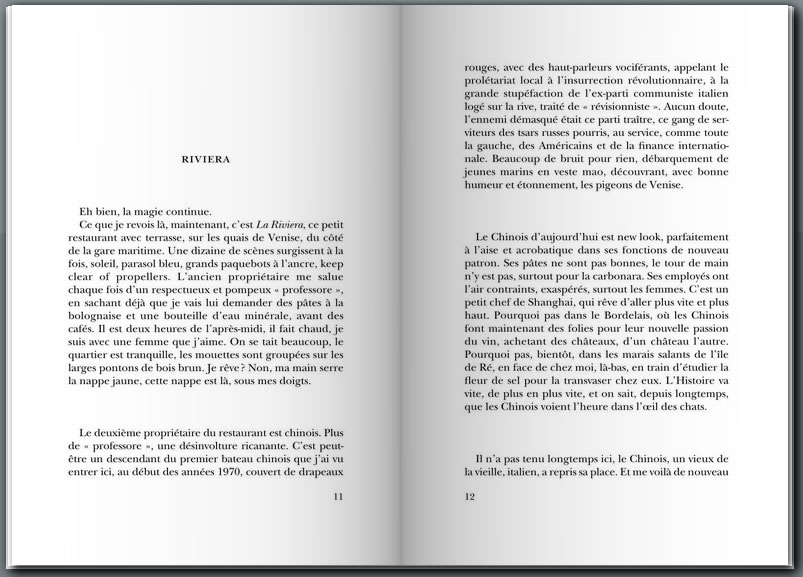
premières pages du dernier roman
Médium de Philippe Sollers aux éditions Gallimard
|
|
Interview
Philippe
Sollers
Paris, 6 mars 2012 |
|
 |
 |
|
Qui ne
connaît pas Philippe Sollers ? Mais le connaît-on vraiment ? Derrière
les clichés trop souvent véhiculés plus vite que la lumière, se cache un
homme épris de liberté, de beauté et d'amour, éléments d'un ciment
imperturbable qui édifie, année après année, une réflexion majeure et
innovante dans notre société en crise de ses fausses certitudes. L'homme
attire, agace certains, ne laisse pas de glace mais brûle d'un feu qui
jette des éclaircies dans notre quotidien. Rencontre avec une percée de
lumière, pour notre plus grande joie ! |
Le dernier livre de Philippe Sollers
...
L'ÉCLAIRCIE, 256 pages, Collection
blanche, Gallimard, 2012.
« Dès ma première rencontre avec Lucie,
une formule espagnole m'est revenue à l'esprit : "los ojos con mucha
noche", les yeux avec beaucoup de nuit. Les "coups de foudre" sont
rares, les coups de nuit encore plus. Les tableaux où Lucie
apparaîtrait, si j'étais peintre, devraient être envahis par l'intensité
de ce noir sans lequel il n'y a pas d'éclaircie. Noir et halo bleuté.
Tout le reste, robes, pantalons, bijoux, répondrait à ce noir, nudité
comprise. Mais la preuve, ici, est dans les lèvres, la bouche, la
langue, la salive, le souffle. C'est en s'embrassant passionnément, et
longtemps, qu'on sait si on est d'accord. le long et profond baiser,
voilà la peinture, voilà l'infilmable. J'arrive toujours avec dix
minutes d'avance. J'entends l'ascenseur, le bruit de la clé de Lucie
dans la serrure, les rideaux sont déjà fermés, action. »
|
|
 omment est né
l’écrivain Philippe Sollers ? Par quelle lumière et quel appel
l’écriture est-elle venue au jeune homme très tôt remarqué par Ponge,
Mauriac et Aragon ? omment est né
l’écrivain Philippe Sollers ? Par quelle lumière et quel appel
l’écriture est-elle venue au jeune homme très tôt remarqué par Ponge,
Mauriac et Aragon ?
Philippe Sollers : « J'ai évoqué dans la préface d'un livre, qui
s'appelle « Vision à New York », une très curieuse expérience
vécue à l’occasion de la lecture. J’avais l’impression que les mots se
détachaient de la page, commençaient à vivre leur propre vie et
m'entraînaient dans une vision tout à fait différente de ce qu'on
appelle la réalité. A la lumière de cette évocation intime, la grande
expérience, fondamentale, n'est pas ainsi l'écriture, mais bel et bien
la lecture. J'ai raconté un épisode encore plus ancien lorsque j'avais
cinq ans. Je suis assis sur un tapis dont la couleur rouge m'apparaît
maintenant, et j’ânonne un livre pour enfants. A quel moment
réalise-t-on que l’on sait lire ? Voilà une belle question ! Tout à
coup, l'enchaînement se fait, c'est le moment où j'entends la voix de ma
mère me dire : « maintenant, tu sais lire !” Je lis ! Je n’ânonne
plus les syllabes ou les voyelles… Cette déclaration du savoir-lire, qui
va automatiquement un jour ou l'autre provoquer un savoir- écrire, m'a
littéralement inondé d’une joie extrême et je me vois encore courir dans
les prés, dans la campagne, en criant à tue-tête : je sais lire !
Ce sont des souvenirs très précis et essentiels, comme si j'étais
conscient de ce trésor inestimable qu’est la lecture. Ce trésor est bien
menacé aujourd'hui, et un jour ou l'autre, il apparaîtra comme une
rareté réservée à un trop petit nombre. J'étais persuadé qu'avec cette
capacité, j'allais pouvoir traverser tous les phénomènes, les aventures
et les périls. J’ai constamment essayé de retrouver cet état-là, et j'ai
lu, beaucoup lu, notamment celle qui a été fondatrice chez moi : la
poésie. Baudelaire a beaucoup compté et a été certainement celui qui m'a
le plus marqué. C’est en apprenant par cœur ses poèmes, mais aussi ceux
de La Fontaine que je me suis familiarisé de plus en plus avec cette
écriture. À partir de là, j'ai commencé à souhaiter écrire les choses
que je ressentais. Comment raconter à la fois ma vie et le monde en
général. ? Tout cela s’est déroulé très vite, il y a eu plusieurs essais
pas très satisfaisants et un livre écrit très jeune à 22 ans « Une
curieuse solitude » qui évoque un certain nombre d'expériences de
mon adolescence sur fond espagnol, car la familiarité avec les langues,
et notamment l’espagnol, a été capitale. Ce livre a trouvé un écho
immédiat, j'ai raconté tout cela, et le reste a suivi ! »
Dans votre dernier roman, L’Eclaircie, vous citez le cardinal
Retz qui fait référence à la fois à l’idée de vérité et d’éclat. Quelle
est cette vérité qui vous a animé jusqu’à aujourd’hui ? Et, une fois de
plus, nous retrouvons cette idée de lumière qui semble si importante
chez vous ?
Philippe Sollers : « Absolument ! La vérité, lorsqu'elle est à un
certain carat, jette un éclat auquel rien ne saurait résister… Carat
renvoie à diamant et diamant renvoie à mon nom d’état civil qui est «
Joyaux », ce qui n'est pas sans conséquence dans la vie d'un écrivain
même si j'ai pris un nom moins exposé tiré du dictionnaire latin (sollers
: habile, adroit en latin. NDLR). La luminosité du diamant est
quelque chose qui perce et si les mots sont bien agencés, la vérité
apparaît alors dans une certaine manière de traiter le langage. Vous
allez alors me demander : quelle vérité ? »
___________________________
"La
vérité, telle que je l'entends, est
forcément en relation avec l’amour, la liberté et la poésie."
___________________________
Vous n’êtes
bien entendu pas pour une seule vérité !
Philippe Sollers : « Non, en effet, et dans l'Éclaircie, je
cite le poète sur lequel Picasso a beaucoup réfléchi, Luis de Gongora,
qui a ce poème extraordinaire selon lequel il faut se fier aveuglément
non pas à l'objet vain, mais à la meilleure signification, pour que de
cette façon les portes du discours ouvrent aux vérités. Bien entendu,
que de crimes a-t-on commis au nom de la vérité ! La vérité est multiple
et dès qu’elle est racornie, utilisée comme outil de propagande, ce
n'est plus la vérité. D'une certaine façon, comme quelqu'un d'assez
emblématique a pu le dire, je suis la voie, la vérité, la vie, je
pense également que sans la voie et sans la vie, la vérité reste lettre
morte.
Dans le maniement du langage, cet accès à la vérité peut prendre deux
formes. Il peut y avoir en premier lieu une critique extrêmement acide
de la société du mensonge, ou du mensonge comme société, sentiment que
l'on sait ou non reconnaître. Car les adultes mentent et cela l’enfant
l’apprend un jour ou l’autre, plus ou moins tôt. Les adultes sont des
enfants ratés, et ils se vengent d’ailleurs sur leur progéniture ou leur
entourage de ce ratage essentiel… La vérité, dit Kafka, n'est rien
d'autre que la lumière sur le visage grotesque qui recule,
c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être dit.
La deuxième chose réside dans la possible affirmation lyrique de la
poésie comme vérité dans les circonstances d'une narration. J'ai
toujours aimé ce que Breton disait de lui-même : Il estimait n’avoir pas
démérité par rapport à trois perspectives qui s'étaient présentées dans
sa vie, à savoir l'amour, la poésie et la liberté. La vérité, telle que
je l'entends, est forcément en relation avec l’amour, la liberté et la
poésie. La poésie, étant la source constante, indique en quoi la vérité
est offusquée, niée, détournée désormais par tout l'appareillage social
mondialisé. À s'engouffrer dans la communication, on parle sans plus
jamais savoir ce que parler signifie… »
La lumière et l’éclaircie supposent, comme vous le rappelez souvent,
un constat de pénombre et de ténèbres qui blesse notamment notre époque
moderne. Face à ce drame, votre écriture et votre être appellent à
réagir, et sinon à combattre des chimères, tout au moins à se réveiller.
Philippe Sollers : « Oui, Drame est d'ailleurs le titre d'un
de mes livres et choisi à dessein dans le sens que vous évoquez. Par
contre, je ne me reconnais pas dans le verbe réagir qui laisse
entendre une réaction et non pas une action, ce qui voudrait dire que
l'on pose quelque chose comme existant. C'est d'ailleurs une tendance
flagrante que l'on note chez un grand nombre d'écrivains aujourd'hui,
tendance selon laquelle il faudrait impérativement contester un
ensemble. Il faut que l'affirmation soit plus forte que la contestation,
sinon c'est une réaction qui conduira très rapidement à être
réactionnaire. Il faut bien être conscient que c'est toute la période
nihiliste que nous vivons aujourd'hui, et ce n'est que le début… Quant à
la pénombre et aux ténèbres que vous évoquez : Effectivement, sans nuit,
il n'y a pas de jour, et sans épreuve néantisante, il n’y a pas le
surgissement de l’être. C'est pour cela que cette expérience du néant
est considérable car, à ne pas prendre en considération le néant
(Heidegger), on aboutit au nihilisme. On ne fait pas l'expérience d'une
néantisation, le néant néantise… Evidemment, on va me dire mais
qu’est-ce que vous racontez là ! Du coup, surgissent la mort, la
morbidité, le romantisme, etc. La subjectivité se débat dans quelque
chose dont elle se plaint et il ne faut pas qu'il y ait de plaintes, il
faut qu'il y ait l'ironie, le détachement. Sans une forme de mépris, la
critique n'est pas recevable. Cette critique, telle que je la conçois,
est très mal vécue par la réception sociale qui, au contraire, a tout
intérêt à favoriser les gémissements poétiques comme le dit
Lautréamont… Nous avons donc une affirmation, et bien entendu des noms
viennent immédiatement à l'esprit : Nietzsche, et surtout cette formule
de Heidegger qui est la suivante : les dieux sont ceux qui regardent
vers l'intérieur dans l'éclaircie de ce qui vient en présence. C'est
une échappée vers une clairière et cela me permet de faire signe en
direction de ce qui a disparu, c'est-à-dire les dieux grecs, déesses
comprises. »
Vos écrits
et vos jugements font justement souvent penser à des fulgurances qui
semblent tout droit héritées du panthéon grec. Quel rapport
entretenez-vous avec ces vérités de la plus ancienne antiquité ?
Philippe Sollers : « Sans les Grecs et les Latins bien entendu, vous
savez ce qui arrive ! Cela conduit forcément à l'obscurantisme le plus
fou. Ces dieux ne sont pas académiques, ils ne sont pas rangés et sont
toujours en mouvement. Ils entretiennent d’ailleurs des rapports
extraordinairement spécifiques entre eux. Le Parménide
d'Heidegger est un livre essentiel, écrit dans les circonstances
catastrophiques de 1942. Vous avez là quelque chose de très révélateur
qui nous ramène d’ailleurs à la question de la vérité. Le poème de
Parménide est bien connu : le cavalier est emporté par ses cavales et
monte aussi loin que le porte son désir. Il arrive devant la déesse
Vérité et elle l'accueille de manière bienveillante, car il n'est pas si
courant qu'un mortel ait fait tout ce parcours pour connaître l'être, le
non-être, etc. S’il y a un aspect divin que faisait apparaître le
passage que nous évoquions tout à l’heure de l’Evangile, il y a
également cette filiation grecque. Quant au français, on peut dire qu’il
y a eu un miracle comme le relève Nietzsche : un miracle plus
extraordinaire encore que le miracle grec. Et c'est d’ailleurs de cela
dont nous souffrons abominablement. Nous sommes dans un tel embarras de
nos jours, car nous sommes dans une culpabilité de ne plus être à la
hauteur de ce miracle. Cette culpabilité est très étrange et en même
temps très révélatrice. Les Français ont cette particularité d'avoir
fait la seule révolution qui ait eu lieu, tout le reste n’étant que
fariboles. Et en même temps, ils sont dans la terreur de ce rapt
considérable. Le Français est porteur d'une énergie et d'une fulguration
particulière, ce que prouve n'importe quelle lettre de Voltaire que vous
ouvrez le matin. Si vous êtes un peu mélancolique, vous verrez que cela
va vous donne une autre vision immédiate des choses ! En effet, cette
fulguration bien particulière est grecque, et Nietzsche le dit
d'ailleurs à propos de Voltaire. Il dédie d’ailleurs « Humain trop
humain » à Voltaire lors du centième anniversaire de sa mort. De
même, il pense que c’est des Français qu’il faut se rapprocher et il a
de plus en plus recours au français dans son écriture. Il y a là un
voile de culpabilité, de trahison des Lumières, qui fait que moins vous
reconnaissez cette prépondérance du français en Europe, plus vous donnez
libre cours à tous les éléments plébéiens, pour parler comme Nietzsche,
qui remonte par tous côtés. Vous en avez plein les journaux, dans
l'actualité et ce n'est qu'un début… Et voilà l'aspect politique de la
vérité abordé ! Vous savez, tous mes livres sont très politiques, ce qui
les différencie beaucoup de la production littéraire, pas seulement
française, mais également internationale. Si on ne met pas l’accent sur
l'énergie de sa propre langue et de son histoire, on va favoriser la
dévastation qui n'est que trop évidente. Il ne s'agit pas encore une
fois de réagir contre, mais il s’agit, et je vous remercie d'avoir
utilisé ce terme, autant que possible d’avoir la force de fulgurer. »
Cet
héritage grec vous a donc accompagné dès le plus jeune âge.
Philippe Sollers : « Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas
fait de très solides études classiques. Autrement dit, je suis dans la
position d'un peintre qui aurait appris réellement à dessiner, ce qui
n'est plus le cas aujourd'hui, car les artistes n'ont plus cette
qualité. J'ai eu très tôt la conscience aiguë de cette spécificité
lumineuse, tourné vers l'Angleterre. Le premier élément essentiel a été
de naître dans une famille anglophile. C'est une ambiance dans laquelle
j'ai baigné très jeune. Les Allemands étaient au rez-de-chaussée de
notre maison alors que la TSF branchée sur l'Angleterre se trouvait dans
le grenier et les parachutistes anglais à faire passer en Espagne cachés
dans les caves. C'est bien évidemment une enfance intéressante… Le
deuxième épisode important se situe pendant la guerre d'Algérie dans les
hôpitaux militaires où j'avais réussi à me faire réformer pour terrain
schizoïde aigu ; Là, c'est Malraux qui m'a sauvé la vie, car j’avais
commencé une grève de la faim. J'ai beau raconter cela à mes
compatriotes autant de fois que vous voulez, cela ne les touche
absolument pas… Lorsque j'ai écrit, il y a 13 ans, « la France moisie
» à la une du journal Le Monde, cela a été une véritable levée de
boucliers en prétextant que je me livrais à un article fasciste ! (...)
|
(...) Et
aujourd'hui, on me dit de réécrire cela, ce qui ne m'intéresse bien
évidemment plus… Toutes ces idées historico-politiques s'inscrivent dans
la perspective d'une affirmation constante qu’il s’agisse de Mozart,
Casanova ou encore Nietzsche. La littérature a une façon de penser non
seulement la vie individuelle, mais également la vie historique
c'est-à-dire de penser sa propre vie en tant que micro événement à
l'intérieur de la grande histoire. Je crois que cela est vraiment
nécessaire. Sinon, vous obtenez l'éternel roman familial qui n'en finit
pas sous toutes les prétentions libératoires de se reformuler sans
arrêt, ce qui fait que neuf fois sur dix, je suis tenté de dire : allez
parler de cela sur le divan. »
Votre
rapport à la nature et aux choses entrelace à la fois souvenir,
réminiscences, et en même temps un éternel présent revisité.
Philippe Sollers : « Le français nous permet un jeu de mots, je
suis été. Cela a l'avantage d'être une saison et de mélanger le
passé et le présent. C'est donc un rapport au temps extrêmement
particulier. Cette question du temps est essentielle dans la littérature
et je ne suis pas le premier à le dire bien entendu. Où en sommes-nous
avec le temps ? C'est la fameuse question d’Arthur Cravan posée lors de
sa visite à Gide et ce dernier sort alors sa montre et lui répond :
il est six heures et quart ! Être et temps, temps et être… il y a eu
de la pensée dans la littérature, mais également de la pensée dans la
peinture si l'on pense à Manet dans l’Eclaircie. Tout le monde se
trompe sur le compte de Manet. Le public vient cracher sur Le
déjeuner sur l'herbe et l’Olympia, et Manet est très surpris,
car il a l'impression de faire la résurrection d’une peinture absolument
classique, ce qui est évident. Eh bien non ! C'est la naissance de la
peinture moderne, nous raconte-t-on, et vous voyez les foules défiler
dans les musées sans rien voir, ce qui est peut-être pire que d'aller
cracher sur ses toiles… Quant à Picasso, alors n'en parlons pas ! Avec
ses allées et venues dans le temps… De ce point de vue, Bataille a été
un écrivain qui a énormément marqué ma jeunesse. Je me rappellerai
toujours comment j'ai découvert L'expérience intérieure, un jour
chez un libraire, posé négligemment par terre et dont personne ne
voulait. Son autre livre Lascaux a été pour moi une révélation
considérable, révélation qui m'a conduit aux grottes de Lascaux, à une
époque où on pouvait encore les visiter. Cela a été un véritable choc
non seulement visuel, mais également sonore. J'étais en face d'une
pensée d'une grande profondeur, imaginez-vous un esprit réalisant un
livre aussi brillant sur Lascaux et sur Manet, c'est tout à fait
étonnant ! Cela a été rendu possible par tout ce qu'il a tenté,
expérimenté, y compris sur le plan érotique, mais surtout grâce à son
rapport au temps. Le temps ! Si vous êtes déjà dans votre pierre
tombale, vous avez la date de votre naissance et la date de votre mort,
et puis entre les deux vous faites ce que votre corps aura pu ! Et nous
retombons, dans ce cas, dans cette sorte de généalogie qui se transforme
de plus en plus en sociologie. Le grand obstacle à franchir en effet
dans bien des choses est cette réduction automatique à la sociologie. La
société étant devenue Dieu, vous êtes donc prié de vous définir
socialement et sociologiquement. C'est la mort elle-même qui vous parle
en économie politique et vous entendez toutes les déclarations les plus
contradictoires, vous entendez ce désir de mort. C'est un mauvais
rapport avec le temps qui vous crie son désir de mort. Par rapport à
cette propagande et à l’opposé des prédicateurs de la mort comme le dit
très bien Nietzsche, il ne s'agit pas encore une fois de réagir,
mais de trouver cette autre position, ce détour, cet écart, voilà. Cela
est intéressant et c’est très rare… »
« Et cela dérange ! »
Philippe Sollers : « Oui, sourdement ! Vous savez, la société est un
gros animal qui prend toutes les formes possibles et imaginables. Cet
animal sent qu'il ne maîtrise pas le cas en question de l'écart. Par
conséquent, vous prenez Les Voyageurs du Temps et vous lisez tout
ce qui concerne les rapports entre la bête et ses parasites. C'est un
passage qui est suivi immédiatement de propositions à propos de Kafka,
un grand explorateur de cette affaire. Que signifie être parasité ?
Vivre sur la bête… J’invite vos lecteurs à reprendre ce texte».
___________________________
"La
question est que si vous êtes réfractaire, vous coulez dans le moule de
la culpabilité, ce qui me paraît tout
naturel en fonction même de la nature."
___________________________
Le regard
de l’enfant est primordial et perdure bien au-delà des souvenirs que
l’on peut en avoir. Faire de chaque jour une éternelle enfance
pourrait-il être un adage que vous accepteriez ?
Philippe Sollers : « Volontiers, si ce n'est pas trop prétentieux de
rappeler en effet, la phrase de la déclaration de Baudelaire : Le
génie, c’est l'enfance retrouvée à volonté, et il dit bien à volonté
! et non pas par bouffée mémorielle, même pas par la mémoire
involontaire à la Proust… C'est quelque chose qui a trait à l'innocence
puisque tout le monde se sent coupable, à juste titre, probablement. La
question est que si vous êtes réfractaire, vous coulez dans le moule de
la culpabilité, ce qui me paraît tout naturel en fonction même de la
nature. Comment la nature serait-elle coupable ? C'est vrai qu'il y a
des tsunamis, des tremblements de terre, qui sait si on n’a pas dérangé
la nature ? C'est la question de l'innocence. Il me vient à l'esprit la
réflexion merveilleuse d’Hitchcock à Truffaut dans ses entretiens,
Truffaut dit à Hitchcock : n'avez-vous pas l'impression que vos films
sont toujours empreints de quelque chose de catholique en faisant
référence à ses rapports à la culpabilité dans ses réalisations. Et
Hitchcock réagit très vivement à cela en disant : comment pouvez-vous
me dire cela alors que je n'arrête pas de montrer l'innocence de
l'individu dans un monde coupable ! Il est vrai que si vous prenez
le personnage de Kaplan dans La mort aux trousses, tout le monde
lui en veut et souhaite sa mort alors qu’il n’est absolument pas
concerné, vous avez là une référence évidemment christique. Et cela, le
gros animal ne le comprend pas, mais le sent ! »
Les impératifs catégoriques ne résistent pas longtemps face aux idées
que vous développez, c’est particulièrement sensible dans le rapport à
la sœur, à la mère, à l’amante et aux femmes de manière générale…
Philippe Sollers : « Je crois que c'est important parce que c'est
une zone censurée, tabou. Une personne m'a dit qu'il faudrait faire le
catalogue de tous les personnages féminins de mes livres. Il semble que
l'on puisse en identifier à peu près deux cents de toute nature. La
dernière qui s'appelle Lucie dans l’Éclaircie n'a rien à voir
avec Minna dans Trésor d'amour. Chaque fois, je fais remarquer
que tous ces romans sont bel et bien des romans où il y a une situation
provoquée par le roman lui-même, où il y a un ou plusieurs personnages
féminins et je fais en sorte de donner un traitement nouveau de ce
sujet. Dans un de mes romans, je me moque de Musil, on me fait alors le
reproche : mais qui êtes-vous pour vous moquer d’un tel auteur ?
On ne me fait jamais la démonstration dans ces critiques de ce qui
pourrait être faux quant à mes développements. Je suis très certainement
l'un des rares écrivains à l'heure actuelle à avoir étudié de près dans
la littérature tout ce qui allait suivre quant à la fabrication de
l’espèce humaine, les questions de l’in vitro, ce corps humain
fabricable à l’infini… Ces choses-là ne sont pas fausses, et d'ailleurs
la plupart du temps, je donne des références très précises. Nous sommes
à une époque où il y a l'information mais sans le commentaire. Vous avez
des massacres et cela ne fait pas plus de vagues, d’autant plus que le
corps est fabricable à l’infini… »
L’absolu pourrait-il résider dans cette réunion des cinq sens que
vous soulignez particulièrement chez Manet et Picasso dans votre dernier
roman ?
Philippe Sollers : « C'est, en effet, la fameuse formule de
Lichtenberg posée sous forme de devinette : il y a très peu de choses
que nous pouvons goûter avec les cinq sens à la fois. Vous réfléchissez,
et la réponse est évidente : c’est l’acte amoureux lui-même. Il est
étonnant que dans certaines tentatives d’art, il y ait comme une
transfusion des sens les uns dans les autres et, je n'ai pas inventé la
formule puisqu’elle est de Claudel, l'œil alors écoute. Tout ce qui
approche de cet art, qui est un art amoureux, est une forme d'écart par
rapport à la grande expropriation en cours, c'est-à-dire que vous êtes
exproprié non seulement de votre corps, mais également de vos
sensations. Autrement dit, vous êtes « scotché » à l'image, ce qui est
la grande force du système. Il suffit d’ailleurs de faire l'essai de
regarder la télévision en coupant le son, un excellent moyen pour
prendre conscience de tout cela. »
Une question indiscrète pour finir : pouvez-vous nous parler de cette
couleur noire, d’un noir bien particulier, qui semble tant faire vibrer
tout votre être ?
Philippe Sollers : « Le livre commence par une éclaircie, mais se
poursuit par une mort. Ensuite, il y a cette ressemblance étonnante
d'une femme qui ressemble à une morte, on pourrait tirer de cela des
effets fantastiques à la Edgar Poe. Eh bien non, ce ne sera pas cet
effet-là qui sera recherché, on tire plutôt immédiatement ce choc que
provoque en vous… cela… (Philippe Sollers montre alors une
reproduction du portrait de Berthe Morisot au bouquet de violettes peint
par Manet qui est posé sur son bureau NDLR). Vous avez ici ce noir
qui vient d'Espagne avec Vélasquez, Goya, c'est quelque chose qui vous
met en présence dans le regard même, un regard avec beaucoup de nuit
comme on dit en Espagne, d'une très étrange sensation de vie. Ce noir
est la vie elle-même, cette lumière du noir qui est la vraie lumière.
Dans le Voyage au bout de la nuit, il y a une lumière, et je fais
exprès de faire référence à ce livre fabuleux. Les intermittences de
clarté sont d'ailleurs souvent le fait des femmes dans ce livre. Le
rapport des écrivains et des femmes est très restreint en expérience, et
il y a très peu de cas écrivant sur le terrain. Manet était un virtuose
de l'accès au féminin, Picasso aussi, c'est d'ailleurs cela qui les
rapproche. Vous connaissez ce tableau de 1919 qui s'appellent Les
amoureux de Picasso, vous avez là les cinq sens… Manet demandait à
sa femme, merveilleuse pianiste, de lui jouer du Haydn alors que tout le
monde écoutait à l'époque du Wagner, du Schumann, des romantiques… Rien
n'est plus lumineux que Haydn, et si vous écoutez la façon dont il
s'interrompt tout le temps, vous voyez apparaître une expérience d'un
certain néant d'où la note surgit. Je pense avoir été le premier à
souligner que partout où vous avez ce noir vibrant, vous avez une
proposition incestueuse, qu'il s'agisse de la belle-sœur de Manet ou des
deux sœurs de Picasso… Et lorsque j'évoque cette proposition, il faut
bien comprendre par là que c'est le contraire de la prédation. C'est sur
le bord et non pas l'acte. C’est tout ce qui peut faire vivre en même
temps le temps, celui de l'enfance, et le temps présent, toute cette
masse de matière noire… Il s'agit bien là de l'inceste tout à fait
sublimé et non pas idéalisé. Il faut aller assez loin dans le vibrant de
l’expérience, et non pas voir cela de loin. Il n'y a rien d'obscène dans
tout cela. Ce sont des émotions très profondes. Les adultes étant des
enfants ratés se vengent constamment, d'où la pédophilie. Qu'est-ce que
la pédophilie sinon qu'un adulte se venge de sa propre enfance. De la
même manière, qu'est-ce que l'inceste misérable qui conduit à des
séquestrations et autres horreurs, si ce n'est l'esprit de vengeance qui
est tout le temps à l'œuvre. »
Propos recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
www.philippesollers.net
|
|
|
|
Oeuvres complètes Gustave Roud - Editions
Zoé
Interview Daniel Maggetti 15/09/22 |
|

Vous êtes avec Claire Jacquier à
l’origine de cet immense projet de l’édition critique des œuvres
complètes de Gustave Roud. Comment vos pas ont-ils rejoint ceux de ce
grand poète suisse du XXe siècle ?
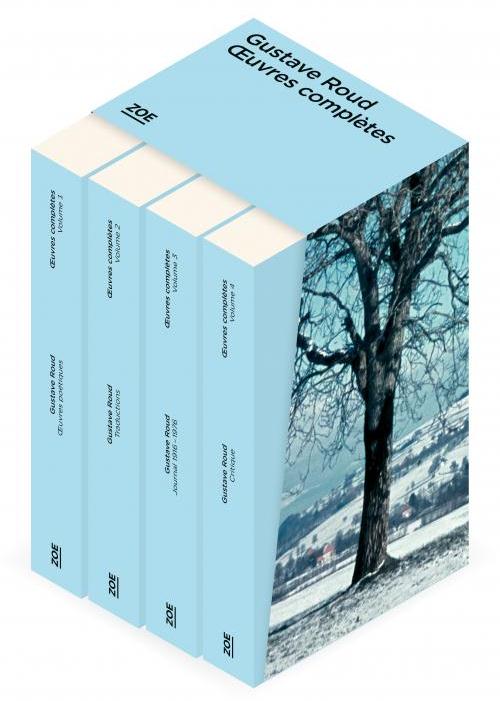
Daniele Maggetti : "J’ai
commencé à lire Gustave Roud pendant mes études à l’université de
Lausanne, dans les années 1980. J’y suis venu depuis la Suisse italienne
pour étudier la littérature française, en ignorant que la formation
qu’on y dispensait offrait la possibilité d’aborder les écrivains de
Suisse romande. Je n’en connaissais aucun, et de fil en aiguille, je me
suis spécialisé dans ce domaine, en m’intéressant aussi de plus en plus
au travail d’édition et aux archives. En 2003, j’ai été nommé professeur
à Lausanne, et directeur du Centre de recherches sur les lettres
romandes, devenu en 2019 Centre des littératures en Suisse romande. Il
s’agit d’un institut dont une des vocations est la conservation et la
valorisation d’archives d’auteurs en relation avec la vie littéraire de
la Suisse francophone. C’est là qu’est conservé le fonds d’archives
Gustave Roud. Dès mon entrée en fonction, j’ai lancé plusieurs projets
de publication de correspondances de Roud, j’ai régulièrement inscrit
ses œuvres au programme de mes enseignements, et en 2015, j’ai mis sur
pied avec des collègues deux grandes expositions autour de son travail
littéraire et photographique. Le chantier des œuvres complètes, qui a
été soutenu par le fonds national suisse de la recherche, est en quelque
sorte l’aboutissement logique de cet engagement de deux décennies. Il
doit aussi beaucoup à Claire Jaquier, qui a été une des premières
chercheuses à travailler sur Roud, auquel elle a consacré sa thèse de
doctorat, et qui a longtemps présidé l’Association des Amis de Gustave
Roud".
Au regard de l’ampleur de sa
production, il apparaît manifeste qu’en plus d’être un grand poète,
Gustave Roud conjugue d’autres talents…
Daniele Maggetti : "Un
des intérêts et des enjeux de cette publication est précisément de
montrer que Roud, loin d’être uniquement un poète à la production
relativement peu abondante, a été pendant plus d’un demi-siècle un
acteur majeur de la vie littéraire suisse romande, à laquelle il a
participé de plusieurs manières – en tant que critique, collaborateur à
des entreprises éditoriales, traducteur, photographe…. De plus, il a été
pendant près de trois générations au cœur d’un réseau d’échanges
intellectuels d’une grande richesse, ce dont témoigne sa
correspondance". |
Comment considérer le travail de
traduction réalisé par Gustave Roud ? Vers quels auteurs allait sa
préférence ?
Daniele Maggetti : "Roud
a dû effectuer des traductions alimentaires, qu’il ne signait en général
pas, et aussi, dans le même esprit, accepter des travaux occasionnels
liés à ses engagements dans le monde éditorial. Mais cela est à mettre
sur un tout autre plan que les traductions auxquelles il s’est consacré
volontairement, et qui relèvent d’un choix électif. Le noyau central en
est constitué par les romantiques allemands, en premier lieu Novalis et
Hölderlin, auxquels s’ajoute à partir des années 1940 Georg Trakl ;
Rilke a été une suggestion de son éditeur, Henry-Louis Mermod. Outre
qu’à de nombreux poètes de langue allemande, Roud s’est également
intéressé à des auteurs de langue italienne – qu’il a apprise en
autodidacte".
Comment appréhender selon vous
cette œuvre immense ? Quel(s) ouvrage(s) recommanderiez-vous pour entrer
dans l’œuvre de Roud ?
Daniele Maggetti : "L’œuvre
de Roud est d’une grande cohérence, et ses positionnements personnels et
esthétiques la traversent tout entière. Dans un premier temps, la
plongée dans quelques-uns de ses recueils est indispensable : je
conseillerais Adieu, qui est très bref, Air de la solitude, Requiem et
Campagne perdue. Si l’on veut approcher au plus près sa trajectoire
intime, on peut se lancer dans la lecture de son Journal, qui constitue
à la fois l’accompagnement et l’envers de son travail littéraire".

La sensibilité et poésie de
Roud peuvent-elles être pleinement appréciées sans connaître le contexte
géographique de la Suisse romande qui les ont vues naître ?
Daniele Maggetti : "Il
y a certes dans l’œuvre des éléments contextuels, que notre édition
permet du reste d’appréhender. Mais comme tout écrivain de qualité, Roud
peut être lu sans être familier de la Suisse romande : les réalités
qu’il aborde et les questions qu’il creuse ont une portée esthétique et
existentielle accessible à n’importe quel lecteur. On ne s’interroge pas
de cette manière à propos de Jane Austen et de la campagne anglaise, de
Lorca et de l’Andalousie, de Pirandello et de la Sicile, de Flaubert et
de la Normandie…"
Quel legs Roud a-t-il laissé
quant à son travail photographique ? A-t-il contribué à conserver une
mémoire « ethnographique » à jamais révolue ?
Daniele Maggetti : "Le
fonds photographique Gustave Roud présente de nombreuses facettes qui
n’ont jusqu’à présent été commentées que de manière partielle. L’aspect
que l’on peut appeler ethnographique en est en effet une : étant donné
qu’il a fixé la réalité et les évolutions des campagnes de 1920 à 1970
environ, il est un témoin exceptionnel – et impliqué – d’une mutation
aux implications multiples, à laquelle il réfléchit également dans
plusieurs de ses textes. Cette piste mérite dès lors d’être suivie".
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
www.editionszoe.ch/livre/oeuvres-completes
www.gustave-roud.ch |
|
Hommage
Interview Roberto
Calasso (1941 - 2021)
Milan
|
|

©Lexnews
|

©Lexnews |
|
Notre revue a eu le grand plaisir de
rencontrer le grand écrivain et éditeur italien Roberto Calasso aux
éditions Adelphi qu'il dirige en plein coeur de Milan. Entouré de
manuscrits et de tous les livres qu'il a publiés en cinquante ans
d'expérience, l'intellectuel a bien voulu retracer son riche parcours
dans le monde de la littérature et des sciences humaines, parcours qui a
permis d'élaborer une oeuvre cohérente formant un tout indissociable, un
peu à la manière du catalogue Adelphi, et dont le lecteur sait - ô
combien - ou en découvrira de manière initiatique toute la richesse.
 otre enfance et
adolescence ont été placées sous le signe de la littérature et de la
philosophie. Quels souvenirs gardez-vous de ces années toujours
essentielles ? otre enfance et
adolescence ont été placées sous le signe de la littérature et de la
philosophie. Quels souvenirs gardez-vous de ces années toujours
essentielles ?
Roberto Calasso :
"La littérature a en effet été essentielle, en soi, depuis toujours. Il
est vrai que je suis né dans un environnement où les livres étaient
omniprésents. Mon grand-père était professeur de philosophie à
l’université de Florence et mon père enseignait l’histoire du droit
également à l’université. J’ai ainsi un souvenir précoce de ces reliures
de livres écrits en latin. Par la suite, mon intérêt s’est porté vers de
nombreux autres domaines que la littérature, notamment l'anthropologie, la
philosophie, l'histoire, et j’en oublie beaucoup... Je lisais sans
exclusivité avec en particulier une attirance pour la Grèce et sa riche
mythologie. Les choses que j'ai pu écrire plus tard étaient déjà
présentes, en effet, dans ces années de formation. Même l'Orient et l'Inde
étaient déjà là.. Mais les livres n’étaient pas tout. J’ai eu également
une passion dévorante pour le cinéma..."
Très jeune également, vous avez rejoint le monde de l’édition avec
votre entrée à Adelphi, maison que vous dirigerez à partir du début des
années 70. Quels liens, apparents - et moins visibles - avez-vous
progressivement trouvés entre le monde de l’édition et votre propre
création en tant qu’écrivain ?
Roberto Calasso :
"Les éditions Adelphi ont commencé en 1963, et 2013 a marqué son
cinquantenaire. J'étais déjà présent avant même que l'on ait l'idée de
donner ce nom à ces éditions. C’est Roberto Bazlen qui m'en a parlé le
premier et j'en suis officiellement devenu le directeur éditorial en 1971,
mais je peux dire que j'ai participé à ces éditions dès le commencement.
Quant aux rapports entre mon propre travail en tant qu'écrivain et celui
d'éditeur, c'est toujours une question délicate. Comme je vous le
rappelais, une branche de ma famille était plutôt du côté universitaire et
l'autre du côté éditorial, mon grand-père avait même déjà réuni ces deux
aspects en fondant également une maison d'édition très ambitieuse et qui
existe toujours, La Nuova Italia, où l'on publiait des classiques
de la philosophies et quelques grands ouvrages d’historiens et de
philologues… Le monde de l'édition a toujours été très présent dans la
famille. C'est donc assez naturellement que je me suis lancé dans une
telle entreprise.
Si l’on regarde le riche catalogue de cette maison, on ne peut qu’être
surpris par son extrême diversité : Le récit du Pèlerin d’Ignace de
Loyola cohabite avec l’Ecce homo de Nietzsche, l’univers de Kafka a
pour voisin ceux mythologiques d’un George Dumézil. Comment
appréhendez-vous l’étendue de ce catalogue qui ne doit rien au hasard ?
Roberto Calasso :
"J'ai en effet moi-même traduit les deux livres que vous évoquez au début
de votre question. Je pense qu'il n'y a rien de fortuit et que ce sont des
choses nécessaires, me semble-t-il, qui m’ont conduit à de telles
publications. Cela correspond aux idées générales de celui qui a été à
l'origine d’Adelphi, je veux parler de Roberto Bazlen. Une de ses idées
essentielles était ce qu'il appelait le livre unique, à savoir des livres
conçus comme des expériences décisives pour l'auteur, et qui coïncidaient
avec ce livre. Un des premiers exemples publiés de ce genre d'ouvrage a
été le roman L’autre côté d’Alfred Kubin ; Kubin était un grand
dessinateur et peintre, mais qui pendant quelques mois de sa vie a été
obsédé par l'écriture de ce livre, qui est son seul roman. Je vous ai cité
Kubin, mais il faudrait également souligner les oeuvres de Walser, Potocki
, Gosse , Burney , et réserver bien sûr une attention toute particulière à
Nietzsche et Kafka. Cette idée de livre unique si chère à Bazlen a permis
l’élaboration du catalogue des éditions d’Adelphi, et pour ce travail nous
avons essayé de rendre évidents les liens entre le texte, le papier, les
choix graphiques, les quatrièmes de couverture ainsi que les couvertures
même restent essentiels. En effet, cela ne relève donc pas du hasard, mais
plutôt de cette lente construction dont chaque livre publié par Adelphi
participe et vise, patiemment, à une cohérence dans la diversité.
___________________________
"...J'ai beaucoup de mal à juger
moi-même de la géométrie de tout cela, comme l’ensemble touche des
points qui sont manifestement très éloignés. Ils sont néanmoins, selon
moi, en relation très étroite, et c'est ce que j'essaye de démontrer...
Je pense que c'est le lecteur qui doit les découvrir avec l'auteur."
___________________________
Vous avez entrepris avec La ruine de Kasch une longue réflexion
qui vous a mené jusqu’au dernier livre récemment publié en français La
Folie Baudelaire. Votre pensée ne prolonge-t-elle pas le fil d’Ariane
dans le labyrinthe non seulement de l’héritage classique, mais aussi de la
modernité ?
Roberto Calasso :
"Le sixième livre en France - La Folie
Baudelaire - évoque la figure de Baudelaire et de Paris au XIXe
siècle. Mais le septième qui sort chez Gallimard s'appelle L'ardeur,
et a pour objet la matière védique et les plus anciens textes indiens. Mes
livres passent ainsi d'un tableau à un autre, assez éloignés , d’un livre
spécifiquement grec, Les Noces de Cadmos et Harmonie, au Rose
Tiepolo, qui évoque un peintre du XVIIIe siècle à Venise, alors que
K. a Kafka pour personnage central… J'ai beaucoup de mal à juger
moi-même de la géométrie de tout cela, comme l’ensemble touche des points
qui sont manifestement très éloignés. Ils sont néanmoins, selon moi, en
relation très étroite, et c'est ce que j'essaye de démontrer... Je pense
que c'est le lecteur qui doit les découvrir avec l'auteur."
Vos livres n’hésitent d’ailleurs pas à se renvoyer les uns aux autres,
mosaïque à multiples dimensions. Toujours en référence à Baudelaire,
comment appréhendez-vous l’analogie et la correspondance dans votre
démarche ?
Roberto Calasso :
"Oui, l'analogie est un mot très important pour moi. Il ne s'agit pas
uniquement d'une question de rhétorique, mais d’une voie de la
connaissance. C'est ce que l'on devrait trouver, avec différentes
versions, dans les différents volumes. Dans les textes védiques, par
exemple, on ne parle pas spécifiquement d'analogie, mais de bandhu,
qui signifie connexion, lien, mais cela rejoint assez étroitement
l’analogie à laquelle se référait Baudelaire. Vous voyez que tout cela est
lié. L'idée la plus importante sur le plan formel est que ce livre devrait
être autosuffisant, c'est-à-dire donner tout ce qu'il faut au lecteur,
mais si l'on veut avoir une autre dimension, il faudra alors le mettre en
rapport avec les autres pour découvrir de nouvelles choses."
Ce que vous dites fait penser à cet épisode du Palais-Royal à la fin de
La ruine de Kasch…
Roberto Calasso :
"Oui, c’est un très bon exemple, car le Palais-Royal est une image très
forte pour moi. La ruine de Kasch que vous évoquez est un peu la
pépinière de tout, le livre à partir duquel toutes les branches sont
parties. Si vous prenez La Folie Baudelaire, vous retrouvez au
centre de ce livre ce rêve du « bordel-musée » de Baudelaire, qui est une
sorte de Palais-Royal à l'intérieur - même si je ne le dis pas
explicitement. J'aimerais que le lecteur s'en rende compte par lui-même,
je le mets en rapport avec une image que l'on trouve dans La ruine de
Kasch et qui est liée à Baudelaire également. En effet, dans son essai
De l’essence du rire, Baudelaire parle de la Virginie de Paul et
Virginie qui se promène dans le Palais-Royal et découvre le mal et le
vice. Ces deux apparitions sont très liées et sont pourtant éloignées si
l’on pense que La ruine de Kasch est parue en 1983 alors que La
Folie Baudelaire est parue près de trente ans après. Je pense en effet
que l’on peut garder cet exemple pour montrer de quoi je parle…"
__________________________
"La conscience à travers les
mythes est en effet le grand thème, une notion autour de laquelle tous
mes livres tournent d'une certaine manière.
___________________________
La conscience, la légitimation du pouvoir
et ses conséquences, la possession, la culpabilité, le sacrifice, la
métamorphose… sont autant de thèmes essentiels de vos livres.
Roberto Calasso :
"La conscience à travers les mythes est en
effet le grand thème, une notion autour de laquelle tous mes livres
tournent d'une certaine manière. Le pur fait d'être conscient est quelque
chose qui paradoxalement est devenu un sujet hot pour les hommes de
science en ces dernières années, vous avez des centaines de livres où le
mot consciousness apparaît sans grand résultat, me semble-t-il,
jusqu'à maintenant, alors même que des textes aussi anciens que les
sources védiques – je pense par exemple aux Upanishads - avaient déjà
abordé ces questions depuis bien longtemps. Il est donc difficile de
passer à côté de cette notion de conscience en raison de l'aveuglement
occidental sur ces questions. A la fin du XIXe siècle la science
prétendait-et c'était une grande erreur comme nous l'avons constaté par la
suite -que cette notion était un épiphénomène. Mais ce qui m'a intéressé
en priorité au-delà de tout cela, c'était de constater que depuis ces
temps immémoriaux nous étions toujours confrontés à la même question.
L'autre notion également essentielle que vous évoquez – la légitimation du
pouvoir - est au commencement de La ruine de Kasch. (...) |
Le dernier livre de Roberto Calasso
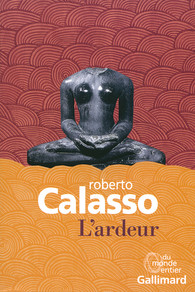
L'ardeur [L'ardore] Trad. de
l'italien par Jean-Paul Manganaro, Collection Du monde entier, Gallimard,
2014.
Quelque chose
d'immensément loin de notre présent est apparu il y a plus de trois mille
ans dans l'Inde du Nord : le Veda, un «savoir» qui englobait tout en lui,
depuis les grains de sable jusqu'aux confins de l'univers. Cette distance
transparaît dans la manière de vivre chaque geste, chaque parole, chaque
entreprise. Les hommes védiques accordaient une attention adamantine à
l'esprit qui les soutenait et qui ne pouvait être disjoint de l'«ardeur» à
partir de laquelle, pensaient-ils, le monde s'était développé. L'instant
prenait sens dans sa relation avec un invisible qui débordait de présences
divines. Ce fut une expérimentation de la pensée si extrême qu'elle aurait
pu disparaître sans laisser aucune trace de son passage sur la «terre où
erre en liberté l'antilope noire» (c'est ainsi que l'on définissait le
lieu de la loi). Et pourtant cette pensée – un enchevêtrement d'hymnes
énigmatiques, d'actes rituels, d'histoires de dieux et de fulgurations
métaphysiques – a l'indubitable capacité d'éclairer d'une lumière rasante,
distincte de toute autre, les événements élémentaires qui appartiennent à
l'expérience de tout un chacun, aujourd'hui et partout, à commencer par le
simple fait d'être conscient. Elle entre ainsi en collision avec nombre de
ce que l'on considère désormais comme des certitudes acquises. Ce livre
raconte comment, à travers les «cent chemins» auxquels fait allusion le
titre d'une œuvre démesurée et capitale du Veda, le Satapatha Brāhmaṇa, on
peut retrouver ce qui sous nos yeux en passant par ce qui est le plus loin
de nous.
_______________________
(...) Le livre commence en effet par un coup de maître, celui de
Talleyrand entre les dernières années de l’Ancien Régime et 1848. Il
savait bien ce qu'était la légitimité du pouvoir, dans le sens où
l'entendait l'Ancien Régime, à savoir la sacralité du pouvoir. Avec une
effronterie étonnante, il a réussi à renverser la situation. Lorsqu'il
s'est présenté au Congrès de Vienne comme représentant du pouvoir qui
avait été battu, il a imposé ses vues pour faire accepter l'idée d'une
nouvelle légitimité fondée sur la Convention, avec deux ou trois règles,
assez simples, et qui devaient permettre d’assurer l’ordre. Ce qui est
merveilleux, c'est que l'on ne s'est pas aperçu de cela. On a cru que
c'était la continuation de l'ordre ancien, alors que c'était l'acte le
plus téméraire, qui allait définitivement balayer l'ordre ancien. De
manière tout à fait arbitraire, Talleyrand a inventé une nouvelle forme de
légitimité. C'est une chose d'autant plus énorme qu'elle est passée
inaperçue. Tous les historiens ont souligné combien le congrès de Vienne
était un retour au passé, une restauration, alors que c'était le premier
pas vers une direction où nous sommes encore aujourd’hui . Après deux
cents ans de pratique de ces règles introduites par Talleyrand, nous
pouvons constater que cela ne fonctionne plus. Mais en même temps, si l'on
y réfléchit, que sont les Nations Unies ou la Communauté européenne sinon
une tentative gauche d'établir une légitimité ? Les États-Unis ne font pas
autre chose que de chercher ce que le génie de Talleyrand avait trouvé
dans le passé. Cela veut dire que sans la légitimité rien ne marche, et en
même temps cela veut dire que les hommes ne sont pas capables de parvenir
à trouver une solution."
Cela rejoint ce que disait le grand juriste autrichien Hans Kelsen :
Qui soulève le voile sans fermer les yeux verra, au contraire, la tête de
Gorgone du pouvoir plonger son regard dans le sien.
Roberto Calasso :
"Absolument, Kelsen est un bon exemple, car il a cherché et trouvé un
mécanisme formel qui garantissait l'ordre, même si cela n'a pas
fonctionné. Le problème est énorme et la chose la plus paradoxale est que
tout cela est passé inaperçu. Si la Première Guerre mondiale a éclaté,
c'est bien que le mécanisme de Talleyrand n’était plus opérant. A mon
avis, c'est le problème même de toute pensée politique et c’est pourquoi
j’ai placé le mot védique rta au commencement de La ruine de
Kasch, mot qui signifie en même temps ordre et vérité. C'est autour de
ce mot que tout tourne. Chaque pensée, qu'elle soit de Platon, de Spinoza
ou encore de Kafka, revient toujours à ce terme. À la fin du Château
de Kafka, vous trouvez ce dialogue merveilleux entre le conseiller Bürgel
et K. où Bürgel évoque ce qu’il appelle la Weltordnung, qui est la
traduction même de rta, l’ordre du monde. Vous voyez alors que ce
n'est pas une question de date, mais bien effectivement quelque chose de
récurrent. Le passage décisif, la vraie différence entre le monde
archaïque et la modernité, peut être symboliquement situé autour des
années de la Révolution française."
La possession est également une notion importante dans votre réflexion.
Roberto Calasso :
"C'est en effet une notion très importante puisqu'elle est liée justement
à la conscience que nous évoquions auparavant. La conscience très souvent
est conçue comme si elle dépendait d’un moi qui serait une sorte de
petit bloc uniforme et compact, ce qui est une illusion totale. Ce qui
agit dans chaque sujet est quelque chose de beaucoup plus complexe. Il y a
toujours une dualité, ce qui était très clair dans les textes védiques et
qui deviendra moins clair dans le cours de l'histoire occidentale. Il faut
remarquer qu'il est beaucoup plus facile, d'un point de vue pratique,
d'agir sur des individus entendus comme des entités compactes que de
prendre en compte leur diversité et complexité…"
La culpabilité et le sacrifice tiennent également une place importante
dans votre œuvre.
Roberto Calasso :
"Ce sont en effet des notions qui sont présentes dès les premières pages
de La ruine de Kasch, car ce sont non seulement des choses qui sont
liées, mais qui tendent à coïncider : le sacrifice est la culpabilité.
C'est une manière de mettre en mouvement cette chose essentielle qu'est la
culpabilité. C'est un thème en effet inépuisable, et je dois vous avouer
que ce thème est de nouveau présent dans mon dernier livre – L’ardeur
- même s’il est abordé dans un autre contexte. C'est une chose qui va très
loin et qui nous oblige à passer non seulement dans l'histoire très
ancienne, mais également dans la Préhistoire. Nous avons, me semble-t-il,
une idée tout à fait insuffisante de ce qui s'est passé avant la
révolution néolithique. C'est évidemment un domaine très difficile à
explorer pour des raisons évidentes, mais il faut avoir le courage de dire
certaines choses et elles sont liées à cette idée de sacrifice dont nous
parlons. Le sacrifice, quand il apparaît dans les civilisations les plus
archaïques, est en quelque sorte un livre d’histoire. C'est un domaine où
il faut être très prudent, mais les progrès de la paléoarchéologie des
cinquante dernières années permettent d'aller plus loin que cette vision
des hommes primitifs comme des sortes de brutes… Je pense que le problème
essentiel réside dans la chasse, c'est la clé de tout. Et par chasse il
faut entendre quelque chose de beaucoup plus large que ce que le terme
implique généralement. Le rapport à l'animal est un thème inépuisable : la
mythologie grecque ne peut pas être comprise si l'on ne considère pas ce
rapport à l'animal. Or, au XIXe siècle, on a pratiqué le contraire, en
analysant la civilisation grecque du seul point de vue de l'humanité, sans
considérer ces éléments préhistoriques que l’on continuait d’occulter. Il
me semble que c'est un malentendu très important. D'ailleurs, cette
attitude a été contredite par les documents et les sources. Cela ne
revient pas à nier l'idée selon laquelle la Grèce dans les siècles
classiques aurait inventé un profil anthropologique tout à fait à part par
rapport à ce qui s'est passé dans le reste de la Méditerranée à la même
époque. Mais si l’on oublie ce rapport avec les animaux, on est perdu et
l’on devient humaniste. Ce qui n’est pas un bon signe ..."
__________________________
"Il n'y a rien qui aille au-delà
de la mythologie grecque. Seul un petit fragment de cette richesse est
passé dans la conscience européenne, une grande partie a été perdue,
sans parler de ce qui n’a pas encore été perçu."
_______________________
Ce rapport est alors un immense réservoir d’échos littéraires…
Roberto Calasso :
"Naturellement, il n'y a rien de plus beau
que ces histoires-là. Il n'y a rien qui aille au-delà de la mythologie
grecque. Seul un petit fragment de cette richesse est passé dans la
conscience européenne, une grande partie a été perdue, sans parler de ce
qui n’a pas encore été perçu."
Comment percevez-vous le baromètre culturel de notre époque et quel est
votre jugement à cet égard – pessimiste ou optimiste ?
Roberto Calasso :
"J'ai envie de répondre à votre question
avec une notion de météorologie, à savoir la dépression…(rires). C'est une
très étrange dépression effervescente, peut-être la chose la plus
originale du moment. Nous connaissons une surcharge de mouvements
apparents et en même temps le cerveau n'est pas à la hauteur de ce qui se
passe. Par effervescence, je pense à ce que j'appelle l'âge de
l'inconsistance, le manque de substance."
Une certaine vacuité ?
Roberto Calasso :
"Oh non ! Si nous connaissions la vacuité, cela ne serait déjà pas mal !
Cela dit, il y a encore beaucoup de choses à découvrir."
Nous ne ferons pas l’exercice impossible - et presque illimité - de
l’évocation de votre bibliothèque qui est déjà présente dans toute votre
œuvre nourrie d’une connaissance sans frontières, quels seraient par
contre les fondamentaux que vous estimeriez d’une bibliothèque de
l’honnête homme du XXI° siècle ?
Roberto Calasso :
"Il me semble que le catalogue d’Adelphi peut répondre d'une certaine
manière à votre question. Nous sommes partis avec cette idée égoïste de
publier des livres qui nous étaient essentiels en espérant que cet intérêt
serait de plus en plus partagé. Les cinquante dernières années ont montré
qu'un grand nombre de ces ouvrages avait eu un écho, même s'ils n'étaient
pas populaires à leurs débuts. Il n’y a pas de caractère systématique dans
nos choix éditoriaux, mais plutôt cette idée de livres qui se font écho et
se rejoignent les uns les autres, par des liens que nous avons ressentis
et que nos lecteurs pourront – nous l’espérons - à leur tour découvrir."
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
www.adelphi.it
|
|

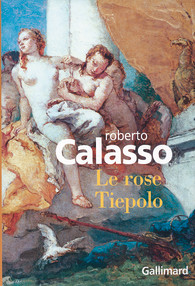
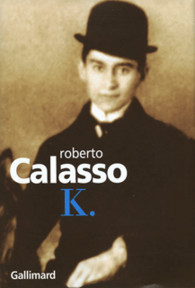
|
|
© Lexnews
|
|
Entretien Pierre Voélin
Réponses du matin à des questions du soir
9/12 octobre 2020 |
|
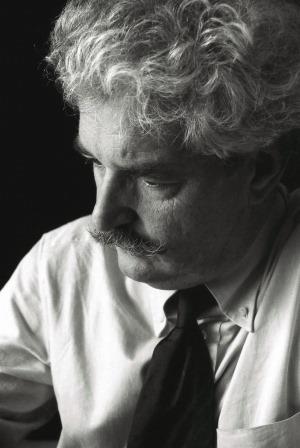 |
 |
|
Le poète Pierre Voélin aspire à une « langue de
mémoire », une langue qui précède et dont le verbe anticipe la
rencontre. Le poète interroge, convoque parfois, dans une nature qui est
à la fois langage, mémoire et oubli, et qui traversent ensembles le
vent. Le secret et le silence ponctuent ces espaces, sans mots le plus
souvent, si ce n’est ceux du poète, mais s’agit-il encore de mots ou de
maux ? A chaque page, comme à chaque souffle, le miroir de la poésie
convoque les noms de ceux qui sont chers au poète, Ossip Mandelstam,
Anna Akhmatova, Emily Dickinson, Umberto Saba, J.-B. Pontalis… en autant
de dialogues que de voix dans l’autre langue, celle qu’il nous
appartient de découvrir grâce à cette admirable poésie tendue
vers ce qui unit. Rencontre avec Pierre Voélin à l'occasion de la
parution de deux recueils aux éditions Fata Morgana, "Les bois calmés"
(initialement paru à La Dogana) et "Arches du Vent".
* * *
« Seul l’amour ressemble à Dieu : seul il étonne l’Éternité. »
Pierre Oster

Quel souvenir de votre première
rencontre avec la poésie de la langue ? Comment cette présence
s’est-elle par la suite renforcée, affinée ?
Pierre Voélin :
"La poésie de la langue, une rencontre - première ? Il faudrait sans
doute remonter à l’écoute des voix adultes dans la prime enfance, et le
mystère des vocables qui sont présents avec leur nimbe, leur
demi-résolution, leur ombre, et cette merveille d’un jeu de syllabes qui
vont et viennent, et s’écoulent dans la bouche des aînés avec la
facilité d’une eau courante ; viendraient juste après, à sept ans, le
sérieux de l’apprentissage du syllabaire, des formes, le non moins grand
mystère des Lettres individualisées, ces lettres découvertes une à une,
et ce pouvoir si heureux de les transcrire, une plume à la main; puis
les emplois particuliers du langage dans les poèmes que l’on apprend par
cœur, vers dix ou douze ans, mettons Jean de La Fontaine : « Le long
d’un clair ruisseau buvait une Colombe… » et beaucoup d’autres très
subtils usages dans l’espace de la langue; la saveur des expressions
archaïsantes chez Brassens, par exemple.
Enfin l’on change d’étage ! La langue, cette fois-ci, nettement déportée
vers une poésie quasi officielle, au cours de la quinzième ou seizième
année : la découverte dans la bibliothèque paternelle ( le père
lui-même, un poète qui publie de temps à autre ) des Fleurs du mal
et d’une Saison en enfer, deux livres expurgés de leurs pages
sulfureuses à coups de ciseaux, stimulant par là même une recherche
active jusqu’à peut-être L’Album zutique, poissant les mains,
gelant le coeur. Et la découverte de cette avant-dernière page de la
Saison qui va être plus tard le socle de la poétique : « Moi ! moi
qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au
sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre !
Paysan ! » Et soit dit en passant, quelle bouffonnerie, le contemporain,
d’imaginer Rimbaud au
Panthéon ! )
Plus tard, le lycée, la si adéquate «
formation classique », les « humanités » où l’on rencontre, pour choisir
un auteur, un seul, Jean Racine ; et très vite des « soirées-poésie » à
Porrentruy, en Ajoie, présidées par quelques vrais et admirables
lecteurs qui viennent avec leur provende sous le bras, s’assoient, et
lisent, tout simplement. Découverte éblouie dans la nuit d’hiver de
quelques poètes aux propositions renversantes : Michaux, Char, Ponge,
Eluard… Le suivi, ce sont, au fur et à mesure de leur parution, les
livres de la collection de poche Poésie/Gallimard ou quelques-unes des
monographies que publie Seghers.
Et là… je m’y suis mis : la poésie serait dorénavant mon affaire, bien
qu’absolument secrète ; après les années d’une existence enfantine très
protégée ( quoique l’inquiétude soit la part de l’enfant sensible ), une
adolescence solitaire et campagnarde, naît un lecteur plutôt paresseux,
mais fervent.
C’est la densité de la poésie de René Char, que je lis allègrement, et
la longue méditation de son attitude durant la guerre, et juste après…
qui vont compter - tandis que je longe la berge du Rhône, à
Saint-Maurice d’Agaune, en terminale. Là, j’ai compris que je pourrais
moi aussi resserrer les vocables, les nouer fortement, inventer une
syntaxe elliptique etc… l’éblouissement durable devant la face
héraclitéenne de cette poésie, et l’éclat de ses fulgurances. J’y
consacrerai plus tard un travail universitaire, avant de m’éloigner".
* * *
Hommage aux herbes des grands chemins
aux orties des ravins – aux fétuques
le long des sentiers secrets
à la frêle épilobe
fleur de l’incendie et de l’oubli
Survivre – et se hâter
à la bouche ce goût de solitude
et sur l’épaule un pâle chandail de cendres
((Pierre Voélin "Arches du Vent"
Fata Morgana, 2020)
* * *
De quelle manière le monde s’est-il
présenté à vous dans votre jeunesse et quelles en seront ses influences
par la suite sur votre poésie ?
Pierre Voélin :
"J’ai donc lu très tardivement ; chez moi, il y a d’abord le réel, je
veux dire le fait physique de la puissante nature, les campagnes
secrètes, la profusion de cet univers physique qui va des lichens sur
les roches au grillon qui stridule sous les constellations, des ondes
gravitationnelles jusqu’à l’appel du loriot – il s’écoute jusqu’au fond
des milliards de galaxies… oui, j’ai beaucoup aimé marcher en rêveur
dans la solitude de la forêt jurassienne, je suis entré tardivement, il
faut l’avouer, dans la bibliothèque mais avec une réelle ferveur ; reste
aussi que notre père nous a très vite – nous, les trois aînés de la
famille, emmenés dans les ciné-clubs ou les expositions de peinture,
notamment à Bâle, chez Beyeler, bien avant que la Fondation ne s’exile à
Riehen. Ainsi, dans nos besaces, nous n’avons pas manqué de biscuits !
Et la rencontre de Paul Klee ou de Giacometti ne fut pas moins
importante que celle de La Boétie ou de Pascal. Même dans le retrait de
l’étude, loin de toute activité sociale, si l’on excepte brièvement le
combat politique pour la liberté du Jura, dans les marges de cette
société des « trente glorieuses », le monde apparaissait comme
fondamentalement ouvert. La guerre du Vietnam nous semblait un
combat naturel, un combat à gagner, un combat possible, et même
indispensable, contre les Yankees et leur politique au napalm, les héros
admirés de quarante-cinq devenus très vite les bourreaux du peuple
inspiré par Hô Chi Minh. Soit le communisme en tongs, le communisme à
l’air candide, si simple, si courageux, et si féroce !
Mais il y a l’âme de l’enfant, et son trouble jusqu’au cœur d’une
enfance - la visite de Dachau, à onze ans, en compagnie de mes parents
et de mon grand-père maternel. Un trauma qui allait, si je puis dire,
porter ses fruits beaucoup plus tard, devenir la matière même d’un souci
quotidien, celui-ci d’abord affectif, ensuite proprement intellectuel,
une énorme masse d’un savoir à méditer. La question de la Shoah
comme un sentiment profond d’asphyxie, sans doute jusqu’à la fin de mes
jours. Une honte en moi aux accents universels, une honte envahissante,
et plus tard la violence de cette lutte contre l’antisémitisme n’ayant
d’équivalent que celle contre toute espèce de communisme, et le regard
pitoyable jeté sur la comédie des camarades déguisés en zélateurs de
Mao. La lecture de dizaines et de dizaines d’ouvrages et d’analyse du
phénomène totalitaire en commençant pas Hannah Arendt sans oublier le
précieux Simon Leys, ou encore Claude Lanzmann, pour ne citer que trois
noms, entre beaucoup d’autres.
La découverte des Mandelstam, la longue méditation de leurs actes, de la
parole du poète surtout ; la première rencontre de ce couple dans la
revue jésuite, les « Études » ; oui, Nadejda et Ossip, allaient
me redonner une suffisante confiance en l’homme, en moi d’abord, pour
que j’adresse au monde comme dit Emily Dickinson une « Lettre qu’il n’a
pas reçue », à savoir mes premiers poèmes, tirés de Lierres, en
1982, à l’âge de trente-trois ans, dans La Revue de Belles-Lettres,
à Genève".
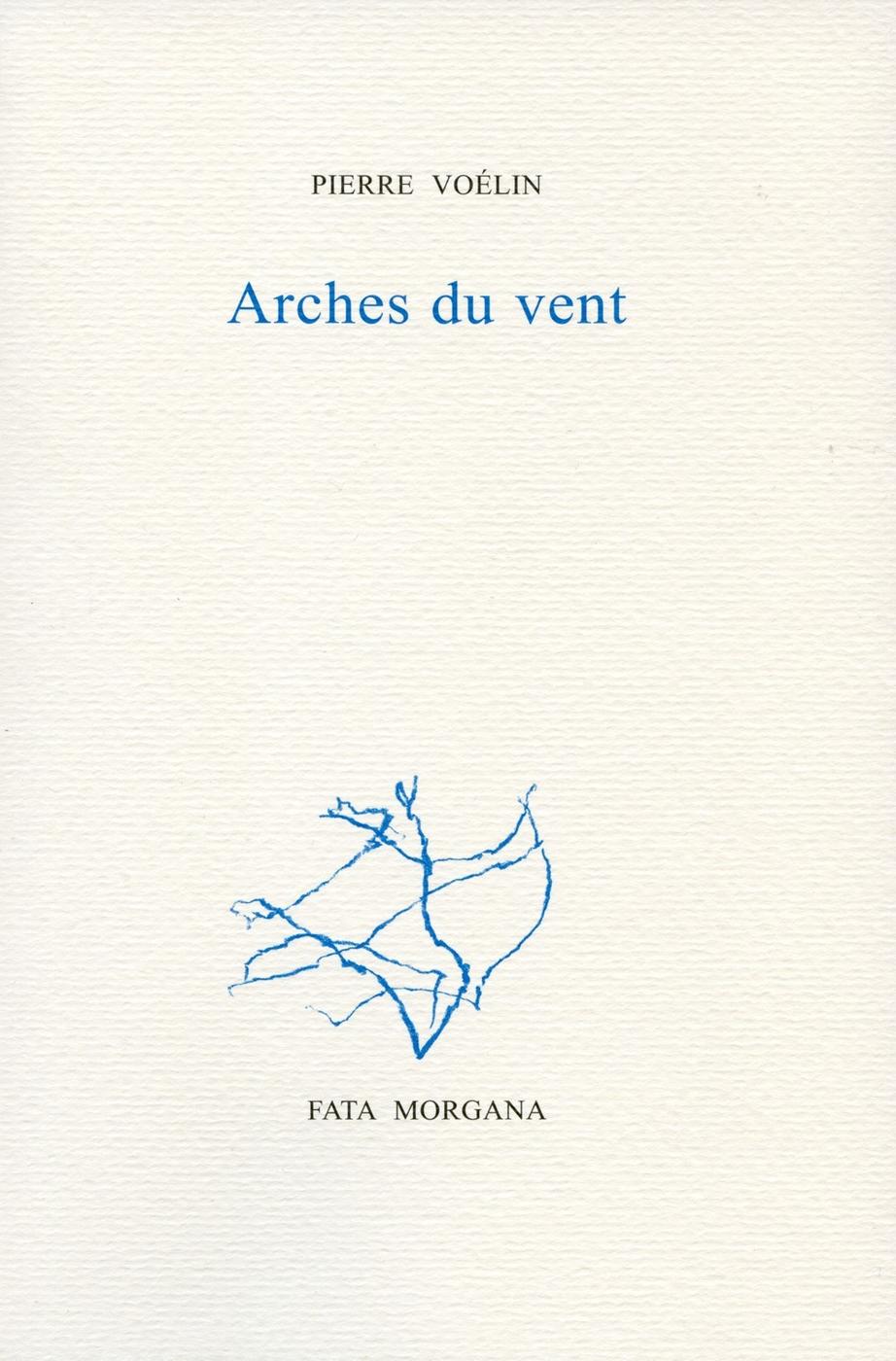
A quelle source puisez-vous
votre inspiration ? La nature semble avoir une grande place en
contrepoint des contingences des vies humaines, mais non point une
nature entendue en un sens bucolique mais en des accents tragiques…
Pierre Voélin :
"Et puis une première remarque : la nature, un bien grand mot, on ne
peut pas se laisser subjuguer par ses dimensions extravagantes, et dans
un texte elle n’est présente que sous la forme d’une multitude de
signes, divers et contradictoires ; voici ce que m’en écrit une amie,
poète elle-même ( elle parle de Arches du vent ) : « Il n’y a pas
« la nature » ou « des paysages » dans tes poèmes mais de l’espace,
un espace en mouvement : des vents qui soufflent, des fleuves, des vols
d’oiseaux, des pluies, des étoiles en voyage, des galops de pouliche,
des sous-bois… ciels d’orage… et tendres lumières « où tremble un cœur
fragile… ». |
Si la nature est si extraordinaire, en sa
beauté prolifique, en son déhanchement de garce, si elle nous paraît
immuable ( je regarde par la fenêtre à cet instant un marronnier au
lourd feuillage nuancé de jaune et d’orangé, avec encore d’ultimes
nuances de vert, et cet arbre se détache sur le fond gris d’un ciel où
la pluie menace, or, ce contraste est d’une harmonie prodigieuse ), ne
pas oublier qu’elle est, cette nature, comme dit Paul de Tarse, en
gésine…et son destin n’est pas moins fragile que le nôtre. Mais il
est vrai que les saisons, le passage des saisons, peut nous fournir un
climat qui accueille nos états d’âme les plus contradictoires et les
plus cachés. Car nous avons une âme, n’en déplaise à Foucault pour
lequel l’homme n’était plus qu’une vague silhouette. Un cadavre
ambulant, un « musulman » nous expliquera Giorgio Agamben. Le monde s’en
va, indifférent, une force aveugle, rien de bucolique, n’est-ce pas, et
nous n’habitons aucune sorte de présent. Et ego in Arcadia… mais
il n’y a jamais eu d’Arcadie.
La disparition de la lumière chaque soir
contresigne notre propre effacement, notre perpétuel évanouissement, une
singerie du néant qui toujours semble nous menacer, et là est le vrai de
notre condition mortelle. On ne peut envisager de Résurrection qu’à
partir de là, notre finitude est précieuse, elle n’est jamais simplement
oubli, au contraire, elle nous éveille et ne cesse de nous remettre en
face du monde - aussi bien cette terre méhaignée dont nous aurions à
prendre soin.
Mais la vraie source d’inspiration, ce sont chaque jour, dans une
actualité féroce, la contemplation des gestes, et la méditation des
paroles, d’un Christ toujours nouveau, et qui nous précède sur tout
chemin, soleil de justice qui éclaire tous les culs de basse fosse ;
l’ordre et le désordre humain, l’inconscience et la folie, le mal
tragique aussi bien, tout cela, sans être à la source de la parole
poétique, la concerne au premier chef. Il est triste de constater que
nos contemporains ont une aussi piètre image de l’activité du poète en
ce monde, la passion de vouloir l’éliminer de la Cité, depuis Platon,
n’a fait que s’affermir. Et l’indifférence suffit bien pour conduire ce
projet insane. Mais servir la parole, et sa droiture, ce n’est pas du
mouron pour les petits oiseaux, une tâche, elle n’a jamais été aussi
urgente. La poésie est le règne de l’anti-mensonge. J’ajouterai que pour
ma part, je ne prendrais la langue, je ne l’habiterais, je ne me
servirais d’elle, que dans sa simplicité, et comme prise en son droit
fil, sans contorsion. J’ai sauté en quelque façon l’étape surréaliste,
en m’intéressant de près à ses premiers critiques, Char et Michaux et
Ponge ou Saba".
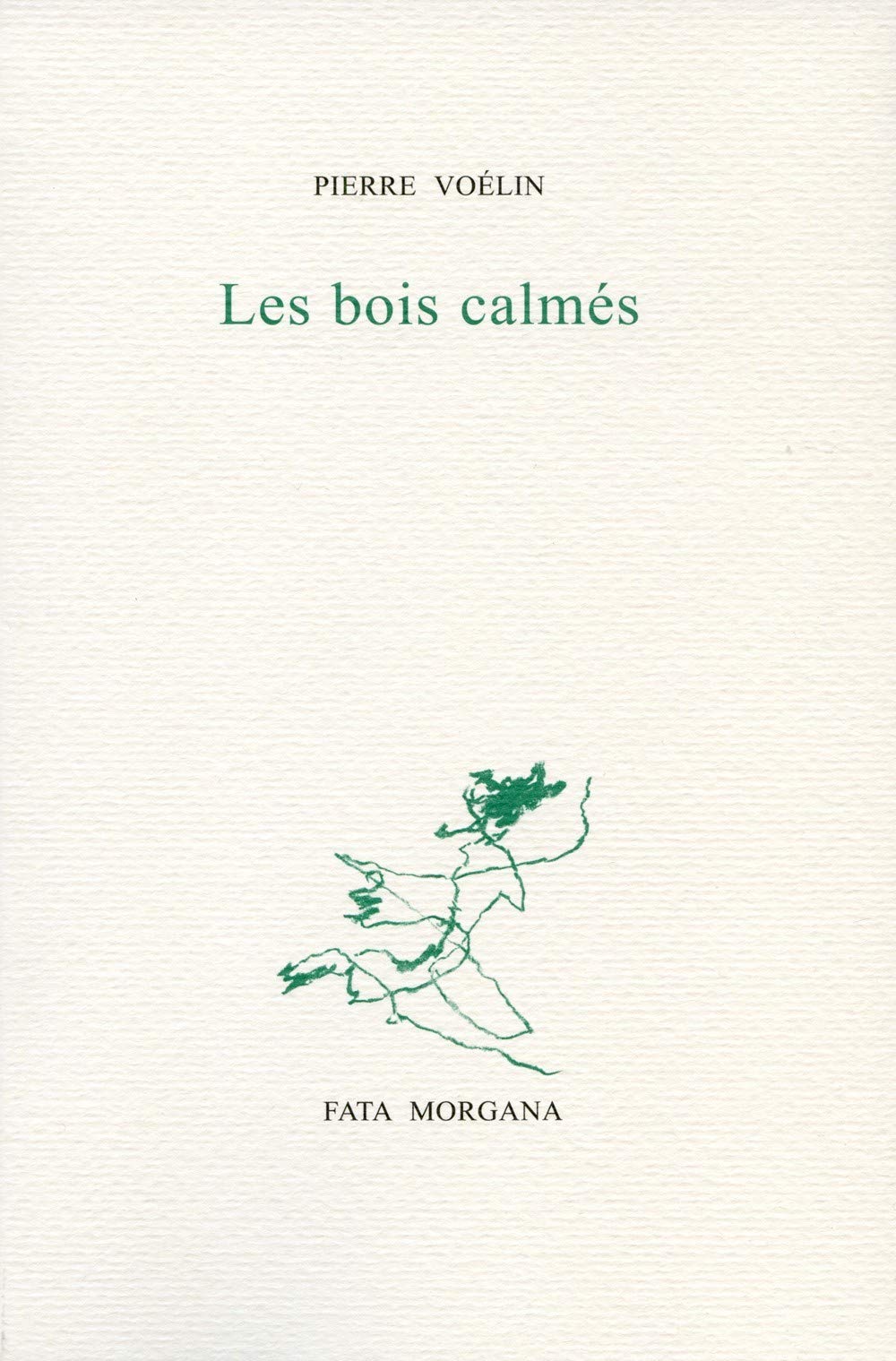
Quel rapport entretenez-vous
avec le silence et dans quelle mesure ce dernier vient-il nourrir votre
poésie ?
Pierre Voélin :
"Que de formes peut prendre le silence, et combien il nous est
nécessaire ! mais qu’a-t-on dit quand on l’a qualifié de « silence
intérieur » ? Il y aurait ce silence auquel il faut s’arracher pour
laisser dans le poème quelques traces des exactions monstrueuses sur les
théâtres de guerre, je songe à cette langue des tortures qu’il faut oser
parler, à des moments, cette langue que j’ai parlé au moment de la
guerre des Serbes en Ex-Yougoslavie, ou face aux hurlements muets durant
le génocide des Tutsis, ( nous savions tout de la sauvagerie en cours,
nous assistions aux massacres sur les barrages, les écrans ne mentaient
pas, et chaque soir notre silence grandissait, plus profond et plus
angoissant, et plus terrible… ) et il y aurait cette heureuse et toute
autre dimension du silence, celui qui perdure après l’écoute du Quintet
en ut de Schubert ou des grandes Passions de Bach ou du Requiem de
Mozart… ces gouttes de silence qui tombent et alternent avec celles,
musicales, dans le monde creusé comme un cuvier d’Arvo Pärt, ou cette
respiration des moines qui psalmodient les Heures, tout près d’ici, à
Hauterive, ou l’essoufflement de Billie Holliday, la voix éteinte, dans
l’écoute de la bande-son…
Le silence, telle une contrée à rejoindre, par-delà les bruits de la
ville, incessants – à moins de viser les trois ou quatre heures du
matin, privilège des insomniaques - quand la parole de poésie va se
lover sur elle-même, s’intensifier, durcir comme une pâte, et se déposer
sur la feuille ou sur l’écran, dans une sorte d’hypnose chez celui qui
l’a cherché de tout son être. Jean Grosjean parle admirablement de la
poésie quand il nous dit qu’elle est cet instant où le langage devient
quelque peu aveugle… On pense alors à Rimbaud, à Hopkins, à Mandelstam,
au Rilke des Élégies de Duino, à Paul Celan, à Montale, à Johannes
Bobrowski…
Le silence le plus précieux, il ne dure pas, comme cette vibration de la
flèche qui vient de se planter au cœur de la cible. C’est à la recherche
d’un tel instant, un peu miraculeux, que travaille le poète ayant pris
tous les risques, et le lecteur le mieux averti, lui qui doit en quelque
sorte refaire à distance le geste de la création, son honneur, n’en a
jamais qu’une impression plus ou moins claire, souvent mitigée".

La mémoire rythme et scande vos
poèmes, plus qu’un devoir, elle semble contribuer à souligner
l’essentiel, cet héritage murmuré par la nature ( galops des pouliches,
lierre, essaims… ).
Pierre Voélin :
"Certes le « devoir de mémoire » existe, il est même nécessaire puisque
le passé doit toujours être repensé, c’est-à-dire « peser » une fois
encore, et mesurer à sa juste valeur. Il n’y a pas eu que Nüremberg, le
faire-mémoire du génocide des Juifs européens ne s’est pas arrêtée là,
avec la condamnation des principaux responsables des massacres, et le
jugement sans appel, le refus total de leur idéologie meurtrière, il a
fallu poursuivre l’enquête et bientôt découvrir la responsabilité de la
Werhmacht, des soldats très ordinaires, dans ce que l’on appellera bien
plus tard « la Shoah par balles ». Même le massacre de Babi Yar,
perpétré par les Einsatzgruppen, en Ukraine, s’est éclairé d’un savoir
nouveau. La mémoire dans ce sens est responsabilité, une lutte sévère
contre l’oubli - pourtant ce dernier est nécessaire quand on l’envisage
sur un autre plan. Et c’est ainsi qu’une certaine mémoire est le lieu
même des solidarités et des fidélités".
La chose la plus mystérieuse jusqu’au seuil de la mort reste notre
rapport au présent – qui n’est jamais là, stricto sensu, impossible à
vivre pleinement quand c’est tout juste s’il nous est permis de
l’envisager dans l’instant, comme on craque une allumette devant
une serrure dans l’obscurité. Où est l’Être, de quelle étoffe est-il
tissé, je veux dire, hic et nunc, dans les conditions de notre
vie mortelle ? S’il est loisible de se projeter dans le futur, un devoir
et une chance, nous avons de la peine à concevoir que le passé soit
toujours là, que le passé ne passe pas, qu’il est aussi neuf que
l’avenir, qu’il est impossible de l’immobiliser, et de le garroter en
quelque sorte. Après tout, Proust déjà…
Quant à la poésie, elle fouille aussi de
ses mains délicates, depuis l’enfance, tout l’héritage secret de
l’Amour, avec ses lointains mémoriaux, ses multiples « cercles » comme
dirait mon ami David Collin. Et la nature proche, sans qu’il soit besoin
de l’idéaliser, peut bien nous offrir encore, nous prêter devrai-je
dire, ses murmures et ses parfums, une réserve de signes, bien au-delà
des sarcasmes de Rimbaud : « O Nature ! ô ma Mère ! » En l’occurrence,
c’était bien la mère seule, la pauvre mère, dépassée par le génie du
fils, le « sale gamin », l’impossible gamin, qui était visée".
* * *
La nuit reprendre cette marche à la
pourriture
longuement goûter les saveurs de la boue
Le temps – son crâne à découvert
et le tournoiement de poussières invisibles
Terre – ô terre venue justifier l’amas des corps
Rien ni personne qui puisse effacer les jours
leur noire et silencieuse calligraphie
leurs doigts écorcés.
(Pierre Voélin "Les bois calmés" Fata
Morgana, 2020)
* * *
Le temps ponctue régulièrement votre
poésie, tour à tour captif, confident, mais aussi témoin d’une sourde
inquiétude ?
Pierre Voélin :
"Le temps dialogue avec l’éternité, nous hésitons à le comprendre, nous
voulons rester sur le seuil, nous refusons d’entrer dans certaines
perspectives, celles qui font vaciller notre conscience, nos certitudes,
nos rassurements. Mais la mort est l’horizon de toute vie, et ce que
nous révèle l’Ecclésiaste, « buée des buées, tout est buée », comme
traduit délicieusement Grosjean, est la pierre de touche de nos
existences, son curieux fondement. Le poète n’y coupe pas. Rien de
l’inquiétude de chaque humain ne saurait lui être étranger. Seule compte
sa loyauté dans son rapport aux mots du texte, et à ce que ces mots
suggèrent d’un sens captif à délivrer, bref, un engagement dans la
parole, une probité dont un Philippe Jaccottet ou un Pierre Chappuis
serait à mes yeux deux emblèmes. A ce sujet, je crois que les cinq
réponses qui précèdent disent, souhaitons-le, l’essentiel".
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
|
|
Interview Michel Orcel
Dante Alighieri "La Divine Comédie - Le
Purgatoire"
La Dogana, 2020. |
|
 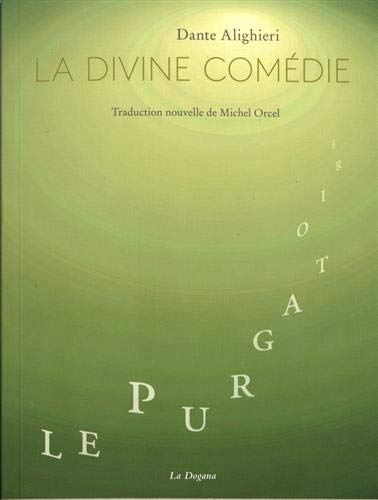
Quel a été le point de départ de cette
nouvelle traduction d’une œuvre légendaire, La Divine Comédie de
Dante Alighieri, que vous avez entreprise depuis quelques années ?
Michel Orcel : "Je
l’ai brièvement dit dans ma préface à l’Enfer, c’est
l’indignation qui m’a mû. Une sainte indignation devant des traductions
qui, soit par la complexité presque extravagante de leur langue (je
pense évidemment à Pézard) soit par leur absence totale de musicalité
(ce qui ne veut pas dire de mélodisme : il y a une vraie âpreté
dantesque, et non moins d’opacité dans nombres de vers de la Comédie),
me semblent faire obstacle à une lecture à la fois fidèle et
contemporaine de ce chef-d'œuvre fondateur de la langue italienne, qui
est aussi un sommet de la littérature universelle. Mais ma colère visait
également les traductions qui aplatissent le discours de la Comédie.
Je pense non seulement à la traduction de Jacqueline Risset (en vers
libres), dont personne n’a jamais observé qu’elle est totalement dénuée
de l’élément rythmique fondateur du poème, mais surtout à celle qu’un
écrivain a récemment donnée chez un grand éditeur en mettant le poème de
Dante en… octosyllabes, amputant ainsi de moitié l’ampleur
poétique, intellectuelle et théologique de l’ouvrage, qui devient une
sorte de « traduction de gare », comme on dit un « roman de gare ».
J’écris en italiques le mot octosyllabe, car en vérité les « vers » de
cette traduction sont des phrasettes de huit pieds, qui ignorent
totalement la structure du vers octosyllabique – laquelle ne convient
absolument pas à l’esprit du poème (il suffit pour s’en convaincre de
relire les Chansons des rues et des bois d’Hugo). Cette tentative
grotesque m’évoque les réécritures qu’on donne aujourd’hui de nos livres
d’enfant : on supprime les mots un peu difficiles, on coupe en deux les
phrases trop longues, on simplifie la syntaxe, on « modernise » la
langue (« nous » devient « on »), etc. - Je l’ai dit aussi : je n’ai
jamais pensé que je serais un jour conduit à traduire Dante, qui m’a
longtemps semblé un massif inaccessible, mais, quand la chance m’en a
été offerte par Florian Rodari, j’avais par rapport à mes concurrents
l’avantage considérable d’avoir traduit les autres grands chefs-d’œuvre
italiens en décasyllabes, et notamment les 39 000 vers du Roland
furieux et les 15 000 vers de la Jérusalem délivrée, sans
parler de Michel-Ange, poète obscur et rude s’il en est, et des poésies
lyriques du Tasse. Pour traduire Dante, aucune autre solution ne
s’offre en français que celle de la traduction en décasyllabes, vers
qui est l’équivalent exact de l’hendécasyllabe italien. Mais un
décasyllabe dont il faut posséder l’usage, ce qui sous-entend de longs
exercices et une féconde méditation des vieux poètes français.

© Lexnews
Avez-vous rencontré des
problématiques particulières pour la traduction du Purgatoire par
rapport à celle de l’Enfer ?
Michel Orcel : "Non,
mais vous me donnez l’occasion de m’expliquer un peu mieux là-dessus. La
souplesse de son style permet à Dante d’adopter dans le Purgatoire
les mots, les tons, le phrasé qui conviennent évidemment à son objet ;
le lexique, par exemple, n’use plus des couleurs violentes et parfois
obscènes de l’Enfer, mais l’appareil stylistique (tropes hardis,
syntaxe remodelée, métaphores concrètes, etc.) et la langue ne sont pas
substantiellement différents. Ce qui diffère, en revanche, ce sont les
moyens du traducteur, qui, d’une part éprouve un soulagement à quitter
le monde infernal (où les émotions sont intenses mais désespérées), et
qui d’autre part pénètre toujours plus profondément dans l’œuvre et se
prend du même coup à modeler de plus en plus près son vers sur le vers
italien. De telle sorte que, si je n’ai jamais cherché à reproduire le
système des rimes (ABA BCB CDC, etc.) - ce qu’a tenté une récente
traductrice (traductrice – mais certainement pas poète), montrant ainsi
que c’est une entreprise impossible si l’on veut sauver la grandeur et
la complexité du tissu poétique de Dante -, j’ai spontanément trouvé des
échos plus flagrants, des rimes plus fréquentes, notamment entre le
premier et le troisième vers du tercet. Pour ne rien vous cacher, la
chose s’est d’ailleurs vérifiée et accrue dans la traduction du
Paradis. Pour répondre à votre question : loin d’avoir rencontré de
nouveaux obstacles, les difficultés se sont faites moins pesantes.
Quelle vision selon vous nous
livre Dante du Purgatoire sachant que ce concept est né au Moyen Âge
ainsi que l’a brillamment rappelé le médiéviste Jacques Le Goff (lire
notre interview) ?
Michel Orcel : "C’est
une vision très proche de la théologie chrétienne (saint Thomas et la
théorie de l’amour détourné de son vrai but sont bien là en
arrière-plan) mais, en même temps, profondément personnelle. De même
qu’il avait sauvé dans les « Limbes » de l’Enfer de grands personnages
de l’Antiquité (Homère, Horace, Aristote, Platon, etc., et jusqu’à
Démocrite, étonnant choix !) ou même du monde païen (Averroès, Saladin),
de même le Purgatoire est marqué par la présence de trois grandes
figures de l’Antiquité : Caton, qui accueille le poète dans l’anté-Purgatoire
; Virgile, le « très tendre père » qui guide le poète depuis les Enfers
et le quittera (terrible moment !) au seuil du Paradis terrestre, sommet
du Purgatoire, et un autre poète latin, Stace, qui va le conduire vers
Mathilde et puis Béatrice. La présence de Caton n’est pas peu étonnante,
si l’on y réfléchit. Stace peut surprendre aussi, car on ne sache pas
que ce grand poète (si mal connu aujourd’hui) soit jamais devenu
chrétien. Cela dit, la structure de la Divine Comédie est très
pensée, et le Purgatoire est construit de façon spéculaire par
rapport à l’Enfer : au lieu d’un gouffre structuré en « cercles »
descendants, c’est une montagne qu’on gravit par corniches jusqu’au
Paradis terrestre, qui se trouve inclus (c’est une invention de Dante)
dans le Purgatoire.
Pensez-vous que cette vision de Dante
soit encore compréhensible et accessible aux jeunes générations
d’aujourd’hui ?
Michel Orcel : "Je
dirai d’abord que, depuis au moins deux siècles, lire Dante n’exige en
aucune manière de croire en Dieu et a fortiori à la réalité de
l’Enfer et du Purgatoire. |
Si les Italiens de tous âges continuent à
être profondément émus par la lecture de la Comédie, c’est, non
seulement parce que Dante est le père nourricier de la langue italienne
et un pôle symbolique (comme Verdi) en qui se reconnaissent les
Italiens, mais aussi parce que son poème décrit l’humanité avec
violence, crudité, verdeur, ironie, humour, mais aussi tendresse,
amitié, passion et compassion. Tous les sentiments, des plus beaux aux
plus bas, tous les amours et les vices des hommes y sont peints sous des
couleurs vivantes, tantôt pleines d’horreur, tantôt de pitié et de
sympathie. Dans l’Enfer, la tendresse ne se faisait un chemin
qu’à travers la figure de Virgile (le « très tendre père »), envers
lequel Dante - qu’on représente si grave et si sévère - se montre comme
un enfant à la fois craintif et confiant, ou de Brunetto Latini, le
maître du poète, ainsi que dans des figures historiques mais déjà
légendaires. Je pense notamment à Paolo et Francesca da Rimini, unis
pour l’éternité dans un amour à la fois pur et coupable, ainsi qu’au
comte Ugolin et à ses petits-enfants, mourant de faim les uns après les
autres au fond de leur cachot… Cette tendresse se fait plus générale
dans le Purgatoire ; les vices y sont certes durement punis mais
rédimés, et tout le cantique mène vers le Paradis terrestre dans un
grand mouvement amoureux qui préfigure déjà les joies du Paradis.
Dans les années 80, Carmelo Bene (acteur et cinéaste avant-gardiste)
déchaînait à Ravenne un stade empli de jeunes gens en leur lisant la
Comédie… En 2006, c’était Roberto Benigni, sur la place Santa-Croce,
qui commentait et récitait devant des foules passionnées les chants du
grand poème : un spectacle qui a été repris dans diverses villes
d’Italie et du monde, qui a été télévisé (on peut en voir de nombreux
extraits sur Youtube) et a sans doute été vu par dix millions de
personnes… C’est dire qu’en italien, la Comédie peut encore
bouleverser des foules plus ou moins cultivées. Je ne crois pas, hélas,
que ce puisse être le cas en France, non pas tant à cause de la
traduction (ma version, en tout cas, est passée par le « gueuloir »,
contrairement aux autres, à ce qu’il semble si l’on fait l’expérience
d’une lecture à haute voix), mais surtout parce que notre pays est
aujourd’hui totalement déséduqué et que le nom de Dante est plutôt connu
pour être le prénom d’un footballeur (d’ailleurs médiocre) que celui
d’un des plus grands poètes que le monde ait connus… Cela dit, laissons
aux jeunes gens toutes les chances d’ouvrir un jour la Comédie et
de s’y plonger sans tenir grand compte des innombrables références
historiques ou théo-logiques, mais en le lisant comme un poème aux
métaphores les plus concrètes et les plus variées, comme un merveilleux
kaléidoscope d’aventures et de caractères, enfin comme une initiation de
l’amour à l’Amour.

© Lexnews
Est-ce la joie qui vous guide
maintenant pour la dernière étape avec la traduction du Paradis
qui viendra conclure cette vaste entreprise ?
Michel Orcel : "Pour
être tout à fait franc, j’ai achevé il y a quelques jours à peine (le 29
juin) le premier jet de ma traduction du Paradis. Et en effet
j’ai traduit ce chant dans une joie croissante, à peine ralentie ici et
là, lorsque Dante nous inflige quelques tercets de pure théologie... Ce
qui est plus puissant que toute dogmatique, c’est la grande symphonie de
la Lumière et de l’Amour qui anime tout le cantique et achève le poème
sur le fameux vers : « Amor che move il Sol e l’altre stelle » (« Amour
qui meut Soleil et les autres étoiles »). N’oublions pas que la religion
de Dante – pour être tout à fait orthodoxe – est le fruit d’une
bouleversante expérience amoureuse de sa prime jeunesse dont, après des
aventures sensuelles, il tirera tout le suc et le sens de la Comédie.
Il est d’ailleurs remarquable (et la potentielle influence de l’islam
sur Dante a été brillamment soutenue autrefois par Miguel Asin Palacios)
que ce que Béatrice fut à Dante soit très semblable à ce que Nîzham fut
pour le grand mystique musulman Ibn ‘Arabî, « la manifestation
terrestre, la figure théophanique de la Sophia aeterna » (H.
Corbin).

© Lexnews
Rien n’est ébranlé des fondements les
plus purs du christianisme – le seul Médiateur est le Christ, la Vierge
mère est « fille de (son) Fils (…), etc. –, mais le moyen par lequel
Dante est éveillé à l’Amour divin passe par les yeux d’une femme.
(Comment, à ce point, ne pas se rappeler l’Éternel Féminin / (qui) nous
entraîne vers le haut » de Gœthe ?) De même que Dante avait inventé le
mot « transhumaner » pour désigner le passage potentiel de l’homme à la
surnature (la nature humaine déifiée), de même peut-on dire qu’il
est le plus haut représentant d’un « féminisme » avant la lettre qui
fait de la Femme le véhicule primordial de l’initiation au secret de
l’amour divin".

© Lexnews
- "Le Purgatoire - La Divine Comédie" par Dante
Alighieri, traduction nouvelle de Michel Orcel, 464 p. La Dogana, 2020.
- Lire notre
chronique du premier volume paru "L'Enfer"
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
|
|
Hommage Jean Blot
(1923-2019)
|
|
L'écrivain Jean Blot nous a
quittés en cette fin d'année 2019. En hommage à cet homme de lettres, cosmopolite et à la croisée des cultures, Lexnews
republie l'interview qu'il avait bien voulu nous accorder en 2014, ainsi
que la chronique de son dernier ouvrage paru tout récemment.
Jean Blot, c'est tout cela et plus que cela encore... |
|
Jean Blot : « Le Séjour ; T.1 :
L’enfance », Coll. Les Cosmopolites, Editions La Bibliothèque, 2019.
Imaginez ! Le narrateur – nommons-le Alexandre, naît à Moscou trois ans
après la révolution d’Octobre de 1917, Lénine est au pouvoir ; D’origine
juive, ses parents émigreront avec ce jeune enfant d’abord à Berlin, puis
très vite à Paris... Un beau début de roman, pensez-vous.
Imaginez maintenant que cette enfance ait été non seulement vécue, mais
qu’elle soit aujourd’hui présente, vivante, à portée d’oreille… Alors,
cela devient non seulement un beau roman, mais une biographie inouïe !
C'est ce témoignage émouvant et précieux, ces souvenirs d’un autre siècle,
pour beaucoup aujourd’hui difficilement imaginables, que nous livre
avec ce premier volume d’une trilogie nommée Le Séjour, Jean
Blot, écrivain, essayiste, grand cosmopolite et surtout amoureux
impénitent de littérature et des mots.
Quelques pages suffisent à faire du lecteur le compagnon de jeu de ce
garçonnet curieux, observateur, un brin intrépide, et qui se souvient,
quatre-vingt-dix ans après, savoir parfaitement prononcer le « r »
russe. Car émigrer, c’est aussi et plus encore lorsqu’on a un père poète
perdre sa langue natale ; un abandon suivi de tant d’autres que le jeune
Alexandre apprendra très tôt à cacher derrière une « hypocrisie du
bonheur » qui, écrit-il, ne le quittera plus jamais. *
Et effectivement, bien loin de s’apitoyer ou d’être larmoyant, l’auteur
joue avec une lucidité aussi implacable qu’espiègle avec ses souvenirs, sa
mémoire et lui-même. Une enfance marquée du sceau de l’Histoire,
inexorable, et qu’il attrape parfois au vol, questionne et accommode avec
tendresse ou inflexibilité. Paris, la rue Poussin, l’Angleterre et les
années de collège... de jeunes années qui allaient forger le futur
écrivain et acteur de la vie culturelle internationale qu’il deviendra.
|
Des souvenirs « retrouvés » se voulant - ainsi que l’a souhaité
Jean Blot, moins véridiques qu’authentiques, et mis en forme avec cet
amour inconditionnel du style et de la littérature qui habite l’auteur.
Pouchkine, Mandelstam, Proust y trouvent tout naturellement place. Jean
Blot avoue une affection toute particulière pour le mot même de «
Réminiscences ». Chateaubriand n’écrivit-il pas d’ailleurs avec
justesse que « Les plus belles choses qu’un auteur puisse mettre dans
un livre, sont les sentiments qui lui sont apportés, par réminiscence, des
premiers jours de sa jeunesse. »
Et il est vrai qu’en ces pages émouvantes, ce mot prend une sonorité ou
couleur toute particulière à la lecture de ces souvenirs qui imposent de
remonter l’horloge du temps de près d’un siècle. En un savant dosage de
confessions, de pudeur et malice, l’auteur ayant bien trop de respect pour
son lecteur, Jean Blot se souvient et s’affranchit avec allégresse de la
grisaille des souvenirs et des années qui passent.
C’est à une tendre conversation entre l’enfant qu’il fût et l’homme qu’il
est devenu, entre le jeune Alexandre Blokh et l’écrivain consacré et
reconnu aujourd’hui sous le nom de Jean Blot, son nom de résistant, à
laquelle est convié le lecteur. Ses proches, son père admiré, sa mère
douce et joyeuse, sa nounou, ses amis d’enfance n’y reprennent pas
seulement place, mais revivent sous sa plume dans le regard et l’âme de ce
garçonnet qui grandit alors que les heures de l’Histoire sonnent…
« Mais les cloches que j’entends sonner au loin, errer dans le jour
gris comme pour annoncer sa fin – ou la fin – m’assourdissent. Le carillon
fait que je n’entends plus les jours qui le précèdent. Je les retrouverai
peut-être. Mais c’est le deux septembre dix-neuf cent trente-neuf. Et
c’est le tocsin.
J’ai seize ans. J’en aurai bientôt… - dans six mois – dix-sept. »,
écrit Jean Blot pour refermer ce premier volume lorsque les ailes du temps
feront brusquement tourner cette page de l’enfance, de son enfance.
L.B.K.
|
|
Interview Jean BLOT
Paris, 11 décembre 2014 |
|

© Jean Blot
Longtemps haut fonctionnaire
international et Secrétaire du Pen Club, Jean Blot est l'auteur d'une
œuvre - romans, essais, livres de voyages, biographies - couronnée par
de nombreux prix et traduite en neuf langues. Cet homme de lettres et de
langues a décliné sa vie au diapason de la vie culturelle
internationale. Découverte d'une âme slave, à l'élégance
britannique, et épris du bon goût français !
 ès
le plus jeune âge, votre vie est marquée par une dimension
internationale, celle de l’émigration russe vers l’Allemagne, puis la
France, celle de l’éducation et de la culture entre la France et
l’Angleterre - sans oublier vos racines russes et juives, mais aussi
l’influence de vos activités professionnelles en tant que haut
fonctionnaire international… ès
le plus jeune âge, votre vie est marquée par une dimension
internationale, celle de l’émigration russe vers l’Allemagne, puis la
France, celle de l’éducation et de la culture entre la France et
l’Angleterre - sans oublier vos racines russes et juives, mais aussi
l’influence de vos activités professionnelles en tant que haut
fonctionnaire international…
Jean Blot : "De l’Allemagne, il ne m’est rien resté ; c’était la
NEP, et à ce moment-là, on pouvait racheter les citoyens en devises
fortes, comme nous avions de la famille en Allemagne, nous avons donc
été rachetés et sommes partis pour Berlin. Mais, je n’en ai aucun
souvenir, ma vie commence à Paris. En revanche, effectivement, j’ai été
élevé dans le bilinguisme, et même dans le trilinguisme. Or, le
bilinguisme et a fortiori le trilinguisme peuvent être une rude épreuve
pour un jeune enfant d’autant plus qu’à cette époque je bégayais (je
m’en suis soigné, vous vous en êtes aperçus, pour le meilleur ou pour le
pire !). Cet environnement a pu introduire un doute certain dans
l’univers d’un enfant trilingue.
Je pense également en vous parlant à un autre élément biographique qui a
eu son importance : j’ai reçu une éducation à la fameuse école de
Montessori, ce qui était certes une bonne chose à bien des égards et une
mauvaise à bien d’autres… Une bonne chose parce qu’à Montessori, il
était impossible de savoir si on travaillait ou si on s’amusait, et cela
est précieux et rare. Après cela, je suis allé aux Roches, une école
terrible pour jeunes gens de bonne famille – mes parents se ruinaient en
m’y envoyant – et qui imitait, à mon avis, assez mal les écoles
anglaises. En ces lieux, était pratiquée cette chose horrible qui
s’appelait le bizutage, et dont je ne me suis toujours pas remis… Alors
que j’étais dans ce nouvel établissement très malheureux, on me donna un
beau matin une rédaction dont le thème était : « Tout nouveau, tout beau
» ; bien sûr, dans ce contexte cauchemardesque, j’aurais dû comprendre
que le bizut devait se tenir tranquille, mais j’entrepris malgré tout
une apologie – à mon avis, absolument remarquable ! – du bizut et une
attaque violente contre cette pratique. J’ai eu zéro ! A partir de ce
moment, on a décidé de m’envoyer poursuivre mes études en Angleterre
chez un oncle qui était un homme à la carrière internationale. J’ai
passé seulement quatre années en Angleterre, mais à cet âge de onze ans,
ces années sont importantes. A cette époque, je n’aimais pas beaucoup
l’Angleterre, je préférais la France. Avec les années, j’ai quelque peu
changé… Les écoles anglaises sont à la fois un paradis parce que vous
avez des paysages merveilleux qui conviennent tellement bien à la
jeunesse, il y a un système éducatif d’une très grande intelligence,
mais c’était cependant pour moi également un enfer parce que j’étais
privé de ma mère, de ma famille et que je me sentais étranger ; A vrai
dire, j’ai toujours gardé ce sentiment d’être un étranger partout où je
me trouve : Russe en France, Français en Russie, Anglais en Amérique et
Américain en Angleterre, etc. ! J’ai pris conscience de cela en
Angleterre à onze ans, soit il fallait « en crever », soit en faire des
romans… J’ai préféré en faire des romans ! Voilà à peu près le périple
de départ. Quand je parle russe, je me sens Russe, mais je suis avant
tout Français, c’est cela que j’ai voulu être dès ma toute petite
enfance…"
Une âme russe et un cœur français…
Jean Blot : "Oui, c’est en effet un raccourci dans lequel je me
reconnais. Mais, auquel il faut également ajouter cette éducation
anglaise qui m’est souvent très précieuse."
À partir de
ce que nous venons d’évoquer, quel regard portez-vous sur ces influences
plurielles et en quoi ont-elles pu avoir un rôle déterminant sur votre
inspiration littéraire et votre écriture ?
Jean Blot : "Je suis réellement bilingue, non pas tout à fait
trilingue car si je parle le russe, je ne l’écris pas. Cela vient du
fait que mes parents me parlaient en russe, ce que je ne voulais
absolument pas. Je me souviens que je leur répondais systématiquement en
français ; j’ai désappris ainsi le russe, je voulais être français comme
tout le monde ! Cela dit, j’ai écrit beaucoup sur la Russie ; je me suis
intéressé à la Russie plus tard. Dans mon jeune âge, je ne voulais rien
savoir, rien connaître. Quelle est en fait l’influence de la Russie ? Je
pense qu’elle est quelque part, à la fois, très grande et très secrète.
Cela serait plus facile de commencer par le français en ce sens que j’ai
toujours voulu écrire dans cette langue et ne penser qu’en français,
sentir en français… Il est vrai qu’écrire en anglais ou en russe, pour
moi, ne signifie rien. Certes, en tant que haut fonctionnaire
international, j’ai écrit, vous vous en doutez, plusieurs volumes de
rapports en anglais, cela ne me pose pas de problème sur un strict plan
linguistique, mais quelque part, la littérature n’a de sens, le monde
n’a de sens, n’est lisible et ne doit être lu, pour moi, qu’en français.
Il y a dans le français une exigence qui, selon moi, est profondément
éclairante et structurante ; lorsqu’on dit quelque chose en français,
c’est clair ; lorsqu’on dit quelque chose en russe, c’est émouvant ; et
lorsqu’on dit quelque chose en anglais, c’est amusant ! (rires)."

© Jean Blot
Justement, lorsque vous avez composé, et encore récemment, vos
romans, vos essais, est-ce que cette langue – le français - que l’on
peut dire maternelle a été elle-même éclairée, influencée par ces autres
langues que vous pratiquez ?
Jean Blot : "Lorsque j’ai commencé Les cosmopolites (1976,
Editions Gallimard, Prix Valery-Larbaud), cette trilogie, j’avais
initialement l’intention de l’écrire en trois langues, pour la simple
raison que les dialogues, les idées des protagonistes se disaient en moi
en chaque langue en fin de compte. En fait, si j’exagère un peu, si je
force quelque peu le trait, le russe résonne, en moi, comme la langue
des sentiments, le français est la langue de la réflexion, de la
compréhension, de la clarté, et l’anglais est la langue de l’action.
Encore aujourd’hui, je dicte plus facilement une lettre en anglais qu’en
français. L’anglais garde également pour moi une certaine nostalgie de
ces années d’enfance, j’aimais particulièrement la poésie anglaise.
Mais, c’est extrêmement difficile de démêler toutes ces influences
linguistiques plus précisément. Je crois qu’il y a dans mes trente-cinq
écrits, dans mon œuvre, une sensibilité russe de base, certainement. Et,
j’avoue que dans les rapports interhumains, j’ai – pour le meilleur et
pour le pire ! – une attitude russe, judéo-russe qui peut parfois,
faut-il le confesser ?, être un peu exaspérante. J’ai la fâcheuse manie
de parler des choses dont on ne parle pas ! (rires)"
Quelles sont les influences déterminantes dans la littérature russe ?
Vous avez consacré un essai à Gontcharov…
Jean Blot : "Oui, j’ai consacré un essai à Gontcharov parce que –
il faut bien tout vous avouer ! - si tout le monde a écrit sur Tolstoï,
si tout le monde a écrit sur Dostoïevski, personne en France, je crois,
n’avait écrit sur Gontcharov ! Il n’y a que deux écrits, un de 1900 et
le mien. Personne ne le connaissait. Oblomov, une de ses œuvres
capitales, par exemple, a été totalement méconnue jusqu’au moment où
elle a été jouée au Vieux Colombier l’année dernière. C’est une œuvre
géniale ! Et Oblomov, plus proche du contemplatif que du paresseux,
considère – ce qui, pour moi, est très important, l’action même comme un
péché. Il y a toujours quelque chose de dangereux dans l’action. Mais,
ce qui m’intéressait également, c’est que Gontcharov a créé avec Oblomov
le seul russe positif de la littérature russe. Il est, je crois, le seul
à avoir tenté d’expliquer ce que pourrait être un bonheur russe ; il a
voulu montrer par son héros Stolz (Oblomov étant l’antihéros, n’est-ce
pas…), ce que pourrait être un Russe qui garderait toute la richesse
émotive et sentimentale de la Russie et qui aurait appris en Occident
l’énergie, la discipline et une certaine forme de gaieté au sens de
vitalité. Cela étant dit, selon moi, le plus grand écrivain russe
demeure néanmoins Tolstoï. Alain disait : « Ah ! Si la vie écrivait
comme le Comte Tolstoï ! » Tolstoï est réellement extraordinaire, tout
est immédiatement là ; la présence, l’évocation sont immédiates. En
revanche, dès que Tolstoï se met à penser, cela devient grotesque, les
idées de Tolstoï que dieu nous en garde !"
___________________________
"Voyez-vous,
je voulais être Le cosmopolite. J’aurais voulu apporter à la
littérature une chose, qui du moins à l’époque était nouvelle,
c’est-à-dire cette expérience de quelqu’un qui chaque matin ouvre son
carnet et regarde la date pour savoir où il est, à New York, Paris ou à
Londres..."
___________________________
On évoquait les influences des langues que vous avez acquises et
intégrées très jeune, les parcours que nous avons également – trop
rapidement – évoqués ont eu, je suppose, également une influence dans
l’inspiration littéraire elle-même ?
Jean Blot : "Voyez-vous, je voulais être Le cosmopolite. J’aurais
voulu apporter à la littérature une chose, qui du moins à l’époque était
nouvelle, c’est-à-dire cette expérience de quelqu’un qui chaque matin
ouvre son carnet et regarde la date pour savoir où il est, à New York,
Paris ou à Londres… Cela a été ma vie et cela m’est, à vrai dire, arrivé
deux fois ! Le cosmopolite, de même qu’il s’habille différemment selon
qu’il est à Londres, Moscou ou Paris, pense aussi différemment. Il me
semblait qu’il y avait là, dans cette attitude, la formation de l’homme
moderne."

Jean Blot, secrétaire international du
PEN Club
© Jean Blot
Cette ouverture a fait de vous un homme d’amitié, amitiés qui vous
ont permis de côtoyer de grandes figures du paysage intellectuel et
littéraire comme Albert Cohen, Vladimir Nabokov ou encore Marcel Arland.
Avec le recul, comment percevez-vous ces rencontres ? Ont-elles joué un
rôle sur votre propre écriture ?
Jean Blot : "Je vais vous répondre, en premier lieu, sur
l’écriture même : franchement, non ! Dans mon œuvre littéraire, la seule
influence déterminante est celle de Proust. C’est pour tout avouer,
Proust qui m’a permis d’écrire. J’ai commencé à écrire assez tôt ;
j’avais à l’époque envoyé mes écrits à Jean Paulhan, j’avais 23 ans et
j’ai reçu en réponse cette lettre que je cite de mémoire : « Monsieur,
j’ai lu vos récits et ils m’ont semblés – encore que fort mal écrits –
admirables. »
On oublie le « fort mal écrit » lorsqu’on reçoit une telle lettre,
évidemment !
Jean Blot :
"C’est certain ! J’ai beaucoup lu et aimé Cohen. J’ai aimé l’homme
qui a été un très grand ami. Mais, Cohen a surtout été une découverte ;
peu de personnes, à l’époque le connaissaient. Belle du Seigneur n’était
pas encore paru, c’était Solal, et j’ai été vraiment enthousiasmé par
cette prose, par ce brillant. Les circonstances ont d’autre part joué
puisqu’à l’époque j’étais à Genève et qu’Albert y prenait sa retraite.
Mais, celui qui a vraiment joué un rôle déterminant, que j’ai un peu
connu, c’est Albert Camus. Albert Camus est resté celui dont j’ai encore
beaucoup de mal à parler sans un sanglot dans la gorge… C’était un homme
admirable, certes comme écrivain, bien entendu, mais des écrivains
admirables, il y en a pas mal, or Albert Camus était surtout un Homme
admirable. Je peux vous raconter à son sujet deux petites anecdotes : La
première, j’entre dans le bureau d’Albert Camus, j’étais très jeune,
très émotionné, il se tait alors immédiatement et bouge sa chaise de
l’autre côté du bureau à côté de son interlocuteur…vous comprenez…"
Oui, c’est un geste qui en dit long…
Jean Blot :" … J’évoque encore ce geste avec des larmes aux yeux…
Ensuite, nous avons parlé, et à un certain moment, il me cite le nom de
René Char ; je n’ai pu que lui répondre que j’étais désolé, mais pour
moi, René Char était un poète dont je n’entendais pas la musique,
j’étais navré… A ce moment, il me demande si j’ai lu Fureur et Mystère,
et me dit qu’il est sûr que cet ouvrage devrait retenir mon attention,
et ce d’égal à égal ce que je n’ai jamais pu oublier. Je l’ai, bien
entendu, remercié et je suis reparti visiter Paris, il devait être
quatre heures de l’après-midi. Or, quelle n’a pas été ma surprise,
lorsque rentrant à l’hôtel, le soir, d’y trouver le livre de René Char
qui m’attendait ! Vous vous en rendez compte, le livre était là ! Une
telle attitude pour un jeune homme qui lui était inconnu a forcé mon
admiration, même si je l’ai mieux connu par la suite aux Nations Unies.
Pour moi, c’est un des souvenirs les plus précieux et l’expression d’une
humanité des plus remarquables ! Et je n’ai jamais tout à fait eu ce
sentiment avec les autres. J’aimais, certes, énormément Albert Cohen,
nous nous entendions très bien, il était extrêmement gentil, toujours
très curieux – et aussi très jaloux de ce qui n’était pas lui !, très
amusant, je pourrais multiplier les anecdotes, mais je ne veux pas me
leurrer, j’étais surtout un très jeune homme et il est toujours
réconfortant pour un écrivain d’avoir à ses côtés un jeune homme docile
et qui a, qui plus est, cette petite plume lorsqu’on en a besoin. Ce qui
m’arrangeait, à l’époque, également, je dois bien aussi l’avouer ! Bref,
il n’y avait pas tout à fait ce désintérêt, cette humanité que je vous
rappelais en vous parlant d’Albert Camus. Cela s’est malheureusement mal
terminé avec Albert Cohen, mais, cela aussi, est assez classique chez
lui, et c’est pour cela que je peux le raconter : On se téléphonait
trois fois par jour, on se voyait au moins une fois par semaine, et un
jour, je lui dis que j’ai une grande nouvelle et lui apprends que je
viens d’être nommé à l'UNESCO, et donc que j’allais devoir quitter Genève
et partir à Paris. A ce moment-là, il me répond : "Ah bon, vous partez
à Paris…Vous l’aviez demandé Alex ?" – il le savait bien, c’était très
important pour un écrivain d’être à Paris – alors, Albert ajoute : « Ah
bon… et bien nous n’avons plus rien à nous dire. » Voilà, avec Albert
Cohen, cela s’arrête ainsi… Cela dit, j’ai écrit souvent sur lui et
beaucoup réfléchi à son œuvre."

© Jean Blot
Et Marcel
Arland ?...
Jean Blot : "Marcel Arland, c’est une très jolie histoire ! Un
jour, mon père me montre un monsieur que je n’aimais pas tellement, il
était mon professeur de français et marchait…mon père me dit : « c’est
un grand écrivain ! ». Je le vois et l’entends encore… s’il y avait eu
Jupiter bras dessus, bras dessous avec Athéna, cela n’aurait pas eu plus
d’effets ! (rires) bon, mais on s’est néanmoins quittés, bien entendu,
et je n’ai de cette époque, de lui, que ce souvenir… Et puis, nous nous
sommes retrouvés ensuite à la NRF où il m’a tiré des griffes de Paulhan,
et c’est grâce à lui notamment que j’ai pu publier à la NRF plus de 157
articles ! Un jour, il se plaint à moi de mon ami Emmanuel Berl en me
disant qu’il n’était pas avec lui très gentil, qu’il se moquait de lui,
tout en soulignant qu’il avait cependant peut-être raison…et que c’est
vrai, les arbres ne parlent pas, un chat non plus, mais il ajoute en se
tournant vers moi : « Mais, Alex, vous savez bien, vous, ce que c’est un
matin d’été lorsque vous ouvrez les volets…les arbres… le ciel, enfin
tout… tout à l’air de vous parler, tout à l’air de dire… » ; je
l’interromps et poursuis : « Tout vous dit : Bonjour petit, tu es des
nôtres ! » ; Il me répond : « comme c’est beau ! Alex, vous devez
l’écrire.», et là, je suis bien obligé de lui avouer : « ça, Marcel, je
ne peux pas.. » ; pourquoi ?, me demande-t-il alors : « Parce que cela a
déjà été écrit, Marcel, pas par moi, mais par vous ! » (rires). J’étais
tout cramoisi, mais cela était tout Marcel ! Il y avait ce côté un peu «
ailleurs » de Marcel qui était délicieux, et il y avait le marcheur,
silencieux. Il avait sa place à la NRF, il était très attentif, et
surtout pour moi, c’était la littérature. La littérature, prise comme
une ascèse, c’était cela Marcel."
|

© Jean Blot
Les derniers livres de Jean Blot
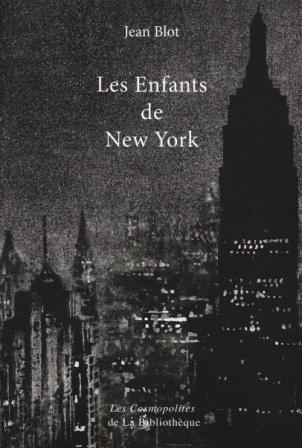 Jean
Blot : Les Enfants de New York, Éditions La Bibliothèque, 2014. Jean
Blot : Les Enfants de New York, Éditions La Bibliothèque, 2014.
" You die -
We do the rest " propose une publicité des pompes funèbres. New York,
après la seconde guerre mondiale, incarne le rêve, le Graal, pour qui a
subi les bombes, les camps, la barbarie, la destruction de la vieille
Europe et aborde ces berges tant désirées. C'est cette ville dressée comme
un cheval cabré, ses buildings oniriques, ce décor nocturne que Jean Blot
radiographie à travers la destinée de personnages dont on suit
passionnément les péripéties. À réaliser leur rêve, les enfants de New
York en seraient-ils devenus les victimes ? Constat amer, vif, surprenant
et paradoxalement prophétique :
New York hier ne serait-il
pas Paris aujourd'hui ?
 Jean
Blot : Le rendez-vous de la Marquise, Editions L'Age d'Homme, 2014. Jean
Blot : Le rendez-vous de la Marquise, Editions L'Age d'Homme, 2014.
Le rendez-vous de la
Marquise est celui de tout mortel. Faut-il le préciser ? Mais quand elle
sort à cinq heures, c’est la réalité même qui apparaît. En vain, la
littérature la refuse. En vain, l’immense poète Cétois cherche à
s’enfermer dans des énigmes pour s’en protéger. En vain, l’immense poète
Britton éjacule une fureur verbale incontrôlée pour la faire taire. En
vain, l’art lui tourne le dos pour accueillir le vide et le non-sens. En
vain, la politique cherche à l’égarer. Un bel incendie viendra conclure
ces tentatives rocambolesques où toute valeur sera consumée. Seule la
politique en réchappera mais pour courir après le vide au nom du rien.
Sur ces thèmes apocalyptiques, malgré une fin nécessairement tragique,
Jean Blot a composé la plus drôle des satyres, persuadé que si, comme le
voulait Rabelais, « le rire est le propre de l’homme », tout ce dont on
rit, redevient humain.
_______________________
Et Nabokov ?
Jean Blot :"Nabokov, je ne l’ai quasiment pas connu. Je l’ai
croisé, une première fois, il habitait le même hôtel que nous à la porte
de Saint-Cloud, mais à l’époque j’avais 4-5 ans, et il me paraissait
être un monsieur extraordinairement ennuyeux et insupportable. Ensuite,
je l’ai rencontré chez un cousin qui était autant homme de bourse que de
lettres, ils étaient très proches et souvent nous dînions avec ces
derniers. Mais, j’étais un très jeune homme et Nabokov était assez
méprisant. Il n’avait pas l’attention de Cohen ou d’Arland. Et ce
d’autant plus, que comme tout écrivain, il était très sensible et qu’il
sentait très bien la limite de mon enthousiasme ; je l’admirais, certes,
mais probablement pas avec l’élan qu’il eut souhaité. C’est, en fait,
beaucoup plus tard que j’ai apprécié Nabokov non seulement dans son
écriture, mais également dans sa vie. Nabokov a été pour moi un des
premiers de l’immigration russe à briller avec son insolence, son
intelligence et son élégance (vous savez, être un enfant de
l’immigration russe – les parents, les adultes, eux, vivaient encore en
« Russie », mais pour un enfant, c’était une situation extrêmement dure
et humiliante). Et puis, ce qui m’a passionné chez Nabokov, c’est qu’il
est un des rares à être un grand écrivain en deux langues. Nabokov est à
la fois un grand écrivain russe et un grand écrivain américain, c’est
une expérience unique qui m’a, pour les raisons que j’ai évoquées, vous
le comprenez bien, beaucoup touché. J’ai écrit sur Nabokov deux ou trois
papiers et on m’a proposé d’écrire sur lui un livre. A ce moment-là, je
l’ai, bien sûr, beaucoup étudié, je connaissais bien son fils, je l’ai
ainsi deviné en le suivant à la trace… Je l’aime beaucoup, mais je ne
l’ai jamais vraiment connu."

Congrès du PEN à Tokyo : Jean Blot, le
secrétaire international,
une Geisha et Vaksberg, le président international et secrétaire du Prix
Nobel
© Jean Blot
Revenons, si vous le voulez bien, sur le cosmopolite pour évoquer
cette Grèce que vous chérissez tant, mais aussi l’Asie, et la Corée
notamment que vous avez connue jeune.
Jean Blot : "La Corée est une histoire très curieuse qui est
partie en premier lieu de Tokyo. Nous avions été invités en tant que
Français à l’ambassade française de Tokyo avant de rejoindre Séoul. Là,
le représentant de la France nous reçoit ; c’était un général, grand
patriote, il était le fils de Gorki, et avait perdu un bras pour la
France, à la suite de quoi il avait été nommé ambassadeur de France.
Mais, s’il aimait profondément la France et les Français, il parlait en
revanche un français détestable, et donc il évitait, autant que peut se
faire, le français. Nous accueillant, il nous dit avec son accent
inévitable : « Alors, jeunes gens, vous partez pour la Corée ?! ».
Il
prend alors un encrier et deux cendriers sur une table et nous dit : «
La Corée…28e parallèle…bon, après je ne sais…peut-être comme si,
peut-être comme ça…peut-être comme si, comme ça, bonne chance ! »
(rires). A l’époque, c’était ainsi la Corée et ce sont avec ces «
instructions » que nous sommes partis! J’ai été bouleversé en arrivant
en Corée par l’état du pays. Séoul était pourtant une grande ville, mais
l’eau courante n’existait plus, il n’y avait quasiment pas de voitures à
l’exception de celles des Nations Unies…c’était absolument désolant, ce
n’était pas même une misère, mais une pauvreté incroyable, effroyable.
C’est bien la seule ville où je me réjouis, encore aujourd’hui, des
encombrements de voitures qui peuvent durer des heures ! Je vous raconte
un incident qui m’a marqué : une nuit, nous sommes à l’hôtel à Séoul, il
est 3 heures du matin, et nous sommes réveillés par des cris de femme
effroyables… Nous descendons, bien entendu, voir ce qui se passe et nous
trouvons le gardien en train de traîner une femme, assez jeune, avec un
enfant. L’enfant est visiblement malade, c’est assez effrayant, et elle
veut l’emmener à l’hôpital. Bien sûr, il n’y a aucune voiture, aucune
ambulance, ainsi que je vous le disais… et la seule automobile
disponible est celle des Nations Unies, mais le gardien des Nations
Unies était de par sa charge très réticent à nous la donner, et ce n’est
qu’après de longues discussions que nous avons, enfin, réussi à emmener
l’enfant à l’hôpital. Vous comprenez, maintenant, pourquoi je me réjouis
encore aujourd’hui des encombrements de voitures ! Pour l’anecdote,
encore, lorsque nous sommes arrivés en avion au-dessus de Séoul, en
1948, le pilote était très angoissé parce que le jour tombait et qu’il
n’y avait sur cet aéroport aucune lumière ! Je suis retourné en Corée,
plus de trente ans après, je suis arrivé alors dans un aéroport d’une
beauté… puis je suis monté dans une véhicule et j’ai demandé à la petite
interprète la marque de cette voiture : elle était de marque coréenne !
Or, pour moi, il était très difficile d’imaginer qu’il puisse exister
une marque d’automobiles coréennes, et qu’il puisse y en avoir autant !
Plus sérieusement, mon émotion a été alors grande de voir ce peuple qui
a connu deux guerres affreuses, qui leur ont coûté des millions
d’hommes, reconstruire et réussir tant de choses. C’était vraiment
bouleversant. Un jour, lors des jeux Olympiques de Séoul, on m’a conduit
dans un endroit, très boisé, que je ne reconnaissais pas ; je demande
alors où nous sommes, je suis surpris, je ne reconnais absolument pas,
c’était avant un total désert… On m’a simplement répondu : « vous
comprenez, nous avons pris l’habitude de planter un arbre à chaque fois
qu’il y a un évènement heureux… ». C’était devenu une véritable forêt !
Tout est comme cela. La Corée, c’est aussi, pour moi, un épisode
amoureux qui a donné naissance à un roman Obscur ennemi (1961, Editions
Gallimard) qui se déroule en Corée…

© Jean Blot
La Grèce est une tout autre expérience, un miracle très différent. Comme
je vous l’ai déjà dit, ma jeunesse n’a pas été très drôle, être juif
russe, c’était vraiment très malsain, j’ai beaucoup couru…Or, j’arrive
en janvier 1947 en Grèce sur un bateau de guerre, c’était la guerre
civile, et nous étions là en qualité de nouveaux observateurs. Et
pourtant, c’est en ces lieux que j’ai découvert le bonheur, le plaisir
de vivre. Il ne s’agit pas pour autant d’oublier à cette époque les
horreurs de la guerre civile que nous devions constater en tant
qu’observateurs. Mais surtout, la Grèce, et je n’ai jamais réussi à
l’écrire, est un mystère. L’Italie est belle, tout y est beau, mais en
Grèce, il y un rapport à la vie immédiate, à la vie quotidienne, à la
nature que vous n’avez nulle part ailleurs. C’est en Grèce que j’ai
appris à boire un verre d’eau ! Et même aujourd’hui, soixante ans après
l’avoir découverte, je pense que le miracle, malgré tout, y est encore
présent. C’est une magie que je ne peux pas vraiment décrire et
expliciter parce que je n’en trouve pas vraiment le ressort. C’est
au-delà du fait que la mer est bleue, que le vin est de l’ouzo, etc. La
Grèce tout entière tient sur un clou rouillé dans un mur qui s’effondre,
et le reste, c’est le Bon Dieu ! Cette totale liberté, cette absence de
responsabilité, c’est fabuleux pour un juif …Je vais vous raconter, de
nouveau, une anecdote : un ami grec qui était dans les années 50 très
friand des fameuses pilules de jouvence en provenance de Roumanie et à
l’époque très à la mode, me dit un jour : « tu sais, j’ai bien réfléchi,
tu vas me trouver un poste à l’UNESCO, je vais travailler dix ans,
prendrai ces pilules de jeunesse, après quoi, je peindrai… » ; un peu,
étonné, je lui réponds « ah bon…», et là, très confiant, il me répond :
« Connais-tu, au fait, une bonne galerie ? » ! (rires) Voilà, c’est
cela."
Vous avez tout au long de votre riche vie professionnelle exploré les
arcanes des langues principales sur lesquelles vous aviez à travailler.
Quels liens percevez-vous entre la langue – maternelle et celles
acquises par la suite – et la littérature ? Certains de vos livres sont
traduits en langues étrangères, comment réagissez-vous à cela en étant à
la fois leur auteur et en même temps avec votre regard d’interprète ?
Jean Blot : "Je pense que quelqu’un qui me lirait attentivement
devinerait que je suis Russe, du moins slave. Il y a quelque part, dans
mes livres, une sensibilité slave, certes, très difficile à définir,
sinon dans un débordement, un manque de retenue sentimentale et
affective. Il n’y a pas ces barrières que mettent notamment les
Français, mais une relation intersubjective beaucoup plus riche tout en
étant, cependant, bien plus dangereuse. Je crois que le slave a une
affectivité, peut-être, non pas plus profonde, mais plus en éveil, plus
présente ou plus simplement moins retenue… Concernant le style même, je
ne pense pas en revanche qu’il y ait une influence venant du russe ;
concernant mon dernier livre, Le rendez-vous de la Marquise (2014,
Editions l’Âge d’Homme), les premières réactions, qui me sont revenues,
soulignent qu’il est écrit dans un style très français. C’est vrai que
j’aime beaucoup la langue française, peut-être même un peu trop !"
Justement, quel regard portez-vous aujourd’hui sur la culture et sur
le livre, en tant que directeur de la collection Les Cosmopolites aux
Éditions La Bibliothèque ?
Jean Blot : "Vous savez, Euripide nous a laissé un volume entier
de notes, de projets, lettres, etc., et parmi ses phrases, il y en a une
que je ne saurais que trop recommander et qui est celle-ci : « Hélas
!...il n’y a rien de bon dans les nouvelles générations. », écrite
400 ans av. J.-C. ! Éternel débat, mais je pense aussi qu’il n’y a rien
de bon dans la nouvelle génération, même s’il y a néanmoins beaucoup de
choses qui se passent… Spontanément, évidemment, je suis d’un autre
siècle et me sens étranger dans le XXIe siècle. Cela dit, j’admire
beaucoup – étant membre de beaucoup de jurys – de bons livres, de bons
écrivains, mais ces derniers n’arrivent pas à sortir, à s’imposer. Il
n’y a pas ces personnalités fortes, qu’avait notamment Camus ou de
manière très différente Cohen, cette aura qu’avait aussi Neruda et
Marquez que j’ai connus également, et qui est bien plus que du charme,
mais un véritable charisme. Or, ce charisme, aujourd’hui, fait défaut.
Il est vrai que le charisme en France est suspect ; nous n’avons pas en
France, je pense, de Shakespeare, de Goethe, parce que nous avons en
France un esprit trop critique extrêmement cassant n’aimant pas le
charisme. Tout Français est voltairien ! Certes, nous lui devons
beaucoup de choses, mais dans ce domaine, celui de la littérature,
Voltaire s’avère être opposé au fait d’être un grand écrivain. Nous
aimons bien bousculer le piédestal. La littérature, pour moi, n’existe
que dans deux pays : en Russie, mais seulement pendant un siècle, et en
France avec le XVIIIe siècle.

Maison de l'Amérique Latine, hommage à
Georges Emmanuel Clancier
(©
photo Gyula Zarand : P.E.N. CLUB
Français)
___________________________
"Kafka est, certes, un grand écrivain,
un génie, mais je ne suis pas différent parce que j’ai lu Kafka, en
revanche, je suis devenu autre parce que j’ai lu Proust."
___________________________
Mon cher Professeur Etiemble pensait que
la littérature ne commençait qu’à partir du moment où la religion en
sortait et la remplaçait. Aujourd’hui, je suis certain que la
littérature n’a plus ce poids. Voyez-vous, Kafka est, certes, un grand
écrivain, un génie, mais je ne suis pas différent parce que j’ai lu
Kafka, en revanche, je suis devenu autre parce que j’ai lu Proust. La
vraie littérature a un rôle au-delà de la formation, un rôle déterminant
de création intérieure. En ce qui concerne la culture, ce domaine bien
plus vaste, je m’en suis occupé toute la deuxième partie de ma vie en
tant que Directeur de la création artistique à l’UNESCO. Cela
inquiétait, d’ailleurs, beaucoup mon père que je cherchais à rassurer en
lui disant que tout ce que je faisais revenait simplement à passer des
coups de téléphone ! J’ai d’ailleurs écrit un texte qui s’appelle
Recommandation internationale sur la condition de l’écrivain et de la
Russie qui a été adoptée à l’unanimité après deux ans et au moins
157 amendements, mais dont personne n’a entendu parler ! Néanmoins,
cette question de la condition de l’écrivain m’a toujours semblé, et me
semble encore, un point capital, mais dans l’action culturelle, il faut
être extrêmement patient et ne jamais brusquer les choses. Je suis un
grand partisan de l’UNESCO. J’ai composé un livre Dans l’esprit des
hommes parce qu’il est écrit dans la charte de l’UNESCO que les
guerres commençant dans l’esprit des hommes, il importe, dès lors, que
ce soit également dans l’esprit des hommes que l’on jette les bases de
la paix. Il faut que la guerre devienne impensable."
Peut-on pour finir parler de vos derniers livres ? Les enfants de
New York aux Editions La Bibliothèque et Le rendez-vous de la
marquise aux Editions L’âge d’Homme…
Jean Blot : "Mon ouvrage Les enfants de New York vient d’être
réédité aux Éditions La Bibliothèque avec cette ambiance particulière de
l’après-guerre… Et puis, l’âge venant, j’ai aussi eu envie d’écrire une
satire aimable, drôle de tout ce dont finalement nous avions souffert.
On y trouve la politique, la littérature, la catastrophe de l’art
contemporain… Pour l’art contemporain, j’ai des idées tellement
réservées que je passe le plus souvent pour un réactionnaire ! Vous
savez Breton a écrit qu’avec Valery, ils n’étaient d’accord sur rien,
mais qu’ils étaient tout de même d’accord pour dire que jamais ni l’un
ni l’autre n’écrirait : « La marquise sortit à cinq heures… » ; parce
que ce « sortit à cinq heures », c’est la réalité, la vie quotidienne.
Or, si vous acceptez d’accueillir la vie quotidienne, vous vous
apercevez assez rapidement qu’elle va vous mener par le bout du nez.
J’ai essayé de montrer comment l’histoire s’impose à l’écrivain, il y a
des personnages que vous découvrez et que l’écrivain n’avait pas prévus,
et en même temps, l’exigence de maintenir cette volonté de la réalité et
ce respect de la réalité. Pour moi, il n’y a d’art que dans la mimesis,
non dans l’imitation, mais dans la reproduction. Et cela est vrai pour
la peinture, la littérature, et peut-être aussi pour la politique. En
tout cas, je me suis beaucoup amusé en écrivant ce livre, Le rendez-vous
de la marquise, et j’espère surtout que mon lecteur s’amusera aussi !"

© Jean Blot
Un grand merci à Jean Blot, d'avoir
trouvé l'énergie et le temps pour ce témoignage plein d'optimisme
adressé à nos lecteurs !
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
© Lexnews
|
|
Interview Joachim
Sartorius
Îles des Princes
Janvier 2016 |
|
 |

© Mathias Bothor |
|
Né en 1946 en Bavière, Joachim
Sartorius, poète, écrivain, traducteur, a beaucoup voyagé, Tunis dans
sans jeunesse, Congo, Cameroun, New York, Istanbul, Nicosie... Il a
dirigé, de 2001 à 2011, le festival de Berlin, et est actuellement
membre du PEN Club d’Allemagne, de l'Académie allemande de langue et de
littérature et participe à la Geschäftsführung der Kulturveranstaltungen
des Bundes à Berlin. Il a reçu la distinction de Chevalier des Arts et
des Lettres en 2011. Auteur et traducteur de nombreux ouvrages ou
recueils, traduits pour certains en français (Des ombres sous les
vagues, Ed. Grèges, 2005 ; A Tunis, les palmiers sont menteurs,
Ed. Atelier La Feugraie, 2007), il a bien voulu répondre à nos questions
à l’occasion de la parution de son dernier livre Iles des Princes,
traduit de l’allemand par Françoise David-Schaumann et Joël Vincent, et
paru aux Editions la Bibliothèque.

© Mathias Bothor
 ouvez-vous
nous parler un peu de vous ? Poète, écrivain, traducteur, vous avez
aussi beaucoup voyagé, un parcours qui vous a valu d’être nommé
Chevalier des Arts et des Lettres en France par Frédéric Mitterrand en
2011… ouvez-vous
nous parler un peu de vous ? Poète, écrivain, traducteur, vous avez
aussi beaucoup voyagé, un parcours qui vous a valu d’être nommé
Chevalier des Arts et des Lettres en France par Frédéric Mitterrand en
2011…
Joachim Sartorius :
Mes amis allemands m´ont donné le sobriquet « bunter Hund » ce
qui veut dire mot à mot « chien bariolé ». En français, est-ce le loup
blanc ? Ils m´ont appelé ainsi parce que j´ai fait beaucoup de choses
différentes dans ma vie. Toujours nomade, toujours voyageur, mais aussi
imprésario, poète, champion d´une politique culturelle européenne, etc.
Mais j´ai été nommé Chevalier pour des raisons précises : lorsque
j´étais directeur des festivals de Berlin, j´avais invité beaucoup de
productions françaises, de théâtre, de danse – d´Isabelle Huppert
jusqu´à la Compagnie Royal de Luxe de Nantes avec ses géants. Et j´ai
traduit des poètes français en allemand, Bernard Noel, et surtout,
Lorand Gaspar.

Vue du Splendid Hotel sur l´embarcadère
de Büyükada
A quelle occasion avez-vous découvert précisément les Iles des
Princes ?
Joachim Sartorius
: C´est une amie d´Istanbul, Sezer Duru,
journaliste et traductrice, qui m´a emmené un jour aux Iles des Princes.
C´était en 1979. C´était une excursion, rien d´autre, et je l´ai décrite
dans mon livre.

La maison de Trotski à Büyükada
Vous attendiez-vous à tomber sous leurs charmes ? Et quand avez-vous
décidé de leur consacrer cet ouvrage ?
Joachim Sartorius
: Cette première visite, il y a bien plus de 35 ans, a laissé une marque
indélébile dans ma mémoire. Les îles étaient charmantes à cette époque,
un microcosme cosmopolite sous une cloche, avec des traces byzantines,
grecques et ottomanes, des jardins exubérants, et une grâce certaine des
insulaires… Malgré de nombreuses visites après cette première rencontre
j´ai pris la décision d´écrire ce livre assez tard, en 2008.
|
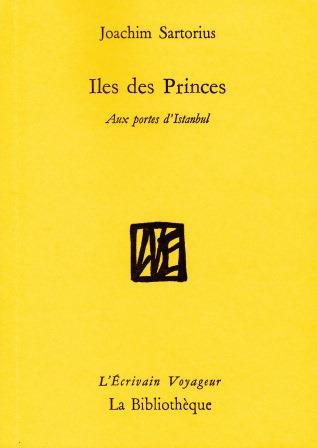
Joachim Sartorius Iles des Princes - Aux
portes d'Istanbul Collection L'Écrivain Voyageur, 163 pages, quatre
illustrations Éditions La Bibliothèque, 2016.
Chapelet d'îles de la mer de Marmara, faubourg heureux d'Istanbul,
Trotski s'y réfugia. Qui connaît ces îles enchantées, lumineuses, d'où
l'on voit la couture de l'Europe et de l'Asie ? Se mettre dans les pas
de Joachim Sartorius, voir les Arméniens parler aux chevaux, écouter les
rumeurs turques, grecques, byzantines, charriées par la mer, que
demander de plus ?
_________________________
Vous abordez l’histoire, la croisée
des religions, mais vous ne souhaitez pas décrire ces Iles dans votre
ouvrage en historien, et encore moins en historien des religions,
semble-t-il…
Joachim Sartorius
: J´ai écrit ce livre avec une stratégie de plaisir. Et les lecteurs
sentent cela, c’est peut-être la raison pour laquelle ils aiment ce
livre ? Traduit à présent dans plusieurs langues, en anglais, en turc,
bien sûr, mais aussi en croate et même en arabe. Je ne suis pas
historien. Je voulais écrire ce livre en tant que poète, je voulais un
livre sensuel, un livre d´aujourd’hui, avec quelques excursions dans le
passé pour comprendre le présent.

Vue du quartier Nizam sur la peninsule
Dilburun
Vous ne semblez pas accorder une grande place – disons- à la «
possession », on sent dans votre écriture un certain détachement avec un
vif sentiment de vie souligné par les sens (voir, sentir, manger,
boire…)…
Joachim Sartorius :
Un critique allemand a dit que ce livre
est parmi d´autres choses un autoportrait, et c’est vrai que je me
trouve dans une sorte de posture oblique au monde. C´est peut-être là
une définition de ce que vous appelez détachement. Un poète doit avoir
cette faculté de s´immerger, de se donner pleinement aux sens, mais
aussi de pouvoir se retirer des affairements et voir les choses de loin,
d´une plate-forme solitaire.
Peut-on encore aujourd’hui espérer
retrouver ces Iles des Princes, vos Iles des Princes ? Présentent-elles
encore ce côté charmeur et cosmopolite ?
Joachim Sartorius
: Les Iles des Princes ont certainement
changé. Moins de cosmopolitisme. Un islamisme rampant. Un influx
croissant de touristes en été. Je vous conseille d´y aller fin octobre
ou début mai. Vous pourriez alors découvrir encore les merveilles de cet
archipel que je décris dans mon livre.
Comment percevez-vous leur avenir
(politiquement, économiquement, écologiquement) ?
Joachim Sartorius
: La distance à la mégapole Istanbul (50 minutes avec bateau) protège
les îles de trop de développement commercial et des prometteurs.
L´interdiction complète des voitures est un autre frein à un
développement déraisonnable. Et il y a un mouvement écologique
heureusement assez fort pour protéger l´environnement et conserver les
zones vertes, surtout à Büyükada.

Joachim Sartorius avec son chat turc
Merci à Joachim Sartorius d'avoir eu la
gentillesse de répondre à nos questions en français et pour cette
invitation au voyage...
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
© Lexnews
|
|
Interview
Yves Bonnefoy
Paris 13 juin 2014
|
|

Yves Bonnefoy. - Photo DR/Mercure de France |
 |
|
Est-il encore besoin de présenter Yves
Bonnefoy, né à Tours le 24 juin 1923, l’un des poètes les plus renommés
des XXe et XXIe siècles et dont l’œuvre n’a pas fini de nous ravir. Yves
Bonnefoy est non seulement un poète majeur, mais également un traducteur
réputé pour la valeur des textes qu’il a su rendre dans la langue
française, ainsi qu'un essayiste dont la finesse d’analyse est aussi
remarquable sur Baudelaire que sur Rimbaud en « passant » par Shakespeare
ou encore la peinture italienne de la Renaissance… Poésie, littérature,
philosophie, peinture s’unissent dans la réflexion d’Yves Bonnefoy afin
d’interroger l’essence même de la création. Rencontre avec un grand poète
humaniste des temps modernes.
 ouvez-vous nous parler de
votre point de départ en poésie, influences subies, lectures à cette
époque ? Pouvez-vous nous donner le portrait du poète Yves Bonnefoy en
jeune homme ? ouvez-vous nous parler de
votre point de départ en poésie, influences subies, lectures à cette
époque ? Pouvez-vous nous donner le portrait du poète Yves Bonnefoy en
jeune homme ?
Yves Bonnefoy : "Qui étais-je, en mes commencements ? D’abord un
grand ignorant. J’allais à l’école, au lycée, et je découvrais
qu’existaient des philosophes, des artistes, des poètes surtout, dont le
peu qui m’en parvenait me fascinait, je comprenais bien que c’était en eux
et par eux que la condition humaine, si peu attrayante là où j’étais, et
en ces années, pouvait prendre sens, manifester sa richesse. Mais ce lieu,
ce moment étaient aussi ce qui me privait de ces œuvres. J’étais dans une
petite ville encore tout à fait endormie, je vivais dans un milieu ouvrier
très à l’écart des faits de culture, c’était l’immédiate avant-guerre, qui
retenait son souffle dans le pressentiment du désastre, puis ce furent les
années de guerre, où je ne pus trouver que bien peu de livres, à part
quelques-uns des surréalistes, que l’on vendait à bas prix à la librairie
de la gare où je prenais le train chaque soir. Après quoi je vins à Paris
mais les musées étaient fermés et aussi je m’étais laissé empiéger dans
l’aventure surréaliste, avec son vrai sens de la poésie mais son savoir
artistique très limité et ses jugements sectaires, qui refusaient de même
seulement regarder la peinture que j’étais destiné à aimer si fort quand
je pus enfin en découvrir les vraies œuvres, en leur étonnante diversité.
Et qui proscrivaient la musique... Que la nuit tombe sur l’orchestre,
écrivait Breton. Ce n’était pas par ce chemin là que j’aurais pu accéder à
ce que pourtant je désirais déjà rencontrer, je n’en doute pas.
Beaucoup de temps perdu ! Mais cette longue période de disette, je suis
prêt maintenant à la reconnaître comme une chance. Car les quelques œuvres
qu’en mes années d’enfance ou d’adolescence il m’avait été possible
d’apercevoir loin, là-bas, dans leur autre monde, en prirent à mes yeux un
caractère qu’elles n’auraient pas eu si j’avais vécu d’emblée dans
l’espace de la culture : elles me parurent les manifestations, non d’un
autre moment et d’un autre lieu de ma société mais d’une réalité autre,
supérieure, avec des auteurs avertis de plus que ce qu’on peut vivre ou
connaître dans notre condition ordinaire. Et cette façon d’aborder Hugo,
Racine ou Vigny - mes premières lectures – ou, surtout peut-être, de
questionner de petites reproductions en noir et blanc de Titien ou de
Véronèse, c’était du rêve, bien sûr, et profondément dangereux pour la vie
comme il faut la vivre, aussi près que possible de son ici, de son
maintenant, mais c’était aussi de quoi réfléchir à ce rêve, précisément,
et en comprendre la nature et faire de cette réflexion le ressort d’une
recherche avertie des véritables enjeux. Cette idée d’une réalité
supérieure, je la crois inhérente à tout commencement poétique, en effet.
Et plus vite et plus fortement on la forme, et plus facilement on a chance
d’en faire cette critique qui est le sérieux de la poésie.
Tels furent mes débuts, en tout cas. Moins la lecture des tragédies de
Racine, qu’une façon de faire cette lecture, avec encore inconsciente mais
bien en place cette double approche des œuvres, d’une part le sentiment
que - la plupart des autres ne comptant pas, absolument pas - certaines,
les seules vraiment poétiques, relevaient, elles, de plus que notre monde
sans être ; et d’autre part, et comme à rebours, la pensée que tout se
joue dans ce monde, parmi des illusions, des mirages, qu’il faut apprendre
à déjouer.
Évidemment, vous disant cela, je simplifie beaucoup, je sais bien. Et si
je disposais du regard du romancier et avais le goût des faits de
psychologie je ne me contenterais pas de ce simple rappel d’une pensée
mais vous dirais mon temps perdu d’alors, mes occupations frivoles, mes
lectures trop au hasard, paresseuses, puis, même arrivé à Paris, tant de
conversations pour rien à propos de quelques petits événements du
crépuscule surréalistes, tant de parties d’échecs sans étude poussée du
jeu, tant d’occasions manquées dans les rencontres possibles : bref,
l’impression que j’ai, rétroactivement, d’une longue période de latence
qui ne prit fin que vers 1950, quand je quittai le quartier latin, la
chambre d’hôtel aux visiteurs trop nombreux, pour un logement en proche
banlieue, soudaine et salubre solitude.
Mais je crois un fait, tout de même, cette dialectique que je viens
d’évoquer : de rêves d’une réalité supérieure et de déni de leurs
illusions. Et en tout cas je sais bien qu’elle a orienté mes premières
lectures vraiment sérieuses - quand je repris la voie des études, allant
de plus en plus écouter Jean Wahl - et nourri mes premiers écrits.
Cependant que c’est elle aussi qui me fit aimer, au premier instant, le
monde méditerranéen quand je le découvris en Corse en 1949. Les îles comme
soulevées dans le ciel par la lumière de l’aube, l’odeur du thym, les feux
dans le maquis trouant les nuits de leur flamme, c’était là ce qui avait
suscité à l’aube de l’Occident les métaphysiques gnostiques qui me
hantaient. Il ne me restait plus qu’à rencontrer en Italie et en Grèce les
réponses que de grands artistes et quelques penseurs, ainsi Plotin,
avaient apportées aux questions que posait cette sorte de lieux, de
monuments, d’horizons, si constamment de la nature des archétypes et si
différents de tout ce que j’avais vécu jusqu’alors, ou imaginé."
___________________________
"...ainsi ne s’agissait-il que d’une autre façon de vivre la réalité
humaine fondamentale, le même corps avec les mêmes mots pour le dire, la
même langue avec simplement dans son emploi une ardeur et une lucidité
que j’aurais volontiers dénommées la poésie."
___________________________
Dans vos poèmes on ressent une présence
mystique, un monde en attente et un qui est à venir. Ne pourrait-on
parler d'une sorte de religiosité de votre poésie ? Comment celle-ci a–t-elle
été renforcée par les autres arts ? - On peut penser à la musique et à
la peinture qui surgissent partout dans votre œuvre.
Yves Bonnefoy : "Ce que vous suggérez ainsi rejoint ce que je
viens d’essayer de dire et me permet de le préciser. Le rêve que
j’évoquais, c’était donc celui d’une réalité certes supérieure mais
nullement constituée pour autant de choses ou d’êtres supraterrestres,
différents par l’apparence ou les habitudes de ce qu’on rencontre dans
notre monde : ainsi ne s’agissait-il que d’une autre façon de vivre la
réalité humaine fondamentale, le même corps avec les mêmes mots pour le
dire, la même langue avec simplement dans son emploi une ardeur et une
lucidité que j’aurais volontiers dénommées la poésie. Là-bas les mots
d’ici, mais au plus vif, au plus pénétrant, de leur pouvoir resté parmi
nous en friches pour une raison encore à comprendre... Eh bien, appelez
cela de la religiosité, je veux bien, mais constatez qu’elle ne
s’embarrasse pas de croyances en des figures divines. C’est notre terre
telle qu’elle est, bien suffisamment belle quand on ne la saccage pas,
comme si souvent aujourd’hui, qui me semblait déjà le réel, le seul
réel.
Et voici pourquoi, aussi bien, la recherche artistique et en particulier
la peinture sont importantes pour cette sorte de rêve d’essence
métaphysique. L’intensité dont de grands peintres ont imprégné la figure
des choses - arbres, fleuves, nuées, visages - qui constituent le lieu
humain, c’est comme une confirmation des intuitions de ce rêve, et il
m’était facile, quand je me laissais envahir par lui, d’imaginer que tel
paysage qu’un Ruysdael avait peint, avec ses arbres profonds, son ciel
troué de lumières, ce peintre l’avait perçu, dans notre monde pourtant,
avec les yeux décillés de cette conscience plus pénétrante, plus
avertie, que la nôtre. D’où suit que c’est tout de suite et très fort
que j’ai aimé la grande peinture de paysage, celle qui se déploie au
XVIIème siècle en Italie ou aux Pays-Bas avec une ampleur et une
richesse encore aujourd’hui sous-estimées.
Aux XVème et XVIème siècles sauf par moments, ainsi le grand horizon de
l’Agneau mystique ou la pittura chiara de Piero della
Francesca ou l’arrière-plan à mes yeux sublime du Noli me tangere
de Corrège, la perception du monde naturel reste entravée par la
conviction chrétienne que la seule pleine réalité est dans le monde
invisible, soit les sphères célestes, qui sont d’abord harmonie,
musique, soit le Paradis où les croyants de ces époques inquiètes
espéraient revivre après leur mort. L’apparaître des choses et celui,
d’abord, du corps humain peinaient à se dégager des figures symboliques
qui signifiaient dans notre ici-bas cet invisible, d’où pour finir le
drame du maniérisme, qui montre les corps tyrannisés, déformés par des
pensées parfois violemment antinaturelles.
Mais il y eut Galilée, dont j’ai souvent remarqué qu’en révélant la
nature matérielle du sol de la lune, crue jusqu’à lui l’émergence du
divin dans le monde de la nature, il avait ajouté à celui-ci la pièce
manquante et ainsi achevé de mettre en place le lieu humain. Désormais
l’homme et même la femme sont chez eux, tout à fait chez eux, sur la
terre, et ils peuvent investir dans les grands aspects de leur lieu
enfin pleinement perçu ce besoin de vie pleine qu’ils avaient associé
jusqu’alors à des figures surnaturelles. C’est désormais dans les
feuillages, dans la lumière du ciel irisant des cimes lointaines, et au
premier plan dans des corps riches de toute leur chair, qu’ils
rencontrent la transcendance inhérente à tout ce qui est ; et l’évidente
beauté du monde peut ainsi se déployer dans la plus humble des choses
sans rien perdre de son mystère. Ce vont être les grands paysagistes
que j’évoquais.
Les Saisons de Poussin, le printemps, l’été, l’automne, quel apex
dans ce grand art de la terre enfin comprise et conquise ! Et voilà
certes de quoi nourrir mon rêve de vie vécue plus profondément, après
quoi, et toujours en peinture, il y eut - ce fut « L’hiver » dans ces
mêmes Saisons, et les tableaux de Gaspard Dughet, l’arbre isolé,
secoué par le vent, dans le désordre d’un grand espace – de quoi, cette
fois, mettre en question cette superbe utopie. Assurément il faut se
dégager de ce grand rêve, recentrer la réalité sur l’être mortel dans
son moment et son lieu ; mais, voyez, chez Dughet ou parfois Salvator
Rosa, c’est encore le paysage qui reste le lieu de la réflexion. Et
comment ne pas écouter les peintres, par conséquent ? Souvent chez eux
l’eau des apparences est calme, le ciel de ce monde s’y reflète, et
souvent aussi elle se trouble, notre inquiétude y plonge sa main, mais
ces couleurs agitées, ces formes brisées ne restent pas moins ce par
quoi le souci métaphysique s’exprime.
Quant à la musique, n’est-il pas naturel que les rêves de plénitude y
cherchent aussi des preuves ? Pensez à des cantates de Bach. À des
moments de mystérieuse jubilation au plus haut des grandes messes de
Haydn, est-ce là extase chrétienne, ne serait-ce pas plutôt l’accession
à un état supérieur de l’être au monde transgressant, transcendant le
mythe chrétien que cette musique d’église avait si longtemps servi ?
Après quoi ce sera aussi en musique que l’on pourra cette fois encore
comprendre qu’il faut faire retour, par la voie de la subjectivité
douloureuse, celle du dernier Beethoven, de Schubert, de Chopin, plus
tard de Gustav Mahler, à la condition simplement mortelle si on veut
vraiment boire à la coupe de l’absolu. En musique aussi à la fois on
rêve et on renonce au rêve. C’est ce renoncement accompagné de regret
qui me rend si cher le Chant de la terre.
Aujourd’hui encore je me laisse aller à regarder des tableaux, des
statues, comme si c’étaient des promesses, voire des seuils. Et beaucoup
des poètes et des peintres que j’aime le plus, de Virgile à Poussin et à
Gérard de Nerval, sont assurément les porteurs, par moments ou
durablement, d’une rêverie de cette sorte et en font paraître la
lumière, qui n’est semblable à nulle autre. Mais, je dois revenir sur ce
point, je dois le souligner avec force : ce rêve n’est pas la vérité, et
la poésie, qui le subit de plein fouet, a pour vocation de percer à jour
cet illusoire. De reconnaître qu’est plus haute lumière ce que Rimbaud
nommait la « réalité rugueuse » ; ou ce que Baudelaire vivait dans la
misère des jours avec celle qui « essuyait son front baigné de sueur et
rafraîchissait ses lèvres parcheminées par la fièvre ».
La poésie française, en particulier le
surréalisme, fut la base de notre culture littéraire. Mais aujourd'hui
la France donne l'impression à l'observateur étranger qu'elle a oublié
la poésie ou qu'elle s'occupe exclusivement de la poésie visuelle. Pour
vous qui avez grandi avec Valéry, qui êtes passé par le surréalisme, qui
vous êtes aussi opposé à lui et avez tracé votre propre voie, comment
voyez-vous la poésie française actuelle?
Yves Bonnefoy : "Arrêtons-nous à cette
question que vous me posez à bon droit, elle ne m’écartera pas du chemin
que votre première m’a incité à prendre. Oui, il faut bien constater que
la pensée qui prévaut en France en ce moment en matière artistique ou
littéraire semble ne plus guère comprendre ce que c’est que la poésie.
En tout cas elle en sous-estime la nécessité au sein du groupe social
comme si elle avait oublié le rôle qu’elle joua aux époques où elle
n’était pas marginalisée, comme aujourd’hui. Il y a présentement un «
littérairement correct » qui valorise la dérision, voire l’autodérision,
ce qui est bien la meilleure façon d’étouffer la sensibilité poétique.
Et à ce triste fait il y a des raisons qui sont assurément aussi
fondamentales qu’universelles, ainsi l’objet manufacturé, qui obstrue de
son omniprésence aujourd’hui l’abord et l’intelligence de ce qui est vie
dans le monde, mais ce qui n’est dans d’autres pays qu’à son début
semble en France avoir déjà triomphé, et il ne faut pas en être surpris.
Notre pays a donné au monde, en particulier au XIXème siècle, à l’aube
de la société industrielle, quelques-uns de ses plus grands poètes mais
je crois ou plutôt je sais qu’ils ne furent grands que parce qu’ils
avaient, belles occasions de lucidité, de courage, à combattre les
ennemis qui se rassemblaient autour d’eux. Je pourrais vous citer des
jugements de Baudelaire, de Rimbaud, de Mallarmé, sur leur société comme
l’anti-poésie. Est-ce à cause d’une langue où le manque d’accent
tonique, cet accès naturel au rythme, à la poésie, laisse le champ libre
à l’accent exclamatif, celui qui souligne l’idée dans le débat, la
conversation, pour le plus grand profit du seul intellect ? En France la
poésie semble bien censurée par le vouloir impérieux de l’intellect. Au
risque d’une désertification où ne fleuriront plus qu’esprit de dérision
ou cris de désespoir ou mensongère éloquence. Beckett déjà, Artaud déjà,
Aragon.
Mais la situation n’est pas aussi simple, heureusement. L’absence
d’accent tonique est compensé dans notre parole par le e muet et les
diérèses, voies, par la profondeur, de cette prosodie mystérieuse propre
au français dont a parlé Baudelaire, qui en fut d’ailleurs un des
maîtres.
(...)
Et l’absence des poètes – des vrais
poètes – dans les conseils de la société incite les meilleurs esprits à
réfléchir sur la précarité en fait essentielle du poétique, ce qui nous
vaut des poètes conscients de la poésie, critiques de ses illusions,
avertis des faux-semblants et autres mensonges qui grèvent si souvent le
légitime lyrisme. Une avant-garde de la réflexion dont je crains que
bientôt on ait besoin dans d’autres pays."
|
Les dernières parutions d'Yves Bonnefoy...
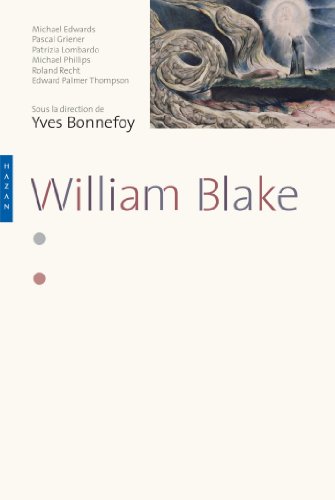 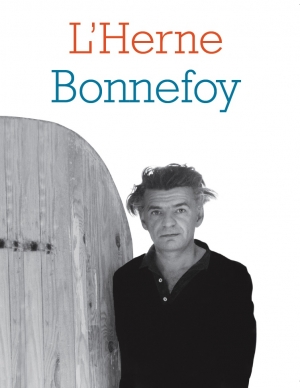
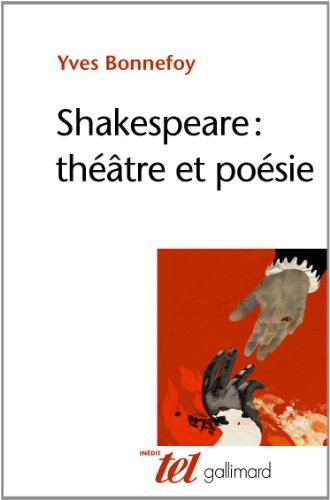 
_______________________
Et, même si vous avez directement ou
indirectement répondu à cette question dans plusieurs essais, peut-on
vous demander aussi, avec l'expérience que vous avez, quelle définition
donneriez-vous aujourd'hui de la poésie ?
Yves Bonnefoy : "Je vais répondre d‘abord, et d’ailleurs surtout,
à la première des deux questions, parce que ce ne sera que reprendre une
réflexion qui, ma vie durant, n’a guère eu de cesse, étant donnée la
nature particulière de mes écrits. Je me suis depuis très longtemps
adonné simultanément à des projets d’écriture de sorte fort différente,
et cette diversité m’est évidemment une raison d’inquiétude : elle me
fait craindre un étalement en surface de préoccupations qui devraient
bien plutôt se concentrer pour s’approfondir.
En somme il me faut vérifier si est vrai ce que tout de même j’espère, à
savoir qu’il y a quelque unité sous ma dispersion apparente. Qu’il en
soit ainsi, je suis prêt à le croire, mais encore faut-il que tant soit
peu je comprenne en quoi consiste cette unité, pour mieux en reconnaître
les composantes et dialectiser ma recherche. Et c’est précisément cette
réflexion que présentement j’entreprends de faire : intitulant « L’Un et
le Multiple » l’essai qui en adviendra... Ce que j’écris, présentement ?
À part une étude du rapport des peintres de la Renaissance à
l’imaginaire des Grecs et Latins de l’antiquité, et une autre sur les
visées de l’allégorique en poésie, notamment chez Baudelaire – aussi,
bien sûr, l’ordinaire écoute des mots, dite poème -, c’est cet essai,
c’est sa préoccupation à la fois prospective et rétrospective.
Et voici, grosso modo, ce que j’essaierai de dire, et ce sera une
réponse, un embryon de réponse à votre seconde question, bien
naturellement votre ultime. Inquiète, ma réflexion sur l’un et le
multiple en ce que j’écris ? Oui, bien sûr, n’est-ce pas dans
l’expérience de l’unité et dans sa préservation que tout se joue ? Que
j’en vienne à ne plus ressentir que la réalité est une, que je me laisse
retenir par le spectacle de tel ou tel de ses phénomènes, et je serai
alors au niveau de la matière, cette surface, je ne saurai plus que ce
qui importe, ce ne sont pas les aspects et les lois de celle-ci mais le
monde des existences avec au centre de ce monde nos vies humaines,
engagées depuis les premiers pas du langage dans cette donation de sens
- dans cette instauration d’être - qu’est la société, second degré du
réel. Perdre le sens de l’unité, et c’est abandonner ce projet de
promotion de la réalité par le verbe, laissant le langage s’ouvrir, tel
un champ abandonné à la mauvaise herbe, aux seules formulations des lois
de la matière. Laquelle, alors, absorbant les mots, les réduisant au
dire de ses aspects, se refermerait sur soi par absorption du langage,
devenu un désert aussi inconscient de son être propre que les galaxies
dans le ciel.
Nous avons à savoir l’unité, à la ressentir au profond de nous où
heureusement elle existe, ce sont les élans de l’affection, de la
compassion, les émerveillements qu’on éprouve devant la beauté des
paysages, ceux-ci en eux-mêmes une plus haute réalité que leurs
composantes. Et pour ma part, en tant qu’écrivain, c’est-à-dire
quelqu’un qui veut assumer la tâche de garder en vie le langage, d’y
préserver la parole, j’ai plus que quiconque ce devoir. Le méconnaître
serait trahir la cause humaine et d’autant plus coupablement que je
prétends assumer cette responsabilité qu’est la poésie.
Toutefois, ce qu’il me faut aussi, et d’abord, c’est tenter de mieux
comprendre et mieux dire cette impression d’unité qu’a la poésie en son
expérience du monde, et le rapport de cette impression, de ce besoin, à
ce que nous sommes ou avons à être.
L’unité, l’expérience de l’unité, c’est - par exemple - quand nous
sommes en présence d’un homme ou d’une femme avec rien en nous que le
sentiment de leur droit à être la totalité de ce qu’ils ressentent
qu’ils sont ; et quand ainsi nous savons renoncer aux interprétations de
ces autres que notre pensée brûle pourtant, brûle toujours, de fournir.
C’est quand, autrement dit, nous ne laissons pas la pensée conceptuelle
prédominer sur l’adhésion instinctive, faisant tout au contraire de cet
instant de rencontre un commencement de partage sous le signe du temps,
dans le savoir de la finitude. Le concept, je l’ai dit cent fois, c’est
prélever un aspect dans une chose qui en a d’autres, qui en a comme à
l’infini, pour lui substituer une figure qui n’en sera qu’une
représentation schématique. C’est un passage à la généralité qui vide de
soi une vie, ne sachant y voir que de la matière. Le concept va droit à
cette matière que j’évoquais tout à l’heure. Il risque de la faire
prévaloir dans notre approche de tout, y compris des êtres humains.
Mais faut-il pour autant vouloir se
défaire de la pensée conceptuelle ? Autrement dit s’abîmer dans la
contemplation de ce qui est, entrant dans la chose présente - cet
arbre-ci, disons, si débordant de ses bruits et de ses odeurs – pour
faire corps avec elle ? C’est ce que veulent certains mystiques, mais
prenons garde de méconnaître ce qui alors se produit en eux. Avec
l’abandon du conceptuel, de cette prise des mots sur l’apparence
sensible, la chose rentre en son unité, c’est vrai, mais tombent alors
comme de vaines écailles les divers aspects qu’y différenciait le
langage puis ses rapports aux choses voisines et, de proche en proche, à
toutes les autres dans notre lieu d’existence. L’être se voit dépouillé
de son paraître, le plein grandissant de l’Un se fait pour nous dans
cette extinction des relations entre choses un vide tout aussi bien, le
grand vide. Dans l’expérience mystique ne demeure qu’un seul objet,
indifférencié, au delà même des sens, et ce qui aura disparu, ce sont
aussi et très tôt les autres personnes. L’absolu entrevu là-bas, c’est
ici, pour son témoin, une solitude qu’il ne sait même plus ressentir.
___________________________
"...Je crois que ce que la poésie attend de nous, ce n’est pas le
resserrement de son intuition sur quelque pensée du fond du réel
toujours plus ou moins leurrée par du rêve mais le questionnement qui
nous fait critiquer les idées que nous faisons nôtres
"
___________________________
Et devons-nous accepter cette façon
d’être au monde ? Je pense pour ma part que ce fut la reconnaissance du
fait et du droit de l’autre qui, instituant le langage, fonda un second
niveau du réel, le seul qui dans le non-être inhérent à la matière
puisse même prétendre à être. Je pense que c’est cette alliance seule,
alliance entre une conscience et une autre, qui peut faire de l’un du
monde, avant elle encore vacant, le souffle prêt à emplir, de toutes ses
harmoniques, le cor qu’est notre voix toute à sa chasse mystérieuse. Se
détournant du gouffre de la matière, faisant chose de celle-ci, et de
cette chose son instrument, et de cet instrument son ami qui défriche
avec elle un lieu pour une vie créatrice de sens et par suite d’être, le
langage est ce qui vaut et ce qu’il faut. Or, dire cela signifie qu’il
ne faut pas renoncer à ces concepts qui un par un sont en lui la prise
des mots sur les choses. Dans celles-ci, c’est bien vrai, ils risquent
d’abolir l’imminence de l’Un, ce qui nous priverait de nous-mêmes. Mais
au contact de la chose, qui continue à parler en nous, on peut et bien
sûr il faut - c’est notre seule chance, donc notre tâche - les secouer,
si j’ose dire, les réveiller de leur tendance à se faire système,
idéologie, affirmation dogmatique : les remettant ainsi en rapport avec
ce tout qu’ils ne savent pas reconnaître, les obligeant à plonger dans
l’infini de la moindre chose. Une façon d’ailleurs, cela, de faire,
d’eux aussi, une vie, une existence. De les inciter à des sentiments, à
des aspirations, à des rêves ...
Disons cela autrement : de l’abolition que fait le penser conceptuel du
tout de la chose, du tout et de l’un du monde, il ne faut pas laisser
résulter la simple fragmentation qui pourrait dans la connaissance en
être la conséquence. Cette fragmentation recommence à chaque instant de
nos vies puisque tout prélèvement conceptuel sur l’entièreté d’une chose
est une hypothèse dont les points de vue et les fins peuvent être des
plus divers, mais est souhaitable et, qui sait même, possible, le
ressaisissement qui en percevrait la nocivité, se remémorerait d’autres
plans d’approche : un ressaisissement à vocation dialectique. Faire que
le premier prélèvement soit d’emblée inquiété par ceux que font à côte
de lui d’autres projets de recherche, d’autres modes de connaissance.
Aimer cette déconstruction, ces dérives.
Mais cela, c’est donc du multiple, et ce qu’il faut accepter de voir,
c’est que c’est seulement sur les chemins du multiple que l’on peut
penser, et chercher à vivre, et pressentir l’unité. Le multiple, c’est
notre respiration, c’est le détour par le dehors qui nous assure de
regagner l’intérieur. Et notre devoir n’est donc pas de le dénier mais
d’en nourrir notre intelligence et de le savoir une vie, pas ce tas de
ferrailles désaccordées sur une plage nocturne que croient voir nos
instants - il en est toujours - d’angoisse métaphysique. Notre devoir ?
Oui, j’emploie ce mot à nouveau.
Long développement, et aride, ce que je viens de vous dire. Mais
c’était, vous vous en doutez, pour en venir plus confiant à ce que je
suis ou crois devoir être dans mes diverses façons de réfléchir et
d’écrire. Ayant foi dans l’Un j’ai foi tout autant dans le multiple. Je
crois que ce que la poésie attend de nous, ce n’est pas le resserrement
de son intuition sur quelque pensée du fond du réel toujours plus ou
moins leurrée par du rêve mais le questionnement qui nous fait critiquer
les idées que nous faisons nôtres et doit pour être efficace élargir à
d’autres auteurs que nous – écrivains, philosophes, peintres – sa traque
des généralisations insidieuses, des passages illégitimes d’expériences
de la présence, toujours furtives, à des représentations et formulations
presque aussitôt sclérosées. Recherche s’attachant, pour s’en vivifier,
aux seules vraies grandes œuvres, celles qui ont su déjouer ces pièges.
La conscience de soi d’un poète ne peut que gagner à cette réflexion sur
d’autres formes que la sienne de l’auto-illusionnement ou du besoin de
lucidité.
Et les champs d’observation ne manqueront pas. Pensons d’abord aux
travaux des théologiens, premiers à étouffer l’intuition de la
transcendance authentique – celle de la finitude, du simple, de
l’immédiat – sous la chape de mythes qu’ont bâti des concepts devenant
vite des dogmes. Mais pensons aussi aux critiques d’art, faisant
discours conceptuel de la pensée figurale des artistes, pensons aux
traducteurs de la poésie, obnubilés trop souvent par les significations
– ce dehors - dans les poèmes, pensons aux poètes eux-mêmes, si souvent
prêts à sacrifier à des rêves ce que leur sens poétique saura ressaisir,
tout de même, dans la flamme de quelques mots. En fait ce sont les
ressaisissements qui sont les leçons les plus stimulantes, les plus
aptes à faire comprendre ce qu’est la vraie poésie. Ressaisissement de
Shakespeare en son écoute d’Hamlet, ressaisissement que fut l’art
baroque à la fin de la Renaissance, ressaisissement de Goya après Les
désastres de la guerre, ressaisissement de Giacometti réinventant un art
de la présence au cœur même d’une modernité de plus en plus
conceptuelle. Ceux-là, oui, sont les vrais poètes, qui, défaillant, se
sont repris, obstinés.
Ce sont quelques-uns d’entre eux que j’ai pour ma part étudiés, n’allant
dans des directions assurément très diverses, que pour retrouver à
chaque bout du chemin la conscience de soi qui travailla dans ces
auteurs - ou dans leur moment historique - à rétablir la présence dans
l’espace des représentations, labyrinthique. Le besoin d’attester de ces
ressaisissements, de l’obstination qu’ils révèlent, de ce qu’ils sont au
total - la poésie de fait, dans le monde alentour de l’illusion
littéraire -, c’est le fil qui recoud ensemble mes bouts d’étoffe.
Et que peut-il résulter, de ces études critiques encombrant dans
l’écrivain, peut-on craindre, les voies de son invention plus
directement et pleinement poétique ? Vont-elles contribuer à un regard
plus ouvert sur ce qui importe, l’arbre sur le chemin, l’enfant qui joue
sur le seuil, et tout autant, hélas, les feux d’incendie à l’horizon,
les cris dans la maison proche ? Oui, on peut le penser, parce que ce
travail du négatif, c’est dégager le mot des concepts qui le recourbent
sur du discours, c’est lui permettre, autant que le font les rythmes du
vers, de redevenir désignatif de la chose que le mot nomme, d’en
rencontrer la plénitude indéfaite.
Le mot, sauver le mot, faire revivre l’arbre dans le mot arbre, c’est là
- voici ma réponse à votre seconde question - la tâche et première et
constante que doit se donner la poésie. Et le poème travaille à cette
résurrection mais aussi le font les études qui par les voies du concept
rejoignent des lieux où ce même concept a buté contre plus que soi.
Telle, dans sa diversité nécessaire, l’activité proprement critique que
Baudelaire demandait d’associer à la poésie, à la poésie moderne. Ce qui
était une indication qu’on n’a pas assez bien comprise encore."
propos recueillis par Dimitris Angelis
revue et complétée par Yves Bonnefoy
pour Lexnews
(copyright réservé - toute reproduction
interdite)
|
|
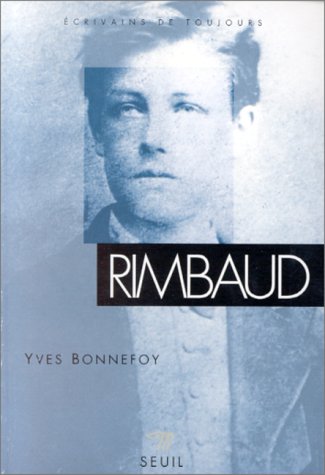    |
|
Interview Hwang
Chun-ming,
Yilan, Taïwan, 14 février 2014.

©Lin Yu-li
|
| Lexnews a eu
le grand privilège d'interviewer l'un des plus grands écrivains de Taïwan
dans son café littéraire à Yilan "L’Arbre aux cent fruits" où il a bien
voulu répondre à nos questions. L'écrivain a toujours eu à coeur de
souligner dans son œuvre les complexités nées de l'histoire de son pays
avec la guerre froide, les enjeux stratégiques et économiques. Adoptant le
point de vue d'une littérature dite du "terroir", la richesse narrative de
Hwang Chun-ming n'a d'égale que sa perspicacité à identifier les
contradictions de ses contemporains et leurs hésitations face à la
modernité. A la lecture de son dernier recueil, nous avons le sentiment
d'avoir fait un grand voyage dans l'intériorité de ce pays, et ce n'est
pas le moindre des mérites de cet écrivain généreux !
 ous êtes né dans le district d’Yilan
à Taïwan en 1935. Quelle importance ont eu les langues dans votre parcours
littéraire, et pouvez-vous rappeler aux lecteurs occidentaux la diversité
linguistique qui concerne votre pays (mandarin de Taïwan, le holo, le
hakka, sans parler des plus anciens ayant appris le japonais…) ? ous êtes né dans le district d’Yilan
à Taïwan en 1935. Quelle importance ont eu les langues dans votre parcours
littéraire, et pouvez-vous rappeler aux lecteurs occidentaux la diversité
linguistique qui concerne votre pays (mandarin de Taïwan, le holo, le
hakka, sans parler des plus anciens ayant appris le japonais…) ?
Hwang Chun-ming : "C’est une
excellente question. Quel dommage que les journalistes taïwanais ne me la
posent jamais ! Taïwan est un petit pays, mais son histoire est très
compliquée. Les Hollandais et les Espagnols s’y sont installés pendant
quelques décennies au 17e siècle. Plus tard, de 1895 à 1945, les Japonais
en ont fait leur colonie. La plus grande partie de la population
taïwanaise quant à elle est originaire du Fujian, la province chinoise qui
fait face à notre île, et qui a une culture très particulière, très
différente de celles des autres régions de la Chine. À cela il faut
ajouter les Hakkas, une minorité chinoise venue du Guangdong. Enfin, il ne
faut pas oublier les habitants originels de l’île, les aborigènes, qui ont
leur propre culture et leurs propres langues.
Je vais vous raconter une anecdote qui illustre bien la complexité
linguistique issue de notre histoire. Lorsque le colonisateur japonais
s’est lancé à la conquête de l’Asie du Sud-est, il a voulu faire de Taïwan
le tremplin de sa politique expansionniste. Pour cela, il a lancé sur
l’île une politique d’assimilation appelée le « kominka ». À partir de
1943, mon grand-père a ainsi dû suivre des cours de japonais, qui avaient
lieu dans le temple du village. L’enseignant faisait d’abord apprendre aux
élèves des substantifs en leur montrant des images. Mais mon grand-père
n’arrivait pas à retenir ses leçons, il m’a donc emmené avec lui afin que
je mémorise les noms et que je les lui répète ensuite à la maison, un peu
comme les étudiants d’aujourd’hui qui enregistrent les cours pour pouvoir
les réviser ensuite chez eux. Deux ans plus tard, lorsque les Japonais ont
perdu la guerre, et avec elle Taïwan, mon grand-père, qui n’aimaient
pourtant pas beaucoup les autorités coloniales, a dit : « quel dommage,
juste au moment où je commençais à parler le japonais... ». Je me souviens
aussi que le jour où l’empereur a annoncé la capitulation du Japon dans
son fameux message radiophonique, tout le village s’était rassemblé pour
écouter. Les personnes âgées étaient folles de joie, mais mon père s’est
mis au garde-à-vous et a commencé à pleurer. Il avait fait toute sa
scolarité en japonais et cette langue était devenue la sienne. C’est un
phénomène identitaire très complexe qu’on peut observer chez de nombreuses
personnes de sa génération.

©Lin Yu-li
Toujours est-il qu’avec le retour de Taïwan à la
République de Chine en 1945, la population a dû apprendre le mandarin, une
langue très différente du taïwanais (ou holo), le dialecte parlé sur
l’île. Sur un si petit territoire et une période de temps très courte, les
langues se sont donc mélangées comme des fruits de toutes sortes qu’on
aurait passés au mixer. Personnellement, je crois que pour que l’usage
d’une langue se stabilise, il faut au moins l’espace d’une génération,
c’est-à-dire environ vingt-cinq ans. Mais les Taïwanais de cette époque
ont été bousculés par une série de changements rapides. C’est le contexte
dans lequel ils ont dû vivre et auquel ils ont dû s’adapter.
Nous sommes interrompus par un serveur qui apporte un café dans lequel
trempe une prune séchée, une boisson de l’invention de Hwang Chun-ming,
qui abandonne le mandarin pour engager un échange en taïwanais avec le
jeune homme.
Après la guerre, le nouveau gouvernement chinois a voulu éradiquer la
culture japonaise, qui était en partie devenue celle des Taïwanais. C’est
pourquoi les gens de cette génération ont gardé une certaine animosité
envers les Chinois continentaux et une inclination pour le Japon. La
culture très complexe des gens de cette génération a aujourd’hui en grande
partie disparu et notre gouvernement dépense à présent beaucoup de
ressources pour promouvoir une diversité culturelle que ses prédécesseurs
ont tout fait pour anéantir.
Il n’en reste pas moins que le mandarin parlé aujourd’hui à Taïwan est un
amalgame de diverses langues. Des mots japonais, dont certains ne sont
d’ailleurs même plus employés au Japon, ont par exemple été intégrés dans
notre parler quotidien. Je crois que la raison pour laquelle nous autres
Taïwanais possédons cette étonnante faculté d’adaptation linguistique est
en grande partie liée au fait que nous avons souvent été dans la position
d’une minorité désirant acquérir la langue de groupes dominants. Dans mon
récit J’aime Mary par exemple, le personnage principal adopte la
langue des Américains dans un désir de leur ressembler. On peut observer
le même phénomène auprès des minorités taïwanaises elles-mêmes : les
aborigènes savent souvent parler plusieurs autres langues du pays,
notamment le taïwanais et le mandarin. Les membres des groupes ethniques
dominants de la société taïwanaise en revanche n’apprennent jamais à
parler les langues aborigènes.
Je crois qu’on pourrait écrire un livre magnifique sur l’histoire des
langues à Taïwan. Ce serait un cas d’étude très intéressant et qui
pourrait certainement apporter beaucoup à la compréhension de notre monde
contemporain. Mais je dois dire qu’à l’époque où j’ai écrit mes récits où
les langues jouent le rôle le plus important, au tournant des années 1970,
je n’avais pas une conscience aussi précise de ces phénomènes
linguistiques dont je peux parler aujourd’hui avec recul. Mon approche
était plus intuitive et basée avant tout sur mon expérience vécue, celle
d’une personne qui devait interagir avec des gens de langues différentes."

©Lin Yu-li
Lorsque l’on rappelle que le base-ball est le
sport national à Taïwan, introduit par les Japonais, on comprend un peu
mieux les multiples entrecroisements culturels qui éclairent et ponctuent
vos récits, où l’humour n’est jamais loin.
Hwang Chun-ming : "Plus que des
entrecroisements, ce sont de véritables fusions. Le fait que j’en parle
avec humour ne veut cependant pas dire que je considère cela comme une
chose amusante. Au contraire, la culture composite des Taïwanais est en
grande partie le résultat d’oppressions subies et de processus
d’aliénation dramatiques. Si j’ai recours à l’humour, c’est parce que je
pense que celui-ci possède une force particulière. En conjuguant la pitié
au rire, la misère au ridicule, il nous soumet à une tension et nous fait
prendre conscience de la complexité des choses. C’est le grotesque
comme vous dites en français, c’est Pirandello chez les Italiens !
L’humour me permet aussi de porter des critiques que je ne pourrais pas me
permettre de formuler au premier degré. Par exemple, je suis en train
d’écrire une pièce de théâtre intitulée Conférence au sommet, dans
laquelle les dieux du panthéon chinois se rassemblent pour discuter des
problèmes liés à leur culte et aux pratiques religieuses excessives des
humains. En créant un décalage comique, je donne une distance critique."
Vous semblez avoir adopté un point de vue
narratif centré sur le quotidien, le quotidien de « petites gens » (petits
employés, laissés pour compte,…).
Hwang Chun-ming : "C’est que je suis
moi-même l’une de ces « petites gens ». Ce sont elles que je connais le
mieux et qui représentent le mieux les idées qui m’ont été inspirées par
mon expérience. Et puis, les petites gens sont aussi celles qui ont le
plus de difficultés à se faire entendre. Je leur donne une voix. Mais je
ne veux pas les faire apparaître comme misérables ou héroïques, comme des
personnes qu’il faudrait plaindre ou admirer. Je ne veux pas prononcer de
jugement, ce n’est pas à moi de le faire. Je veux laisser le lecteur libre
de voir ce qu’il veut en eux." (...) |
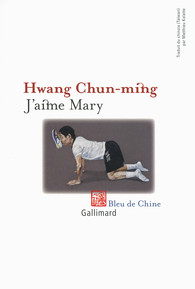 Hwang Chun-ming
J'aime Mary Hwang Chun-ming
J'aime Mary
Trad. du chinois par Matthieu Kolatte
Collection Bleu de Chine, Gallimard, 2014.
Écrites dans les années 1960 et 1970, ces quatre nouvelles se
déroulent dans le Taïwan de l’époque de la guerre froide et du miracle
économique, sources historiques de profondes mutations sociales et de
déchirements identitaires dont certains effets perdurent aujourd’hui.
Remarquable narrateur, Hwang Chun-ming traite de sujets polémiques à
travers des récits savamment construits et aux personnages inattendus :
un cadre d’entreprise entraîné par sa passion pour une chienne, un père
de famille miséreux renversé par la voiture d’un officier américain, un
homme-sandwich tourmenté par ses pensées et ses souvenirs, un jeune
représentant de commerce attiré par une fillette solitaire. Parfois
grinçant mais toujours plein d’humanité, c’est l’humour qui donne à ces
récits toute leur force, leur saveur et leur authenticité.
Principal représentant de la littérature dite «du terroir», Hwang
Chun-ming a été un des premiers à faire de Taïwan et de ses
particularités culturelles le matériau de son œuvre. Lorsque de jeunes
cinéastes lanceront, au début des années 1980, le mouvement de la
«Nouvelle Vague taïwanaise», ils adapteront plusieurs de ses récits au
grand écran, désireux de rétablir une identité taïwanaise distincte de
celle de la Chine mythique promue pendant quatre décennies par le régime
de Chiang Kai-chek et de son fils.
www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bleu-de-Chine/J-aime-Mary
_________________________
Et pourtant ce regard conduit, au-delà de la
critique sociale, à un regard décentré d’un témoin de son siècle et de ses
mutations, regard qui porte parfois très loin sur le plan symbolique si
l’on pense à la nouvelle J’aime Mary, titre de votre dernier recueil paru
récemment en France ?
Hwang Chun-ming : "C’est vrai, mais
quand j’ai écrit les récits publiés dans ce recueil, au cours des années
1960 et 1970, je n’avais pas pour but de dépeindre une époque. Elle y
apparaît naturellement à travers la description de l’environnement qui
était le mien. L’indignation a en revanche été une motivation importante
dans mon métier d’écrivain. Je n’ai certes jamais eu pour ambition de
faire des romans à thèse, la critique sociale n’a pas été une fin en soi
pour moi, mais il est certain qu’elle est très présente dans mes écrits.
L’important pour qu’une œuvre littéraire parle, c’est qu’elle soit
l’expression d’une expérience ou d’un sentiment personnels. Et cela vaut
aussi bien pour son auteur que pour son lecteur d’ailleurs. Je vais vous
raconter deux choses qui me sont arrivées et qui peuvent illustrer cela.
La première, c’est un coup de téléphone que j’ai reçu il y a trois ans
d’un hôpital à l’autre bout du pays. Un de ses patients mourant désirait
me voir. C’était un de mes lecteurs, un homme dans la cinquantaine qui
n’avait reçu que l’éducation obligatoire et dont le dernier souhait avait
été de me rencontrer. J’ai pris le premier train et je suis allé le voir.
Je n’aurais jamais pensé que mes œuvres aient pu jouer dans la vie d’un
homme un rôle si important qu’il désire me rencontrer juste avant de
mourir. Après notre rencontre, et deux semaines avant sa mort, il m’a
envoyé un message sur mon téléphone portable pour me remercier. Je l’ai
gardé jusqu’à aujourd’hui et je le relis quand je me sens un peu à plat.
La seconde, c’est la rencontre avec une lycéenne d’un établissement où
j’étais allé faire une conférence. Au moment de partir, elle m’a tendu une
lettre et m’a dit de ne l’ouvrir qu’une fois rentré chez moi. Elle m’avait
écrit qu’elle avait tenté de se suicider à trois reprises et que c’est la
lecture d’un de mes récits, six ans plus tôt, qui l’avait décidée à
continuer de vivre. J’ai été extrêmement ému.
Si je vous raconte cela, c’est pour vous dire que je ne sais au fond pas
exactement quel sera le sens de ce que j’écris, ni ce que cela provoquera
chez les lecteurs. Je suis comme un paysan qui plante son champ, ce n’est
pas moi qui mangerai ce que j’ai semé."


©Lin Yu-li
Hwang fait une démonstration de sa manière de raconter les histoires aux
enfants.
Une autre part importante de vos activités vous a
conduit à écrire et à fonder une troupe de théâtre pour enfants. Cette
jeunesse taïwanaise peut-elle encore échapper au ravage culturel causé par
la mondialisation ?
Hwang Chun-ming : "J’ai de l’espoir.
Et c’est ma propre expérience qui me l’inspire. Je n’ai pour ma part
jamais véritablement terminé mes études universitaires, ayant été rejeté
d’un établissement à l’autre au gré de mes révoltes. Mais j’ai croisé sur
ma route un certain nombre de professeurs dont l’enseignement ou la
personne ont eu une grande influence sur moi, sans même qu’ils le sachent
probablement. Des rencontres de ce genre permettent à une jeune personne
de trouver sa voie personnelle en dépit de tous les systèmes. Je me
souviens par exemple d’un enseignant qui m’avait un jour arrêté dans le
couloir pour me demander si je savais quelle date nous étions. Je me suis
rendu compte que c’était mon anniversaire. Il m’a donné un paquet qui
contenait La Vie passionnée de Vincent Van Gogh de l’écrivain
américain Irving Stone, un livre que j’ai beaucoup aimé. Sur la page de
garde, il avait écrit : « Chun-ming, ton intelligence est comme une mine
qui regorge de richesses. Mais ces richesses, c’est par un long travail
que tu devras les extraire de toi. Que la vie de Van Gogh te soit un
exemple ». Le destin de Van Gogh m’a en effet ému et inspiré. Ce peintre
de génie n’a pas obtenu la reconnaissance qu’il méritait, mais il n’a
jamais abandonné son art. J’ai moi aussi connu cela, quand jeune écrivain,
j’ai dû faire toutes sortes de petits boulots pour assurer ma subsistance
et celle de ma famille, tandis que j’écrivais sans relâche des livres qui
ne me rapportaient rien financièrement. La création a été mon unique but
en tant qu’écrivain.
Ce désir de création, il me vient d’une passion que j’ai depuis l’enfance,
une passion pour les histoires. Dès mon plus jeune âge, j’aimais aller
voir les pièces de théâtre représentées dans notre village. Aujourd’hui,
c’est moi qui raconte des histoires pour les petits. Les enfants
d’aujourd’hui sont constamment divertis, on ne les encourage pas à se
concentrer. Mais si vous leur racontez une histoire qui les touche, alors
ils peuvent vous écouter pendant des heures. La concentration, le sérieux
et l’imagination sont les facultés que l’éducation devrait développer le
plus. Malheureusement, ce sont aussi celles qui font le plus défaut aux
petits Taïwanais d’aujourd’hui, comme aux enfants de tous les autres pays
d’ailleurs. C’est cela que peuvent leur apporter les histoires et le
théâtre. Walter Benjamin a écrit un très beau texte, Le Conteur,
qui va dans le sens de ce que je viens de dire.
Je partage aussi l’idée de Heidegger, qui pense que la technique est le
principal facteur de l’oubli de notre être. Or, la mondialisation c’est
avant tout un avènement du règne de la technique et du matérialisme. Et ce
qui peut nous protéger contre cela, c’est la littérature, les histoires,
du moins celles qui parlent de l’humain. Si je raconte le Macbeth
de Shakespeare à des paysans taïwanais, ils comprendront parfaitement les
sentiments des personnages. Je ne suis jamais allé visiter les endroits où
se passent les nouvelles et les pièces de théâtre de Tchekhov, mais ce
qu’il a écrit ne me touche pas moins pour autant. L’humain est la seule
chose véritablement universelle. Sa connaissance nous grandit.
Est-ce que la mondialisation aura finalement raison de tout ? Peut-être
que oui. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à ne rien faire.
Créer des pièces de théâtre pour les enfants, c’est ma manière de
résister. Mes forces sont bien maigres contre celles de la globalisation,
et je ne sais pas ce que mes histoires apporteront en définitive à mon
jeune public, mais je sais que je dois les raconter."
Propos recueillis et traduits du chinois par
Matthieu Kolatte
________________

©Lin Yu-li
Hwang et Matthieu Kolatte devant son café littéraire à Yilan
(L’Arbre aux cent fruits)
Lexnews tient vivement à
remercier Matthieu Kolatte pour cette interview et sa traduction. Matthieu
Kolatte est le traducteur de Hwang Chun-ming pour les nouvelles J'aime
Mary parues récemment aux éditions Gallimard. Notre revue remercie
également très chaleureusement le journaliste Lin Yu-Li pour ses
photographies accompagnant l'interview.
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
Interview Michel Orcel,
Nice, 29 janvier 2014.

©Sylvie Yvert |
|
Lexnews a eu le plaisir d'interviewer l'écrivain, poète et
psychanalyste Michel Orcel à l'occasion de la publication de sa traduction
de La Beffa di Buccari de Gabriele d'Annunzio aux Editions La
Bibliothèque. L'amoureux des lettres italiennes fait revivre dans ce court
récit une épopée aux intonations aussi épiques que poétiques, relevée par
un patriotisme taillé à la mesure de l'écrivain. Embarquons pour Buccari
et voyons si Gabriele et ses compagnons sont revenus plein d'usage et
raison... de ce triomphal insuccès !
 st-il possible de penser que
Gabriele d’Annunzio recherche une nouvelle virginité (personnelle et
nationale) avec ce coup de force d’une Italie embarrassée par ses
positions géostratégiques au début de la Première Guerre mondiale ? st-il possible de penser que
Gabriele d’Annunzio recherche une nouvelle virginité (personnelle et
nationale) avec ce coup de force d’une Italie embarrassée par ses
positions géostratégiques au début de la Première Guerre mondiale ?
Michel Orcel : "On peut en effet penser que d’Annunzio a embrassé la cause
interventionniste comme une façon de se régénérer. Aussi doué pour les
lettres que pour la « communication » (c’est un des aspects les moins
séduisants, mais les plus étonnants de son personnage), il avait connu dès
son plus jeune âge un extraordinaire succès littéraire, amoureux, mondain.
Vivant dans une sorte d’excès perpétuel, de dépense inouïe, il est
possible qu’il ait pressenti – surtout après son « exil » en France, où il
échappa non seulement à ses créanciers, mais au provincialisme italien –
l’impasse dans laquelle il allait se retrouver. Sa vitalité prodigieuse
(hypomaniaque, dirions-nous, et probablement entretenue au cours des ans
par l’usage croissant de la drogue) lui fait embrasser la cause belliciste
à sa manière : sans demi-mesure et comme une affaire personnelle. Il
confond naturellement sa régénération et celle de l’Italie dont il est
indubitablement à l’époque (avec Pascoli, qui meurt en 1912) le plus grand
écrivain.
Cette aventure des temps modernes peut-elle faire
penser aux héros homériques, via Nietzsche et son surhomme ? D’Annunzio
serait-il le nouvel Ulysse italien ? Vous laissez d’ailleurs entendre dans
votre préface qu’en l’écrivant d’Annunzio transforma en triomphe de
l’audace ce qui, selon l’expression de Vittorio Martinelli, avait été un «
triomphal insuccès ».
Michel Orcel : Le personnage d’Ulysse
traverse en effet le récit, sous l’espèce de quelques vers que d’Annunzio
emprunte à sa tragédie La Nave. Surgeon lointain de l’Odyssée, mais
de Dante aussi, l’Ulysse dannunzien est un découvreur insensé, un chantre
nietzschéen de la conquête pour la conquête :
… Nous, nous serons les précurseurs
Qui ne s’en retournent pas, les messagers qui jamais ne s’en retournent,
Parce qu’ils ont voulu porter le message
Si loin qu’aux vêpres d’un jour fugace,
Ils ont outrepassé les frontières
De l’éternité, et, sans s’en apercevoir,
Ont pénétré dans les royaumes de la Mort.
D’Annunzio, qui n’a d’autre but que de sans cesse repousser les limites,
s’enivre de l’action, et même de l’action la plus moderne (il est un héros
de l’aviation, et n’oublions pas qu’il est contemporain de Marinetti),
mais en l’habillant toujours d’une aura mythique. Et cette puissance de
conviction est telle qu’il a réellement réussi à soulever les hommes et
les masses, non seulement par des discours, mais par un récit comme celui
dont nous parlons. La Beffa, qui ne fut pas un échec, mais un
héroïque insuccès, devint sous la plume de D’Annunzio le plus puissant
outil dans la résurrection du moral italien après la tragique défaite de
Caporetto. Dans ce petit homme prodigieux, qui, à cinquante ans passés,
s’invente un destin de soldat et va défier l’Autriche au fin fond d’un ses
ports, la jeune nation se redécouvre et s’émerveille elle-même.
D’Annunzio n’en était pas à son premier essai en
1918 avec La Beffa di Buccari – et il ira même plus loin encore par
la suite. Pensez-vous que l’on puisse dissocier l’écrivain de proximités
fascistes qu’on lui a souvent prêtées ?
Michel Orcel : "D’Annunzio avait été
élu député conservateur en 1897, mais, aussitôt élu, il avait déclaré : «
J’ai vu beaucoup de morts dans les rangs de la droite, je vais du côté de
la vie », et il avait rejoint la gauche ! Plus tard, il soutint la «
guerre de Lybie » (1911-1912), par laquelle l’Italie essayait de se
tailler un empire colonial ; mais cela n’avait rien de très remarquable,
si l’on songe qu’au même moment le doux Pascoli y était lui-même
favorable, tandis qu’un des chefs du mouvement pacifiste se nommait…
Mussolini ! Il fut aussi très vite un représentant de l’irrédentisme
italien, et il est vrai qu’il traîna publiquement dans la boue les
représentants de la bourgeoisie pacifiste italienne. Mais jusque-là il n’y
a rien que de très banal à l’époque. (Pensons, chez nous, à Barrès.) Il
est vrai que d’Annunzio était tellement populaire qu’il participa
effectivement au basculement de l’Italie dans la Première Guerre mondiale.
C’est alors que, contrairement à toute attente, le poète se transforma en
véritable combattant, puis, la guerre finie, en condottiere lorsqu’il
conquit à lui tout seul la ville de Fiume. Il semble qu’on n’ait jamais
assez insisté sur la folie de d’Annunzio et sur sa capacité à
échapper à toute classification. Certes, il y a dans sa vie et son œuvre
assez d’appels à la nation, à la guerre et à la volonté, assez de goût
pour la parade, assez de démonstrations de puissance oratoire sur la
foule, pour que certains aient vu en lui « le saint Jean-Baptiste du
fascisme », mais il y a aussi chez lui trop d’esthétisme,
d’individualisme, de méfiance vis-à-vis des masses et de l’État pour qu’on
ne le dissocie pas du fascisme, qu’il accepta sans doute et dont il tira
même parti, mais auquel il n’adhéra jamais. Dans une époque où règne la
plus grande confusion sémantique, ajoutons que d’Annunzio était d’ailleurs
résolument hostile au rapprochement de l’Italie avec l’Allemagne, et qu’il
détestait Hitler, qu’il traitait de « clown féroce ». Enfin, pour en
revenir à sa carrière politique, on a trop oublié que l’organisation
étatique qu’il imagina pour la ville de Fiume - où se mêlaient les
courants les plus invraisemblables, à commencer par l’extrême gauche -
était d’une modernité inimaginable, puisqu’on y trouvait notamment la
dépénalisation de l’homosexualité et de la drogue…
|
 Gabriele
d'Annunzio La Beffa di Buccari - Un pied de nez aux Autrichiens, 11
février 1918 Gabriele
d'Annunzio La Beffa di Buccari - Un pied de nez aux Autrichiens, 11
février 1918
Traduit et présenté par Michel Orcel
Collection L'Écrivain Voyageur, Éditions La Bibliothèque, 2014.
Splendeur de d'Annunzio ! Dans ce récit d'un acte de guerre, le
courage, la mer, l'amitié masculine, l'Italie, tout se conjugue. Et si,
comme le note Michel Orcel, traducteur et préfacier de l'ouvrage, ce fut
un triomphal insuccès, cet exploit redonna sa fierté à l'Italie.
L'audace y fut pour beaucoup, mais la littérature aussi. Un petit bijou
musical d'une virilité aussi ciselée qu'entière.
_________________________
La mise en œuvre et la narration de
cette épopée font également parfois penser au roman Chevaux échappés
ainsi qu’au coup de force fatal de l’écrivain japonais Mishima dans son
exaltation des valeurs martiales (parallèle implicite avec le code du
Bushido dans la préparation du 11 février 1918).
Michel Orcel : "Je comprends bien le
parallèle que vous esquissez à partir des éthiques nationalistes et
martiales des deux auteurs, mais, outre que d’Annunzio n’a ni le talent
romanesque de Mishima ni ses inclinations sexuelles (même si le climat de
La Beffa n’est pas dénué d’érotisme viril, le poète resta un
furieux amateur de femmes), d’Annunzio est totalement étranger au code de
l’honneur japonais : il se voit, se vit comme un seigneur de la
Renaissance italienne. Son nietzschéisme est superficiel, mais son
tempérament à la fois chevaleresque et cynique, sensuel, cupide et
dispendieux, le différencie radicalement de Mishima. S’il a rêvé de mourir
en vol (emportant toujours sur lui une fiole de poison pour décider de sa
fin si cela s’avérait nécessaire), il n’a jamais songé, pour quelque
raison que ce soit, à mettre sa mort en scène, et la disparition de ses
jeunes amis au combat compta certainement parmi les plus grands chagrins
de cette âme peu encline à s’apitoyer.
Pouvez-vous revenir sur votre belle traduction et
de quelle manière vous avez su rendre cette poésie épique si
caractéristique du style de d’Annunzio ?
Michel Orcel : "Si ma traduction a
quelque beauté, elle le doit au texte original. Malgré tous les défauts
qu’on peut lui reprocher (narcissisme, emphase décadente, bimbeloterie
romanesque, etc.), d’Annunzio est un poète immense, qui fait sonner la
langue italienne avec une somptuosité incomparable. On lui reproche aussi
d’avoir pillé tous les grands auteurs italiens du passé, mais c’est que sa
mémoire est immense et qu’il a une manière parfaitement singulière de
faire sien l’héritage littéraire. On a pu dire qu’il recyclait cette
tradition à l’usage de la bourgeoisie nouvelle – qu’il méprisait par
ailleurs. Ce n’est pas faux, mais, capable des plus artificieuses beautés
dans le sillage des préciosités du Cavalier Marin, il sait aussi être
d’une limpidité, d’une simplicité désarmantes (il avait d’ailleurs un
étrange goût pour saint François et le franciscanisme) ou soulever de
grandes vagues prosodiques qui me semblent plutôt relever du lyrisme que
de l’épopée. Il n’est pas insignifiant que, du point de vue musical, il
ait aimé Wagner et Debussy plutôt que Puccini. Parfois on en vient même à
douter que sa phrase signifie quelque chose ; on est très proche d’un
formalisme hypermoderne."
Quelle perception pouvons-nous avoir de Gabriele
d’Annunzio aujourd’hui ? Pensez-vous que nous aurions profit à retenir la
personne de d’Annunzio sans le d’annunzianisme ?
Michel Orcel : "L’œuvre de D’Annunzio
nous paraît aujourd’hui très inégale. J’ai pour ma part un bien médiocre
souvenir de certains de ses romans, dont le climat à la Huysmans et
l’esthétisme forcené sont tout à fait démodés. Mais ses drames
symbolistes, sa poésie (Alcyone) et ses proses les plus intimes (Le
Nocturne, La Léda sans cygne, etc.) sont, je le répète,
d’incomparables musiques. Quant à sa vie, on pourrait aussi bien en
méditer la profonde ambivalence : d’un côté la sauvage liberté de la vie,
la capacité à violer les conventions, la noblesse de l’agir, et de l’autre
la triste modernité de la propagande, de la « communication », et, pour
finir, la funèbre claustration dans un musée de pacotille…
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
________________
Michel Orcel a fait également paraître aux Editions
La Bibliothèque :


lire notre chronique |
|
Interview
Jean
Starobinski
Genève - 29 janvier 2013
|
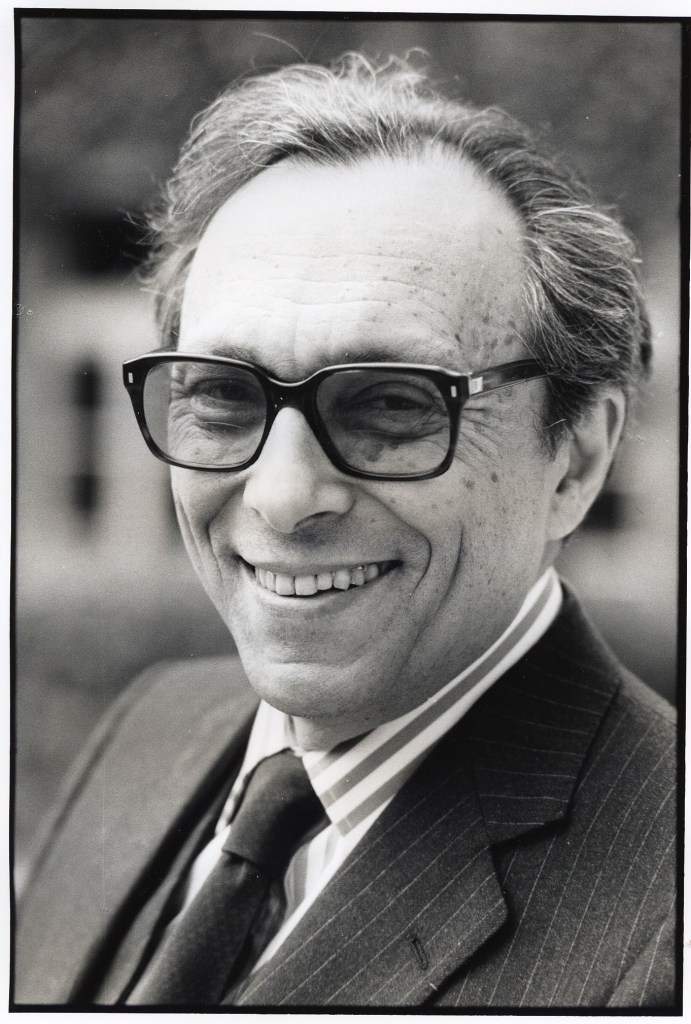 |
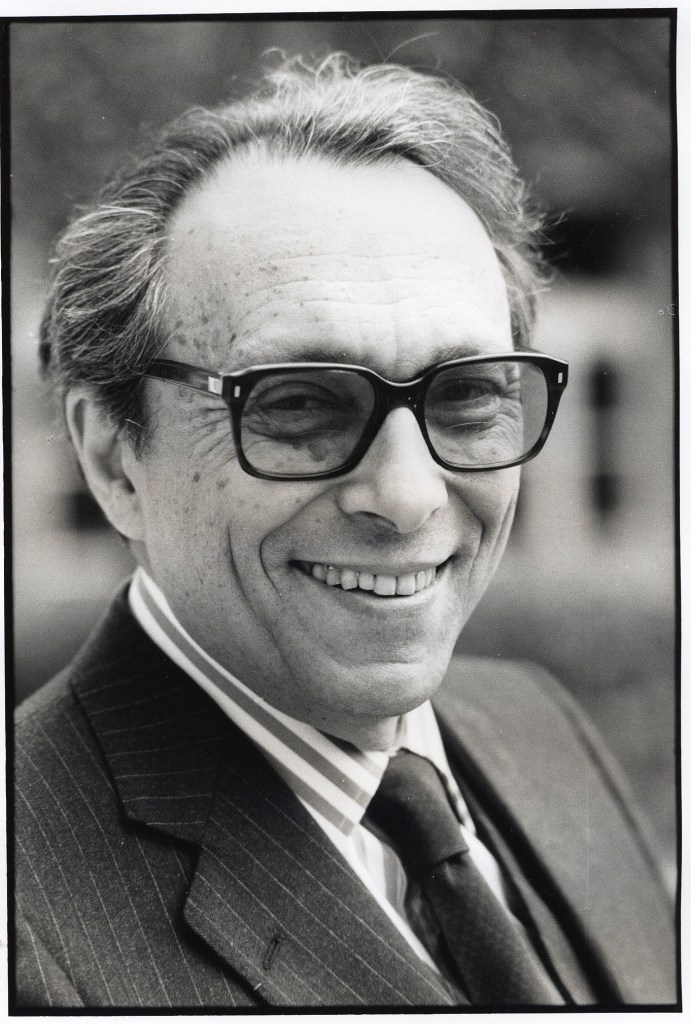 |
|
Une répétition familiale vient à peine
de se terminer dans l'appartement de Jean et de Jacqueline Starobinski, à
Genève. Les musiciens partagent leurs dernières impressions et rangent
leur instrument pendant que nous arrivons dans un lieu habité par les
livres, les manuscrits, les œuvres d'art et... les notes de musique qui se
dispersent. Jean Starobinski est prêt, avec une générosité remarquable, de
partager une fois de plus, les souvenirs de son enfance, de sa formation
intellectuelle, de ses recherches et de ses travaux. L'homme est discret
et en même temps attentif à chacune de vos interrogations et de vos
formulations. Les silences rythment parfois les réponses, à l'image de
leurs homologues en musique, pour mieux souligner l'analyse d'une rare
ampleur. Rencontre avec un amoureux de l'interprétation et de la critique,
une personnalité qui se livre avec humilité."
 ous nous
trouvons à Genève, ville dans laquelle vous avez toujours habité. Quelles
seraient les évocations littéraires qui vous viendraient à l’esprit pour
évoquer votre ville et quelles sont vos premières émotions culturelles
dans cette même ville ?» ous nous
trouvons à Genève, ville dans laquelle vous avez toujours habité. Quelles
seraient les évocations littéraires qui vous viendraient à l’esprit pour
évoquer votre ville et quelles sont vos premières émotions culturelles
dans cette même ville ?»
Jean Starobinski : « L’école où j’ai fait mes premières classes a été
la Maison des Petits, instituée à Genève par le psychologue Edouard
Claparède, assisté par les merveilleuses pédagogues Audemars et Lafendel.
L’éducation que nous recevions passait par les travaux de jardinage, la
rythmique, les chansons, le dessin. C’était une expérience du vivre
ensemble. L’appel à l’oreille, les chansons avaient autant d’importance
que l’apprentissage des signes de l’écriture. Mon petit argent de poche
allait me permettre, plus tard, d’acquérir les albums de Benjamin Rabier,
puis les tardifs tirages de l’édition Hetzel de Jules Vernes, si
merveilleusement illustrée. Dans le domaine de mes lectures, un événement
important est survenu alors que j‘avais douze ans : ma mère m’a offert la
collection complète du Cabinet des Fées, datée d’Amsterdam et
Paris, 1785. La série commençait par Perrault et ses épigones, suivis par
le Télémaque de Fénelon, puis les Mille et une Nuits dans la
traduction de Galland, pour finir avec Wieland et Cazotte… Ce fut le
versant maternel de mes lectures. Les gravures, d’un exotisme élégant, me
faisaient beaucoup rêver. Mon penchant pour le dix-huitième siècle remonte
à ce moment. Plus tard dans les années trente, mon père s’abonna à la
Revue de métaphysique et de morale, mais aussi à la NRF et à
Mesures. Je n’oublie pas non plus ce que je dois à mes professeurs de
la section classique du Collège de Genève. Notre maître de français,
François Bouchardy, allait devenir l’un des collaborateurs de l’édition de
la Pléiade de Jean-Jacques Rousseau. Beaucoup de mes maîtres genevois ont
été des comparatistes. Notre admirable professeur de grec, Edmond Beaujon,
sera le traducteur de plusieurs ouvrages de Hermann Hesse. Notre
germaniste, Walter Müller, a poussé très loin les préparatifs d’un ouvrage
sur George Sand. Il nous faisait écouter des passages du Rosenkavalier
en fin de leçon.
Collégien, je me suis faufilé à l’Université pour assister aux leçons de
Marcel Raymond, que j’avais aperçu pour la première fois lors de la
soutenance de thèse d’Albert Béguin sur l’Âme romantique et le rêve. Dans
ses cours, Marcel Raymond lisait et faisait écouter le texte de Rousseau :
le récit du fol amour pour madame d’Houdetot m’en est resté inoubliable.
Je rappellerai aussi que Marcel Raymond avait été « lecteur » à Leipzig
avant d’enseigner à l’Université de Bâle, puis de Genève. Il a traduit
avec son épouse, Claire, les Principes fondamentaux de l’Histoire de l’Art
de Heinrich Wölfflin. Jean Rousset, successeur de Raymond, s’inscrit dans
la même tradition du lectorat en Allemagne et de l’intérêt pour le
«baroque». On voit à quel point, dans le climat encore paisible du début
des années trente, l’intérêt comparatiste était vif à Genève. J’avais au
collège des amis allemands, réfugiés. J’ai découvert, avec un certain
retard, que la mère de l’un d’eux était Felice Bauer, la première fiancée
de Kafka. Or j’ai traduit Kafka dans les années quarante! C’était pour
donner la copie à la revue Lettres, qui venait d’être fondée à Genève,
autour de Pierre-Jean Jouve. En pleine guerre, cette revue défendait la
cause d’une autre Europe. Plus tard je préfacerai, pour Gallimard, un
recueil de travaux du stylisticien Leo Spitzer, et un livre du psychiatre
allemand Hans Prinzhorn, consacré à l’art des aliénés. En cela je n’ai
fait que suivre une tradition de traduction et de comparatisme bien
établie en Suisse Romande, et qui allait au-delà des seuls liens
confédéraux. Nous ne différions guère de nos amis vaudois : je pense à
Gustave Roud traducteur de Hölderlin, à Philippe Jaccottet traducteur de
Thomas Mann, de Rilke, de Musil.
Vous me demandez aussi quels événements culturels, à Genève, m’ont marqué
dans mes jeunes années Je réponds sans hésiter en évoquant un événement
exceptionnel: l’exposition, au Musée d’Art et d’Histoire, des
chefs-d’œuvre du musée du Prado, durant l’été de 1939. Genève avait abrité
ces tableaux pendant la guerre civile espagnole. Je parcourais presque
tous les jours les salles du musée, grâce à ma carte d’entrée de
collégien. J’ai adoré Titien et sa Bacchanale des Andriens. J’ai
découvert la grandeur de Goya. J’ai moins aimé (mais j’avais tort) les
portraits royaux de Velasquez Cela se passait dans le calme étrange du
dernier été de la paix… En tout cas, la Genève qui m’a entouré n’avait
rien de la toile de fond tendue par Joseph Conrad, dans Sous les yeux
d’Occident, pour une cruelle histoire d’exilés et de comploteurs
russes. Sa Genève ennuyeuse et tranquille est un repoussoir pour une
histoire tragique ».
___________________________

"...La musique a en effet
été souvent présente à mon esprit dans le comparatisme élargi que
j’essaie de pratiquer."
© Frédéric Wandelère
___________________________
« La musique semble jouer un rôle important dans votre vie ? »
Jean Starobinski : « Mon père, qui adorait la musique, m’a emmené
très tôt aux concerts du dimanche de l’Orchestre de la Suisse Romande.
Son chef, Ernest Ansermet, avait collaboré avec Serge Diaghilev et ses
chorégraphes. C’était l’époque où les succès de l’avant-guerre, les
musiques de ballet et les grands poèmes symphoniques étaient encore
d’actualité : Petrouchka, Daphnis et Chloé, la Mer, l’Apprenti
Sorcier. Il y eut ensuite les répétitions publiques d’œuvres
nouvelles, commentées par Ansermet. J’en ai gardé une grande
reconnaissance pour les découvertes — Alban Berg, Béla Bartok — que je
dois à ce chef. L’attention aux structures musicales m’a préparé à
percevoir les structures littéraires. Cette reconnaissance est le motif
qui m’a fait préfacer, beaucoup plus tard, ses Fondements de la
musique, dont j’étais loin d’adopter toutes les thèses. La musique a
en effet été souvent présente à mon esprit dans le comparatisme élargi
que j’essaie de pratiquer. Quand Hugues Gall m’a demandé d’écrire des
commentaires pour les programmes de l’opéra de Genève, j’ai accepté avec
joie sa proposition, et c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai
rassemblé ensuite ces textes, dans le volume qui s’intitule « Les
Enchanteresses ». Il fut un temps où, dans les intervalles de mon
travail d’écriture, je me mettais au piano, pour changer d’horizon, pour
passer un moment en compagnie de Bach ou de Scarlatti. Mais je ne
travaille pas en écoutant de la musique. Je ne suis pas capable de
diviser mon attention. »
« Très jeune, suivant les pas de votre père, vous mènerez de front
des études littéraires et des études de médecine qui vous conduiront
tout d’abord à exercer puis à enseigner. Sans tout expliquer, le corps
et l’écriture semblent intimement liés, que cela soit dans l’harmonie ou
au contraire lors de tensions paroxystiques. »
Jean Starobinski : « Mon père, arrivé à Genève en 1913, a suivi le
cours de philosophie d’Alfred Werner, que j’ai écouté à mon tour un
quart de siècle plus tard ! Je suis entré à la Faculté des Lettres à
l’automne de 1939, pour la quitter avec une licence ès lettres
classiques à l’été de 1942. Commencèrent alors les études de médecine
qui furent terminées en 1948. Mais j’avais quitté la Faculté des Lettres
en établissant avec Marcel Raymond un projet de thèse de doctorat ès
lettres. Et ce projet, je l’ai poursuivi au long des années. Il a été le
principe moteur de beaucoup de mes travaux. Il s’agissait d’exposer et
d’analyser, sur une série d’œuvres, de Montaigne aux contemporains, un
thème qui a subi bien des variations: la dénonciation du masque et des
hypocrisies, un motif constamment repris par les moralistes.
Durant les années 1946 et 1947, j’ai été un assistant intérimaire de
littérature française à la Faculté des Lettres (à raison de deux heures
par semaine) tout en restant inscrit à la Faculté de Médecine et en
suivant presque tous les cours médicaux exigés par le règlement d’étude.
J’ai été tout à la fois étudiant et enseignant ! Je me dis parfois que
c’est resté ma manière d’être. Par la suite, j’ai été l’un des
assistants de la Clinique de Thérapeutique de l’Hôpital Cantonal de
Genève. A l’automne de 1953, j’ai rejoint l’Université Johns Hopkins de
Baltimore pour un enseignement littéraire, tout en établissant des
amitiés du côté de l’Hôpital et de l’Institut d’histoire de la médecine…
En ce lieu et à ce moment, d’étroits contacts existaient entre
enseignants américains et savants d’origine européenne. A déjeuner,
c’est Georges Poulet et Leo Spitzer que je rejoignais au Faculty Club… A
mon retour d’Amérique, j’ai pu me consacrer à la dernière mise au point
et à la publication de la thèse de doctorat sur Rousseau (La
Transparence et l’Obstacle), tout en exerçant, encore durant une
année (1957-1958), la fonction d’interne à l’Hôpital psychiatrique de
Cery, rattaché à la Faculté de Médecine de Lausanne. Ce fut ma dernière
activité dans le domaine médical. Mais cette année a beaucoup compté. La
thèse de doctorat en médecine sur l’Histoire du traitement de la
mélancolie date de ce moment. Elle est reprise aujourd’hui dans
L’Encre de la Mélancolie. Je suis tenté de dire que je suis resté
fidèle à mon premier projet, le masque et la critique du masque, mais
j’ai pu considérer le sujet sous plusieurs angles… »
___________________________
"...Notre époque est
difficile à déchiffrer, avec ses techniques perfectionnées et ses
passions primitives. On y rencontre trop souvent les moyens les plus
sophistiqués mis en œuvre à des fins perverses..."
___________________________
« Comment percevez-vous notre époque caractérisée par une singularité
souvent exacerbée, cette tension de soi qui ajoute au trouble collectif
ressenti ? »
Jean Starobinski : « Notre époque est difficile à déchiffrer, avec ses
techniques perfectionnées et ses passions primitives. On y rencontre trop
souvent les moyens les plus sophistiqués mis en œuvre à des fins
perverses: les pouvoirs créés par l’intelligence tombent trop souvent aux
mains de la bêtise … C’est donc un devoir de rester en éveil. Il n’est pas
facile de demeurer fidèle aux exigences de la vérité, indépendamment de ce
qui touche à notre personne et à nos sentiments. La santé mentale est une
aptitude à sortir de soi, à s’oublier, à assumer des tâches… Le malade
mélancolique est englué en lui-même, et trop souvent se résigne… A
l’opposé, le maniaque, trop agité, perd le fil de ses idées, ne peut
mettre en œuvre un projet cohérent… »
« Peut-on parler d’une bonne ou d’une mauvaise mélancolie ? »
Jean Starobinski : "Votre question me paraît concerner le champ
sémantique du mot « mélancolie », et son évolution historique. Au départ,
dans la pensée médicale qui a prévalu à la fin de l’antiquité classique,
la bile noire (dont le nom grec est « mélancolie ») est l’une des quatre
humeurs constitutives du corps humain, avec le sang, le phlegme et la bile
jaune. Selon cette doctrine, formulée certes par un savoir périmé, la
juste proportion, l’heureux mélange de ces quatre humeurs définit l’état
de santé. Que l’une de ces humeurs devienne excessive, qu’elle se «
corrompe », il en résulte une altération de la santé. La tâche du médecin
était ainsi de rétablir l’équilibre humoral, par les divers moyens qu’il
croit efficaces : la diète, l’exercice, l’évacuation, les moyens musicaux
ou moraux s’il y a lieu. La prévalence modérée de l’une ou l’autre de ces
« humeurs » définissait un « type » humain.
(...) |
Les dernières parutions de Jean
Starobinski...
Les approches du sens - Essais sur
la critique
Editions La Dogana, Genève, 2013.
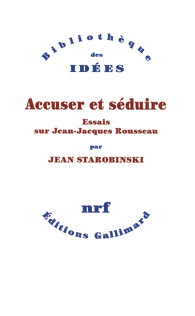
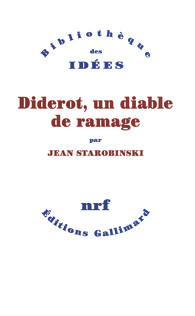
Accuser et séduire. Essais sur
Jean-Jacques Rousseau
Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard, 2012
Diderot, un diable de ramage
Collection Bibliothèque des Idées,
Gallimard, 2012.
_______________________
(...)
La prévalence excessive, une sorte ou
une autre de maladie. Sur ces prémisses, toute une pathologie et toute une
thérapeutique ont pu être imaginées au long des siècles qui précèdent
l’ère « moderne ». Dans la doctrine classique, vous venez de le
rappeler, une relation existe entre le « tempérament » mélancolique et le
génie artistique. D’où tout un ensemble de « documents », dans le domaine
des arts et de la littérature, qui ont attiré l’attention des historiens
depuis plus d’un siècle. Nous savons mieux aujourd’hui que la souffrance
dépressive n’a pas pour origine la « bile noire » dont parlaient les
médecins du passé. Mais les symboles et les images du passé peuvent
renaître dans l’esprit des personnes qui font aujourd’hui l’expérience de
la dépression mélancolique. Si elle est profondément
subie, il n’y a pas de bonne mélancolie. C’est une atteinte à l’intégrité
de la personne, c’est un mutisme imposé. Savoir dire la souffrance est un
premier pas pour s’en délivrer. Mais il n’est pas suffisant. A la
Renaissance, la mélancolie fut à la mode, car elle pouvait être un
attribut du génie. Ce fut alors une pose, une affectation, dont
Shakespeare sut merveilleusement se moquer dans Comme il vous plaira…
»
« Pouvez-vous revenir sur les objets de la mélancolie (ruines, les
chantiers avec les Tableaux parisiens de Baudelaire, collier rompu, restes
d’un repas évoqué dans un tableau..)? Sont-ils le miroir de celle-ci ou
lui sont-ils constitutifs ?
Jean Starobinski : "C’est à la renaissance que sont apparues les
grandes figures emblématiques de la mélancolie, notamment dans la superbe
gravure de Dürer. La valeur emblématique ne s’attache pas seulement à
l’aspect physique des figures représentées, mais aux objets dont elles
sont entourées, aux signes astraux qui renvoient à la planète Saturne… Le
plus souvent, l’emblème de la mélancolie fut le travail interrompu, la
tâche inachevée, non du fait de la seule paresse, mais d’une adversité
insurmontable rencontrée dans l’accomplissement d’un difficile devoir. Les
peintres se sont inspirés de ce qu’ils avaient appris des médecins, des
philosophes, des théologiens; ils ont aussi porté leur attention sur les
objets qui les entouraient dans leurs ateliers. Fritz Saxl et Erwin
Panofsky, deux grands historiens de la Renaissance, dans leur ouvrage sur
la superbe gravure de Dürer, ont déchiffré la signification emblématique
des objets présents autour de la figure féminine qui semble incapable de
poursuivre son travail. Dans sa poésie, Baudelaire a recouru de la même
façon aux symboles de l’effort de l’artiste et de l’obstacle rencontré.
.Mais il en a fait des images de la modernité, associées au motif de la
grande ville."
___________________________
"...on peut, du dehors, parler poétiquement de la mélancolie,
mais la mélancolie elle-même est la perte du pouvoir de parler, la
souffrance d’un mutisme sans recours."
___________________________
« Existe-t-il encore aujourd’hui une mélancolie ? »
Jean Starobinski : "Bien sûr, elle existe encore, et c’est ce que
nous nommons « dépression ». La dépression mélancolique, la « psychose
maniaco-dépressive » de la nomenclature médicale sont des entités
morbides bien définies, et ce sont de redoutables maladies. La période
d’agitation maniaque peut avoir une tonalité euphorique, mais les phases
dépressives sont épouvantables. Il faut secourir ces patients-là. Le
moyen thérapeutique le meilleur devra toujours porter, de façon
légitime, le nom d’antidépresseur. Le fait essentiel est celui-ci : on
peut, du dehors, parler poétiquement de la mélancolie, mais la
mélancolie elle-même est la perte du pouvoir de parler, la souffrance
d’un mutisme sans recours. Toute compassion est mêlée de
tristesse, mais persévérer dans la tristesse aboutit à une paralysie de
la volonté. Concrètement : le sujet mélancolique, s’il est englué dans
sa souffrance, est incapable de se décider et d’agir, sinon sous la
forme de « raptus ». S’il trouve l’énergie d’entreprendre, c’est alors
trop souvent, on le sait, pour mettre fin à ses jours. … La société
humaine est un système d’échanges, qui a besoin de participants actifs,
aptes à se détacher d’eux-mêmes et de communiquer avec un autrui… Les
musiciens qui savent chanter leur mélancolie développent un
pouvoir d’invention qui est déjà une issue pour eux. La dépression
profonde, la mauvaise mélancolie, elles, sont muettes. C’est la mort
dans la vie. Les médicaments antidépresseurs, les électrochocs peuvent
donner, en la circonstance, le coup de pouce nécessaire…"
« Vous venez de réunir dans un livre Accuser et séduire des
essais consacrés à l’un de vos penseurs favoris, Jean-Jacques Rousseau.
Le titre même de cet ouvrage est suffisamment évocateur de la pensée du
philosophe des Lumières : Rousseau tente de convaincre les esprits par
son autorité en élaborant un système en contrepoint de l’introspection
de ses Confessions »
Jean Starobinski : « Rousseau conquiert son public tardivement, en
1748, par le Discours sur les arts et les sciences. C’est un acte
d’accusation. Rousseau dénonce la corruption des mœurs qui résulte du
luxe, lié lui-même au progrès des connaissances et des ressources
techniques. L’accroissement des pouvoirs humains s’étant accompagné
d’une dépravation, morale, d’un accroissement de l’inégalité dans les
sociétés humaines, comment y répondre ?… Le « système » de Rousseau est
l’exposé des remèdes auxquels il est possible de recourir pour restaurer
une harmonie personnelle ou sociale compromise par les excès de la «
civilisation ».
La séduction exercée par Rousseau tient à la multiplicité des images
de l’innocence préservée ou de la réparation du mal, qu’il propose dans
un contraste toujours maintenu avec le désordre, le malaise,
l’inquiétude dont il suppose que ses lecteurs attendent d’être délivrés.
Dans le succès que l’Europe lui a réservé, il a souvent pris figure de
sauveur ou de guérisseur… Un seul exemple me suffira. Quand Rousseau,
dans la Lettre à d’Alembert, développe sa critique du théâtre et
du goût des sociétés modernes pour les spectacles, il n’oublie pas d’y
ajouter une longue note évoquant avec attendrissement une fête militaire
à laquelle, enfant, il a assisté à Genève en compagnie de son père, de
la fenêtre de leur maison, dans le quartier populaire de Saint-Gervais.
Accuser, c’est l’énumération argumentée des effets corrupteurs des
représentations théâtrales. Séduire : c’est offrir le spectacle de la
danse heureuse de tout un peuple après un défilé militaire. Mon livre
réunit divers exemples de la stratégie que Rousseau développe pour
gagner la sympathie de ses lecteurs. »
__________________________
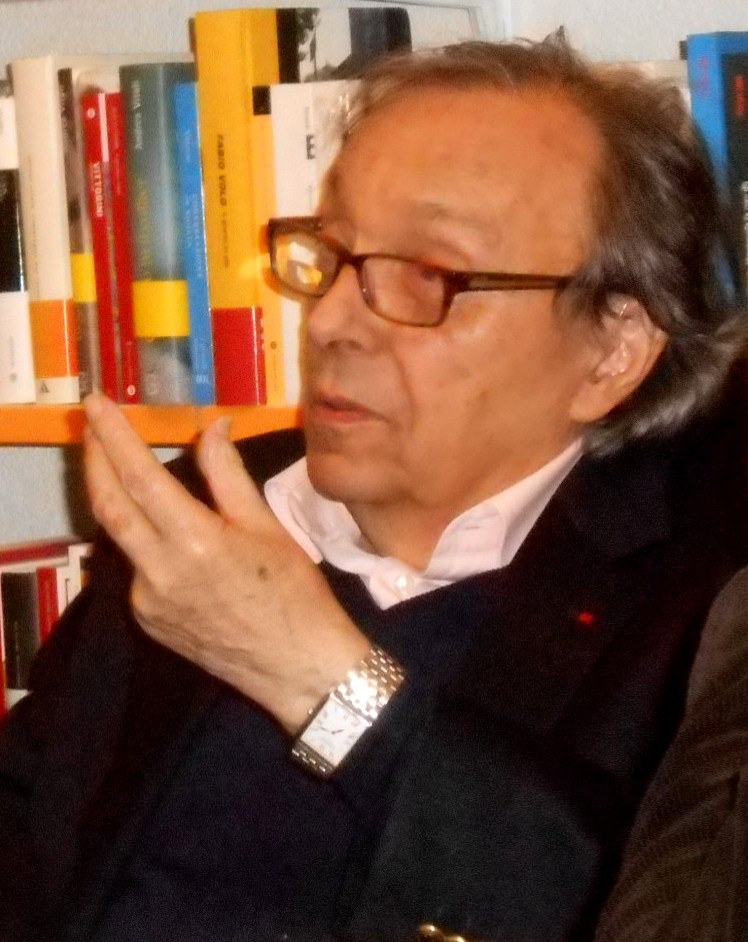 "...Diderot est un
écrivain qui compose volontiers par morceaux, en ordre capricieux comme
dans Les Bijoux indiscrets, ou dans un ordre beaucoup mieux ajusté,
comme dans La Religieuse
ou Le Neveu de Rameau..." "...Diderot est un
écrivain qui compose volontiers par morceaux, en ordre capricieux comme
dans Les Bijoux indiscrets, ou dans un ordre beaucoup mieux ajusté,
comme dans La Religieuse
ou Le Neveu de Rameau..."
(© crédits photos - Frédéric Wandelère)
___________________________
« Dans votre Diderot, un diable de ramage on a plutôt le
sentiment que le philosophe pratique à la fois une certaine
improvisation, mais parfois aussi l’art de la fugue, au sens propre et
musical du terme. Avant de parler, dites-vous, Diderot sait écouter le
siècle en mutation qui l’entoure. »
Jean Starobinski : « Diderot est un écrivain qui compose volontiers
par morceaux, en ordre capricieux comme dans Les Bijoux indiscrets,
ou dans un ordre beaucoup mieux ajusté, comme dans La Religieuse
ou Le Neveu de Rameau. Son art me fait penser d’abord au staccato
plutôt qu’au fugato. Dans ses Salons, il suit l’ordre ou le
désordre des accrochages. Mais il a en même temps le sens des ensembles,
comme vous le remarquez. Pour l’Encyclopédie, il a imaginé le
système des « renvois », afin de compenser la dispersion des matières
imposée par l’ordre alphabétique. Il revendique la plus grande liberté,
mais il ne craint pas de travailler d’après un modèle: Richardson pour
La Religieuse, la tradition picaresque et Sterne pour Jacques
le fataliste. Pour les causes qu’il souhaite servir, il n’hésite pas
à se glisser dans les ouvrages des autres. C’est tardivement qu’on a
découvert l’ampleur des « morceaux » – contre l’esclavage, contre le
pillage colonial et les conversions forcées – qu’il a fournis à l’abbé
Guillaume-Thomas Raynal pour son Histoire philosophique et politique
(…) des deux Indes. »
« Et aujourd’hui ? »…
Jean Starobinski : « Je viens de me consacrer à la lecture des
épreuves d’un recueil de mes divers écrits sur la critique et ses
méthodes, ouvrage publié à Genève, aux éditions de La Dogana, où avaient
été édités mes entretiens avec Gérard Macé.
« Vous étiez très ami avec J.-B. Pontalis récemment disparu. Quel
souvenir gardez-vous de lui ? »
Jean Starobinski : « J.-B. Pontalis était un ami très proche, dont
l’attention comptait beaucoup pour moi. C’est dans le dialogue avec lui
que beaucoup de mes études ont pris naissance, destinées à la revue
qu’il dirigeait. Il représentait l’accueil, l’écoute, la découverte,
l’échange. Son attente appelait dans mon travail la fusion des horizons
explorés : littéraire, historique, souvent même médical. J’avais un
sentiment de grande liberté quand j’écrivais pour lui »
"Merci Jean Starobinski pour cet accueil si chaleureux, chez vous, à
Genève, et pour ce beau témoignage. Nos lecteurs auront plaisir à vous
retrouver dans votre dernier livre sorti aux éditions La Dogana Les
approches du sens."
Propos recueillis par Philippe-Emmanuel
Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
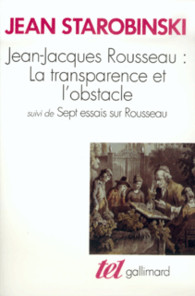 |
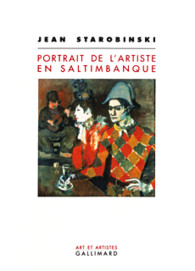 |
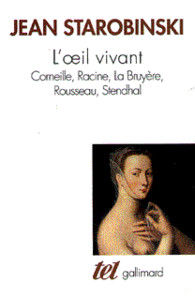 |
 |
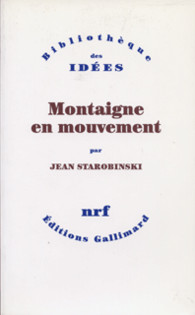 |
 |
|

Bulletin du
Cercle d'études internationales
Jean
Starobinski
Bibliothèque nationale suisse
Archives littéraires suisses ALS
Stéphanie Cudré-Mauroux
3003 Berne
T +41 31 323 23 55
F +41 31 322 84 08
|
Une fois l'an paraît le Bulletin du Cercle. Dans les rubriques «
Bibliographies », « Nouvelles du fonds », « Conférences du Cercle », «
Jeunes chercheurs. Thèses », « Chronologie starobinskienne », etc., on
livre des informations sur la vie des archives de Jean Starobinski. Les
missions du Bulletin ? Évoquer toujours l'esprit d'indépendance et
d'invention propre à Jean Starobinski ; rendre compte de son
extraordinaire foisonnement ; donner un état des lieux des travaux
réalisés sur ses archives ; et, enfin, ouvrir nos colonnes à des écrivains
et à de jeunes chercheurs qui abordent les thématiques starobinskiennes
qui leur sont chères.
http://www.nb.admin.ch/sla/03136/03558/03560/index.html?lang=fr
|
|
Interview
Jean-Paul et Raphaël Enthoven
Paris, 27 août 2013. |
|

© Lexnews |

© Lexnews |
|
Un éditeur
et un philosophe, un romancier et un passeur d'idées, il n'en fallait
pas moins pour composer une belle étude facétieuse, parfois
irrévérencieuse, mais toujours passionnée et passionnante sur l'auteur
d'A la recherche du temps perdu : le grand Marcel Proust dont
2013 voit le centenaire de la publication de son premier volume aux
éditions Grasset. C'est justement dans ces mêmes bureaux que Jean-Paul
et son fils Raphaël ont bien voulu partager leur passion pour Marcel
Proust, une passion qui est au coeur de leur vie, de même que la
Recherche décrit à elle seule en des pages inoubliables tous ces
grands et surtout petits instants de vie. Rencontre avec deux
personnalités généreuses dans leur témoignage, pour notre plus grand
plaisir ! |
Leur dernier livre
...
Dictionnaire amoureux de Marcel
Proust, Plon, 2013.
Depuis sa naissance, voici un siècle, l'oeuvre
de Marcel Proust n'en finit pas d'être assaillie par des hordes de
puristes, de snobs ou de fétichistes, dont les exploits ont parfois
gâché le pur bonheur de partir à la recherche du temps perdu...
D'ou ce Dictionnaire amoureux écrit à quatre mains et qui, n'en déplaise
aux gardiens du temple, a pris le parti de traiter ce monument de la
littérature avec la désinvolture (et l'érudition) qu'il mérite.
De « Rhino-goménol » à « Procrastination », d'« Amour » à « Inversion »,
de « Morand », « Madeleine » et « Cocteau » à « Spinoza », « Ritz » et «
Descartes », les auteurs gambadent à la fois dans la Recherche et dans
la vie de son créateur. Ils auront atteint leur but si cette
encyclopédie fragmentaire et dictée par le plaisir avive par
intermittence, chez ses lecteurs, le désir de (re)lire le plus grand
écrivain de tout le temps.
___________________________________
|
|
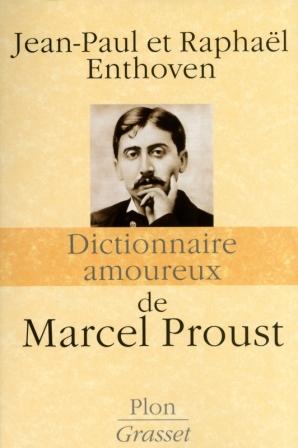

ous avez
commencé votre Dictionnaire amoureux par la lettre A consacrée à
l’Agonie et vous concluez ce même volume par une entrée Z
inattendue réservée à un Zinedine anobli…Vous soulignez que vous
avez souhaité un Dictionnaire à la fois sérieux et désinvolte, voire
moqueur. En quoi cet écart s’imposait-il quant à la Recherche ?
Jean-Paul Enthoven : Il paraît, vous savez, tous les jours trois
ou quatre livres sur Proust, et plusieurs dizaines par an, nous
n'allions pas refaire dès lors un livre qui a été déjà cent fois écrit.
Je pense, notamment, au dictionnaire d’Annick Bouillaguet chez Champion,
et qui est une somme de tout ce que l'on peut savoir sur Proust. Notre
seule chance d'amateurs éclairés était de prendre des chemins de
traverse, ce qui est aussi le jeu de cette collection des Dictionnaires
amoureux, dont la démarche impose d’injecter une dose de subjectivité et
de fantaisie. Il est vrai qu’il était déjà singulier, pour un livre,
d'être écrit par un père avec son fils (et inversement). Mais pour
répondre à votre question, commencer par Agonie m'a amusé, et
avec Proust, il est toujours bon de commencer par la fin. Quant à
Zinedine, c’est la seule blague véritable que je dois d’ailleurs à
Raphaël et qui m’a permis de découvrir que Zidane était un grand lecteur
de la Recherche, une information à porter à la connaissance du
grand public.
Raphaël Enthoven : J’ajouterai qu’on n'est pas sérieux quand on
se prend au sérieux, qu’un minimum de sérieux impose de se moquer de
soi-même. Quant à l'entrée Agonie, elle permet également
d'apporter une précision décisive qui est – les témoins sont formels –
que Marcel Proust n'a pas dit « maman » au moment de mourir. Commencer
par la fin, ou l’agonie, est, en fait, extrêmement important, tout
simplement parce que la rédaction du livre a été entamée au terme de
l'histoire que le livre raconte. Les ultimes épisodes du récit précèdent
immédiatement la rédaction de sa première phrase... Telle est la
Recherche : un livre qui s’engendre lui-même. Quant à Zidane, dont
le coup de texte au plexus de son adversaire est parfaitement décrit par
Proust lors d’une soirée chez la princesse de Guermantes, c'est à la
fois amusant et exemplaire : la Recherche est une machine à
éterniser les instants, même les plus insignifiants. D’un simple clin d’oeil
jusqu’au geste du pouce et de l’index qui permet à Bloch de doser avec
les doigts la parcelle de sang juif qu'il a dans ses veines, en passant
par la manière dont Mme de Cambremer plisse les yeux quand elle parle de
Debussy, Marcel Proust est un éterniseur d’infime.
J-P. E. : C'est la loi de cette collection et également notre
façon de le lire. Tout le monde ne réagit pas de la même façon devant un
passage de Proust. Chaque lecture entre en résonance avec des souvenirs
ou avec des émotions singulières et spécifiques, et il est vrai que ce
passage avec le duc de Guermantes m'a beaucoup fait rire.
R. E. : « Se tournant d'un seul mouvement et comme d'une seule
pièce vers le musicien indiscret, le duc de Guermantes, faisant front,
monumental, muet, courroucé, pareil à Jupiter tonnant, resta immobile
ainsi quelques secondes, les yeux flambant de colère et d'étonnement,
ses cheveux crespelés semblant sortir d'un cratère. Puis, comme dans
l'emportement d'une impulsion qui seule lui permettait d'accomplir la
politesse qui lui était demandée, et après avoir semblé par son attitude
de défi attester toute l'assistance qu'il ne connaissait pas le musicien
bavarois, croisant derrière le dos ses deux mains gantées de blanc, il
se renversa en avant et asséna au musicien un salut si profond, empreint
de tant de stupéfaction et de rage, si brusque, si violent, que
l'artiste tremblant recula tout en s'inclinant pour ne pas recevoir un
formidable coup de tête dans le ventre... » En fait, le Duc vise le
ventre et non le sternum de son adversaire, c'est toute la différence
entre le XXe et XXIe siècle !
Vous évoquez avec émotion – Raphaël – l’importance qu’a pu avoir ce
texte pour vous dans vos années de jeunesse.
R. E. : Une importance considérable. Mais pour vous répondre,
j’ai besoin de faire un tout petit détour par l'Éthique de
Spinoza. Le corollaire de la seizième proposition de la deuxième partie
de l'Éthique affirme que « les affections de notre corps nous
renseignent davantage sur l'état de notre corps que sur la nature du
corps qui nous affecte ». En bon français, cela signifie tout
simplement que la meilleure façon d'être fidèle à quelqu'un est d'être
fidèle aux impressions qu'il dépose en nous et qu'il faut faire droit –
c’est le génie de l’Éthique - à la part de vérité que contient
une relation mutilée, partielle, inadéquate au monde. Il faut faire
droit à la sensibilité qui nous constitue ; il n'y a jamais d'erreur
complète, on ne saurait récuser intégralement une opinion car elle
contient déjà un élément de vérité. Là est la grande leçon de tolérance
de Spinoza et son refus de la négation qui ont été si importants pour
moi. Il faut être fidèle à ses sensations : j'ai donc tenté de retracer
le fil impressionniste de mes émotions d’enfant, ou le cheminement qui
va d’une d'une connaissance parcellaire et fragmentaire à une idée plus
précise. L’entrée à laquelle vous faites référence (« roman
d’apprentissage ») fait écho, en cela, à une autre entrée consacrée à
Deleuze. Le troisième chapitre de Proust et les signes de Deleuze
porte précisément sur l'apprentissage, et montre comment le fait
d’apprendre consiste à dépasser le dialogue entre une subjectivité et
l'objectivité à laquelle elle prétend. Deleuze explique ainsi que
l'objectivité n'est qu'une façon d'être subjectif et qu'il faut
transcender ces deux déterminations pour accéder à un rapport de
l'individu qu’il appelle anexact, ni exact ni inexact, mais
fidèle à l’œuvre. Dès lors, j'ai essayé de décrire aussi précisément que
possible les impressions parcellaires déposées en moi par ce livre. Or,
au commencement, sans avoir l’idée précise de ce que désignait le bloc
râpeux et floral de ces trois-quatre syllabes (La-re-cher-che…), j’en
soupçonnais confusément la valeur. Était-ce un lieu ? Une formule
magique ? Un jeu ? Un peu tout cela, probablement.
___________________________
"Une
passion complice et
amoureuse pour Marcel nous rapproche tous les deux, cela
n'empêche pas des divergences entre nous, car nous ne lisons pas ce
livre de la même manière."
___________________________
Vous faites référence dans votre introduction à ce Dictionnaire à vos
rapprochements ainsi qu’à vos discordances quant à l’œuvre de Proust.
J-P. E. : Une passion complice et amoureuse pour Marcel nous
rapproche tous les deux, cela n'empêche pas des divergences entre nous,
car nous ne lisons pas ce livre de la même manière. Pour aller
rapidement, je suis de la vieille école et j'adore l'aspect
biographique, l'anecdote, le petit fait vrai. J'ai un réel plaisir à
relever dans l'oeuvre quelque chose qui fait écho dans la vie, même ces
transformations pratiques me fascinent…
R. E. : Jean-Paul est de la vieille école, et en ce qui me
concerne, je suis de l’école antique ! (rires…)
J-P. E. : …Évidemment, lorsque l'on fonctionne de cette façon,
quand on indexe une oeuvre sur la biographie qui lui donne le jour, on
passe pour un disciple de Sainte-Beuve. En revanche, les modernes (ou
les anciens, comme dit Raphaël) étudient quant à eux un texte qui se
suffit à lui-même. À mon avis, nous avons tous les deux raisons…
R. E. : Ou bien tort, tous les deux. En ce qui me concerne, j'ai
toujours eu l'impression que la méthode de Sainte-Beuve est une
anti-alchimie qui transforme l'or en plomb. C'est la victoire d'Antoine
Berthet (dont Stendhal s’est inspiré pour écrire Le Rouge et le Noir)
sur Julien Sorel, et cela m'a toujours énervé. C'est aussi le problème
de l'egofiction qui donne le sentiment, avec des prénoms d'emprunt, de
désigner des personnes réelles. Je suis allergique à cette façon de
faire, souvent emprunte de ressentiment, de vengeance. Or, la
littérature ne sert pas à régler des comptes. Mais je suis bien obligé
de reconnaître que le réductionnisme sainte-beuvien appliqué à Proust
produit malgré tout de la littérature ! Et puis l’honnêteté commande de
dire qu’il y a effectivement, dans la Recherche, des moments où
l’on ne sait plus si c'est Marcel (le Narrateur) ou Marcel Proust
(l’écrivain) qui parle. Mais l'intérêt véritable de cette divergence
fondamentale entre nous était la certitude de ne jamais écrire la même
chose, fût-ce sur le même sujet.
J-P. E. : En effet : n'avions même plus besoin de nous concerter
sur les entrées tellement elles allaient de soi ! Cela n'a concerné que
deux ou trois entrées comme Asperge…
R. E. : Oui, là, je n’étais pas d'accord.
J-P. E. : En règle générale, c’est toujours toi qui n’es pas
d’accord ! (rires…). Nous avons mis au point, sans nous concerter, un
mode de fonctionnement et d'élaboration de ce livre qui s'est avéré
formidablement commode puisque finalement nous n'avions plus besoin de
nous consulter. Raphaël savait en m’envoyant une entrée que je n'aurais
pas songé à la faire.
R. E. : J'étais certain, par exemple, de ne pas faire l’entrée «
Agostinelli », et j'étais certain que mon père ne ferait pas «
Bergson ». Nous savons comment nous fonctionnons l’un et l’autre. Un
Dictionnaire amoureux du Temps perdu n’aurait pas eu besoin des
biographèmes et, à la limite, un Dictionnaire amoureux de Proust aurait
pu faire l'économie de la Recherche. Ici, nous faisons un
Dictionnaire amoureux qui regroupe ces deux dimensions.
J-P. E. : Il faut ajouter à cela une idiosyncrasie particulière à
chacun : j'adore lire les dizaines de petits ouvrages sur Proust tels
Proust et le liège, Proust et la pommade Legras… J'adore, cela me
passionne ! Chaque fois que je passe rue Laurent Pichat ou au centre du
boulevard Haussmann, j'ai le cœur qui bat alors que Raphaël s'en fiche
littéralement…
R. E. : …Moi, je veux savoir où habite le personnage d’Odette !
La rue La Pérouse m’intéresse plus que le boulevard Haussmann (où vivait
Proust lui-même)…
J-P. E. : C'est très curieux et qu'est-ce que cela veut dire ?
Que je suis plus littérateur et que Raphaël tend plus vers la
philosophie ? Bien entendu, c'est une très vieille histoire entre nous
deux.
R. E. : Je suis arrivé après toi dans cette affaire…
J-P. E. : « Il occupait le ciel je n'avais plus que le choix
de l'enfer ». Pardonnez l'immodestie, mais c'est ce que Baudelaire
disait à Victor Hugo !
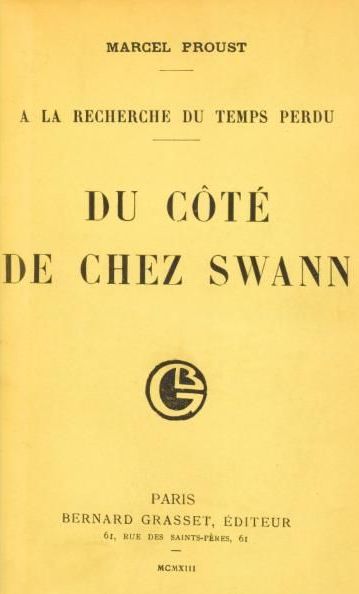
2013 marque la publication chez Grasset du premier volume de la
Recherche – Du côté de chez Swann. Comment l’éditeur perçoit-il
cette date - un siècle plus tard -, et à partir de quand peut-on estimer
que Marcel Proust est devenu un auteur classique ?
J-P. E. : Il est très émouvant, en effet, de penser que c'est
dans ces mêmes lieux que ce premier volume a été édité. L'histoire est
cocasse : tous les éditeurs l’ont refusé. Il arrive ici à compte
d'auteur, ce qui à l'époque n'était pas – rappelons-le - une mauvaise
manière surtout en ce qui concerne Proust. Il souhaitait être édité sans
être lu, c'était son exigence de base ; il souhaitait également payer le
nombre d'épreuves qu'il voulait et garder le contrôle complet de son
œuvre. Quant au refus de Proust lui-même, il est évident que les choses
n'ont jamais changé, les éditeurs - et j'en suis un- ne voient jamais ce
qui excède les lois de la mode, du marché. Cela dit, dans le cas de
Proust, son livre a été lu comme un chef-d’œuvre tout de suite, non pas
par les éditeurs ni même par le public (qui le découvrira vraiment à
partir du Goncourt) mais auprès des meilleurs de sa génération : Mauriac
, Berl, Morand, Cocteau, Francis Jammes savent d'emblée qu'il est
génial. Qu’Ollendorff et Bernard Grasset ne l’aient pas su tout de suite
a beaucoup moins d’importance. Dans une lettre que Morand, après l’avoir
lu, écrit à un ami diplomate, il n'hésite pas à dire que c'est nettement
plus fort que Flaubert. On dit rarement cela d'un jeune auteur. En
vérité, Proust était un écrivain considéré comme un génie alors même
qu'il n'avait rien publié. Il a été grand écrivain avant même de donner
le jour à son œuvre littéraire.
R. E. : C'est peut-être la raison pour laquelle, dans Le Temps
retrouvé, se trouve un passage très émouvant où Odette raconte au
narrateur quelques-unes de ses aventures, notamment sa liaison avec
Hannibal de Bréauté et, bien sûr, avec Swann. Or on comprend, en lisant
ces pages, que c’est de cette conversation (qui ne nous apprend
pratiquement rien) qu’est né Un amour de Swann. Le narrateur
sourit en racontant qu’Odette, parce qu’elle s’adresse à celui qu’elle
tient déjà pour un écrivain, essaie d'augmenter le pittoresque de son
histoire avec Bréauté et avec Swann à la seule fin de marquer son
territoire dans l'oeuvre à venir qu'elle pressent. Les personnages de la
Recherche savent déjà que le narrateur est seul susceptible, un
jour ou l'autre, de les immortaliser ; chacun pimente le récit de sa
vie, sans s’apercevoir que les gens ne sont jamais si faubourg
Saint-Germain que lorsqu’ils veulent être romanesques, ni si romanesques
que lorsqu’ils sont faubourg Saint-Germain ! Comment l’auraient-ils
compris ? On ne demande pas aux muses d’être critiques littéraires, ni
aux insectes de lire des traités d’entomologie.
J-P. E. : Et, allons même plus loin, Proust a toujours su qu’il
était génial. Les écrivains traversent en général des zones de doute,
mais lui n'a jamais douté. C'est même assez magique, car jusqu'en 1905,
son oeuvre est plutôt vaporeuse avec Les Plaisirs et les Jours,
Jean Santeuil, Ruskin… Mais, dès qu'il s’y met véritablement, il
ne doute pas une seconde qu’il entreprend quelque chose de majeur. C’est
ce qui explique qu’il n’ait pas été étonné, dans les derniers mois de sa
vie, qu’on songe à lui attribuer le prix Nobel. Cette complexion humaine
est une des plus rares qui soit. Aujourd'hui, dans ce bureau, il
m'arrive de recevoir assis à votre chaise des personnes qui affirment
être des génies sans voir qu’en le disant, ils m'informent qu’ils ne le
sont pas ! Marcel, lui, le savait, et pourtant c’était vrai… Je ne vois
pas d’équivalent parmi les écrivains : Kafka doutait sans cesse,
Flaubert n'était pas sûr du tout. Bien sûr, vous avez des écrivains qui
se pensent géniaux et qui s'établissent grand écrivain « comme on
s'établit grand coiffeur » selon la formule de Guéhenno à l’encontre de
Gide. Gide a pensé d'emblée qu'il était le Goethe français... C’est son
mauvais côté.
___________________________
"Il y
a dans ce déni du nom, et dans l’invisibilité du Narrateur, une lucidité accrue qui lui permet de voir les
choses avec plus d’acuité que le langage n’en dispose."
___________________________
Suivant en
cela la grande tradition de Flaubert et surtout de Balzac, la
dénomination – ainsi que l’onomastique à laquelle vous réservez une
entrée – sont des structures indispensables à la Recherche.
Paradoxalement, le Narrateur n’est quant à lui à aucun moment évoqué
directement par son nom. Comment levez-vous ce paradoxe ?
J-P. E. : Le prénom Marcel n'arrive en effet que trois fois et de
façon accessoire.
R. E. :
Mon père compare cela à la signature d'un artiste au bas de son tableau,
ce qui est particulièrement bien vu.
J-P. E. : Proust est nommé aussi, en filigrane, avec cette Petite
Madeleine dont les majuscules forment les initiales de l'auteur. Mais
l'obsession de Proust pour les noms qui faisait des listes - à la
manière de Modiano si je puis dire – et le fait que son narrateur
principal n’ait pas de nom sont deux faits tout de même troublants et
paradoxaux. Sans compter l’homosexualité... Les deux caractéristiques
fondamentales de Marcel - la passion du nom et l’homosexualité - ne sont
pas nommées, ce qui est un coup de génie.
R. E. : On pourrait ajouter quelques petites choses. Tout
d'abord, la figure d’Elstir dont le génie propre dans la Recherche
est d'être le « dénomateur » (je ne suis pas certain que le Narrateur
emploie le mot, mais Elstir est celui qui dénomme les choses). Dieu le
créateur a nommé les choses, Elstir (Dieu de la Recherche) fait
exactement le contraire. Comme si, au commencement, il y avait tout,
sinon les mots pour le dire (et le perdre en le disant). Au début, il y
avait le silence : Elstir est une sorte d’archéologue qui parvient avec
ses tableaux à revenir en amont du langage. Il est celui dont la
peinture dépouille les objets de leur utilité et donne à voir la beauté
d'un veston, le scintillement de la mer, etc. parce qu'il les dissocie
de l’utilité concrète à laquelle les réduisent les mots pour les
décrire. Les tableaux d’Elstir racontent le monde sans les hommes, sans
fonctions, sans usage et sans noms. Or, à de rares exceptions qui
confirment la règle, le narrateur lui-même n’a, la plupart du temps, pas
de nom et apparaît souvent comme invisible. Il est celui qui voit les
choses sans qu'on le voie, celui dont le regard sur le monde n'altère
pas ce qu'il regarde. C'est le contraire de la physique quantique. Le
problème de la physique quantique est qu'un phénomène observé apparaît
comme comptable des procédures mises en œuvre pour l'observer. C'est
pour cela qu'on n’arrive jamais à saisir les choses. Le monde est
solidaire de la perception qu’on en a et des outils employés à cette
fin. Or, ce que le narrateur parvient à voir, c’est le monde sans lui :
le baron de Charlus qui, ne se sachant pas regardé, redevient la femme
qu’il a toujours été, ou la fille de Vinteuil qui, ignorant la présence
de l’indiscret, lâche la bride au saphisme qui est le sien… Il y a dans
ce déni du nom, et dans l’invisibilité du Narrateur, une lucidité accrue
qui lui permet de voir les choses avec plus d’acuité que le langage n’en
dispose.
J-P. E. : Je complète sur deux points. Ce narrateur du temps
perdu est la raison même pour laquelle Visconti a abandonné l'idée de
filmer A la recherche du temps perdu. Comment faire un film sur
la Recherche sans donner au « je » du livre un rôle primordial ?
De fait, le rôle était promis à Alain Delon : on n’aurait vu que lui...
alors même que le Narrateur est le personnage le plus invisible de la
Recherche. Deuxièmement, de l'obsession de Marcel Proust pour les
noms, vous avez des exemples invraisemblables. Il a une véritable
passion pour les chercher, pour les crypter, vous avez de véritables
jeux de mots. J'ai écrit une entrée sur Mme de Cambremer qui vient de
Mme Forthoule – forte houle - qui a donné mer cambrée d’où Cambremer… Et
les autres exemples seraient nombreux à citer. Vous avez deux experts en
étymologie dans la Recherche : Brichot et l’abbé de
Saint-Hilaire. Or, l'étymologie est très importante, car elle est une
des premières déceptions de Proust. Il se rend compte que les mots
finalement ont souvent une autre origine que celle qui est donnée à
écouter. Barfleur par exemple n’est pas un champ avec des fleurs, mais
provient du bas normand fjord et signifie qu'une rivière arrivait
jusque-là. La déception étymologique est une étape pour enquiller, si
j'ose, dire les déceptions les unes après les autres. Tout cela a donné
naissance à des exégètes, à des talmudistes de la Recherche.
|
(...)
R. E. :
Je viens de retrouver ce matin dans Madame Bovary - que je relis
pour les besoins d'une émission de radio - ce passage en particulier qui
est fabuleux parce que Charles Bovary n'arrive pas à dire son nom. Voilà
ce que dit Flaubert : « Le nouveau prenant alors une résolution
extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à pleins poumons comme
pour appeler quelqu'un ce mot : Charbovari. » Or, ce seul mot
(mélange de Charles Bovary et de charivari) qui fait hurler de rire
toute la classe… Quand on se reporte à la Recherche, on découvre
un passage semblable : le narrateur, n'étant pas sûr d'être invité à la
soirée de la princesse de Guermantes, voudrait que l’huissier se garde
de hurler son nom. Écoutez :
« Mais c'était maintenant mon tour d'être annoncé. Absorbé dans la
contemplation de la maîtresse de maison, qui ne m'avait pas encore vu,
je n'avais pas songé aux fonctions, terribles pour moi – quoique d'une
autre façon que pour M. de Châtellerault – de cet huissier habillé de
noir comme un bourreau, entouré d'une troupe de valets aux livrées les
plus riantes, solides gaillards prêts à s'emparer d'un intrus et à le
mettre à la porte. L'huissier me demanda mon nom, je le lui dis aussi
machinalement que le condamné à mort se laisse attacher au billot. Il
leva aussitôt majestueusement la tête et, avant que j'eusse pu le prier
de m'annoncer à mi-voix pour ménager mon amour-propre si je n'étais pas
invité, et celui de la princesse de Guermantes si je l'étais, il hurla
les syllabes inquiétantes avec une force capable d'ébranler la voûte de
l'hôtel. »
C'est la même affaire : il y a quelque chose d'indicible qui doit
parvenir au jour et l'apparition de Marcel dans la Recherche, je
la verrais plutôt comme cela, comme la survivance de quelque chose
d'indicible qui aurait passé, à corps et à cris, la douane du langage.
J-P. E. : Il ne faut pas oublier que pendant longtemps on ne
prononçait pas le « s » du nom de Proust et donc son nom était
difficilement dicible. C'est tout de même intéressant d'avoir le nom
d'un pet, et il a eu des problèmes gigantesques avec cela.
___________________________
"...la Recherche
est une œuvre autonome, qui s’enfante elle-même, se suffit à elle-même.
Une œuvre vivante, une œuvre de sang chaud."
___________________________
En quoi
Proust renouvelle-t-il l’art du roman ?
J-P. E. : la question est évidemment immense, mais ce qui me
vient immédiatement à l’esprit est que Proust sait tout faire, la
drôlerie, le tragique, la théorie à l’intérieur du roman, il sait
fabriquer du présent avec du passé, il parvient à inventer des
personnages qui existent en nous…
R. E. : Il met en place un système romanesque qui – même s’il
n’est peut-être pas le premier à le faire – se nourrit de lui-même.
C’est en cela que je suis contre Sainte-Beuve, car la Recherche est une
œuvre autonome, qui s’enfante elle-même, se suffit à elle-même. Une
œuvre vivante, une oeuvre de sang chaud. Et cela tout au long de
l’ouvrage, non pas seulement à la fin du roman. A chaque page, l’auteur
du livre semble croiser le Narrateur qui est en train d’apprendre qu’il
est un auteur. J’ai toujours été stupéfait par ce cas d’autarcie
littéraire. Le paradoxe (ou le malentendu) est qu’on a longtemps réduit
l’œuvre de Proust à son époque : Cocteau par exemple ne lisait la
Recherche que comme un bréviaire mondain où il apparaissait (plutôt)
à son avantage.
J-P. E. : Les mille et une nuits vues depuis une loge de
concierge…
R. E. : De fait, il y a de nombreuses références antiques dans la
Recherche, par exemple au chant 11 de L’Odyssée dans
lequel Ulysse, descendant aux enfers pour y recueillir les conseils du
devin Tirésias, y rencontre sa mère et même Achille. Mais ce sont des
fantômes, qui s’estompent quand il s’en approche, à la manière dont le
Narrateur, découvrant en lui, à l’occasion d’un deuil, « l’étrange
contradiction de la survivance et du néant », ne perçoit qu’après leur
mort la réalité vivante de ceux qu’il aime. Plus étonnant encore : à la
fin du Temps retrouvé, lors d’une matinée chez la princesse de
Guermantes où tous les participants lui semblent d’abord s’être déguisés
(tant ils ont vieilli), le Narrateur retrouve un ancien camarade que le
passage du temps et l’embonpoint ont rendu méconnaissable, à l’exception
de son rire qui, lui, n’a pas changé : « Décidément il me semblait
que c'était quelqu'un d'autre, quand tout d'un coup j'entendis, à une
chose que je disais, son rire, son fou rire d'autrefois, celui qui
allait avec la perpétuelle mobilité gaie du regard. Des mélomanes
trouvent qu'orchestrée par X la musique de Z devient absolument
différente. Ce sont des nuances que le vulgaire ne saisit pas, mais un
fou rire étouffé d'enfant, sous un œil en pointe comme un crayon bleu
bien taillé, quoique un peu de travers, c'est plus qu'une différence
d'orchestration. Le rire cessé, j'aurais bien voulu reconnaître mon ami,
mais comme, dans l'Odyssée, Ulysse s'élançant sur sa mère morte, comme
un spirite essayant en vain d'obtenir d'une apparition une réponse qui
l'identifie, comme le visiteur d'une exposition d'électricité qui ne
peut croire que la voix que le phonographe restitue inaltérée ne soit
tout de même spontanément émise par une personne, je cessai de
reconnaître mon ami. »

© Lexnews
J-P. E. : Proust est un métaphoriste de génie, ses métaphores
sont à chaque fois déconcertantes et déroutantes. C’est un bonheur à
chaque chute de phrase, c’est tout de même extravagant ! Par exemple, un
jour, Proust reçoit le livre d’un mondain et commence par le féliciter
sur son évocation de la lune, mais il poursuit en lui disant qu’évoquer
la lune comme pâle et languide est bien, mais que cela a été beaucoup
dit. Il lui indique alors qu’il aurait pu la décrire différemment : «
Parfois dans le ciel de l'après-midi passait la lune blanche comme une
nuée, furtive, sans éclat, comme une actrice dont ce n'est pas l'heure
de jouer et qui, de la salle, en toilette de ville, regarde un moment
ses camarades, s'effaçant, ne voulant pas qu'on fasse attention à elle.
» Imaginez la tête de son correspondant devant une telle réponse...
C’est magnifique !
Une hypersensibilité…
R. E. : Certainement…
J-P. E. : Oui, une hypersensibilité, accrue par l’asthme, a
accentué cela, car cette affection est une muse en soi. L’asthmatique
est lancé dans une guerre perpétuelle contre les poussières, les
pollens... Tout comme la jalousie dont il procède, l’asthme dilate
l’attention au réel. J’ai tendance à penser que l’on ne peut pas être
romancier sans être jaloux, sinon on ne remarque pas que la femme,
peut-être infidèle, qui vous accompagne, remet la même robe et qu’elle
est dans la même humeur à chaque fois qu’elle la porte. C’est cette
obsession que le narrateur manifeste à l’endroit d’Albertine.
R. E. : Je t’accorde l’asthme, mais je ne suis pas d’accord avec
le rôle que tu donnes à la jalousie. A mon avis, mais ça n’engage que
moi, la jalousie est une forme de cécité. Car le jaloux n’observe que ce
qui lui convient. La jalousie rend aveugle à tout ce qui pourrait la
démentir, ou pire : la confirmer dans ses soupçons. Ainsi, tout jaloux
qu’il est, le narrateur refuse d’ouvrir les lettres qu’Albertine,
imprudemment, a laissées dans la poche de son kimono (qui normalement ne
devrait pas en avoir puisque seuls les kimonos d’homme en disposent).
Pourquoi s’abstient-il de fouiller dans ses affaires ? Deux hypothèses :
soit il veut rester jaloux et redoute que ces lettres lui délivrent le
fin mot de l’histoire, soit les pages qui décrivent Albertine endormie
composent un des rares moments de la Recherche où, véritablement
amoureux, le Narrateur se satisfait des apparences et ne cherche pas à
connaître l’envers du décor.
J-P. E. :
Cela n’enlève en rien au fait qu’avec la jalousie, tout fait signe. Soit
l’on est doué pour l’observation et c’est un don en soi, soit l’on est
dépourvu de cette qualité et la ressource vient alors de la jalousie :
une rougeur, une expression, un sourire plus ou moins ouvert. C’est
pourquoi, dans les Fragments d’un discours amoureux, Barthes dit
et montre que la jalousie, bien avant le talent, est la condition de la
création romanesque.
R. E. : Oui, mais le jaloux est un théoricien, il voit des causes
là où il n’y en a pas nécessairement.
J-P. E. : Lorsque tu fais un roman, tu as intérêt à trouver des
causes…
R. E. : Pas nécessairement, au début de La Prisonnière par
exemple, le narrateur vit avec Albertine et la garde avec lui à la
maison. Apprenant cela, Bloch, qui se trompe toujours, lui dit
comprendre la raison pour laquelle il ne sort jamais de chez lui. Erreur
profonde. Comme dit Proust : « Ceux qui apprennent sur la vie d'un
autre quelque détail exact en tirent aussitôt des conséquences qui ne le
sont pas et voient dans le fait nouvellement découvert l'explication de
choses qui précisément n'ont aucun rapport avec lui. » Cette phrase
est à graver en lettres d’or sur la cheminée, s’il en a une, du premier
conspirationniste venu.
J-P. E. : Voilà qui vous donne une petite idée de la manière dont
nous fonctionnons ! (rires)…
___________________________
"Il y
a chez Proust quelque chose de très mystérieux qui fait que ce qu’il
écrit entre toujours en résonance avec
l’état d’esprit du lecteur et l’état de son développement sentimental,
psychique, intellectuel."
___________________________
Vous soulignez combien les lectures de la Recherche se transforment
au cours des âges de la vie. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
J-P. E. : C’est une particularité de ce livre. A chacune de ses
lectures, il me paraît nouveau. Si je relis Voyage au bout de la nuit
de Céline ou Une ténébreuse affaire de Balzac, j’ai le sentiment
de lire toujours la même œuvre. Il y a chez Proust quelque chose de très
mystérieux qui fait que ce qu’il écrit entre toujours en résonance avec
l’état d’esprit du lecteur et l’état de son développement sentimental,
psychique, intellectuel. C’est une magie. Seule la poésie, peut-être,
relève du même enchantement : on ne lit pas de la même manière Les
Fleurs du Mal à dix-huit ans et à cinquante.
En quoi cette grande œuvre littéraire nourrit-elle des liens étroits
avec la philosophie alors même que Proust ne souhaitait pas faire un
livre à thèse ?
R. E. : Le fait que Proust n’ait pas souhaité faire un livre à
thèse n’est pas contradictoire avec la philosophie. Au contraire, la
vraie philosophie se moque de la philosophie - c’est Pascal qui l’a dit,
et Nietzsche qui l’a mis en œuvre, comme Proust, à sa manière. Car la
Recherche est une mine d’or pour la philosophie. La façon dont le
Narrateur s’efface pour laisser le monde venir à lui, l’art qui est le
sien d’être à la fois spectateur et invisible lui donne accès à un monde
dépouillé des catégories humaines, lui permet d’envisager le réel
séparément du besoin qu’il en a. Par ailleurs, si on laisse de côté les
mentions folkloriques de Schopenhauer qui font toujours bien dans les
salons - car il est celui qui permet à peu de frais d’avoir l’air lucide
et désespéré - on découvre chez Proust une lecture très fine de ce
philosophe, qui va bien au-delà de l’image d’Épinal d’un Schopenhauer
pessimiste pour s’inspirer du Schopenhauer bouddhiste, penseur de la
palingenèse, qui reproche à la feuille de l’arbre de pleurer sa mort
prochaine sans comprendre qu’en mourant, elle fertilisera l’humus qui
donnera le jour à d’autres feuilles… « La loi cruelle de l'art,
affirme le Narrateur, est que les êtres meurent et que nous-mêmes
mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe non
de l'oubli, mais de la vie éternelle, l'herbe drue des œuvres fécondes,
sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de
ceux qui dorment en dessous, leur « déjeuner sur l'herbe ». Il y a
aussi le moment où le Narrateur n’écoute plus ce qu’on lui dit, mais la
manière dont on lui parle : « le charme apparent, copiable, des êtres
m'échappait parce que je n'avais plus la faculté de m'arrêter à lui,
comme le chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le
mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas
les convives, parce que quand je croyais les regarder je les
radiographiais. » Autrement dit, pour reprendre une fameuse
distinction de Montaigne, la matière d’un discours l’intéresse moins que
sa manière. Et la démarche qui consiste à surmonter les apparences au
profit des lois et des règles qu’elles recouvrent, elle ressemble
d’assez près à l’ambition cartésienne de surmonter les illusions des
sens au profit d’une connaissance véritable.
J-P. E. : On arrive à Spinoza…
R. E. : Absolument, par-delà les différences objectives,
L’Éthique et la Recherche donnent le sentiment de suivre le
même chemin de connaissance : le processus d’apprentissage du Narrateur
se fait en trois temps qui correspondent étonnamment aux trois genres de
connaissance selon Spinoza. D’abord, il y a l’enfance, où le sens de
l’émerveillement le dispute aux déceptions face aux choses qui, n’étant
qu’elles-mêmes, n’arrivent pas au talon de l’espoir qui les précède.
C’est l’époque des opinions hâtives, des désirs qu’on prend pour des
réalités, mais aussi des associations d’idées et de l’attention portée
aux impressions que le monde dépose en nous : connaissance du premier
genre. Vient ensuite la puberté, c’est-à-dire l’intelligence,
l’observation de lois immuables sous la matière apparemment confuse des
rapports humains, la tendance à s’attarder non plus sur la teneur d’un
propos, mais sur la manière dont il est tenu, le goût de saisir des
identités stables malgré les apparences, à travers des lieux et des
temps divers, l’oubli de soi au profit des notions communes et des idées
adéquates : connaissance du second genre. Enfin, à la faveur
d’extases que le Narrateur finit par comprendre au lieu de les subir,
advient le temps retrouvé, c’est-à-dire l’éternité des sensations, l’art
de mettre en mot l’unicité du monde et la munificence de chaque instant
: c’est le troisième genre de connaissance, qui s’attache aux
détails comme à l’ensemble et remplace le souci du divertissement par «
l’amour d’un objet immuable et éternel » dont la possession
n’épuise pas le désir. On trouve également chez Proust une référence à
peine masquée aux Essais de Montaigne dont il reprend, à la fin
de son livre, l’ultime image des hommes juchés sur des échasses. Ou une
retranscription quasi littérale du paragraphe que Nietzsche consacre
dans Le Gai Savoir aux « amitiés stellaires » dans la lettre que
le baron de Charlus adresse à un majordome qui n’a pas répondu à ses
avances. Et je ne vous parle pas de Bergson, dont Proust était le cousin
par alliance et, peut-être, le meilleur interprète...
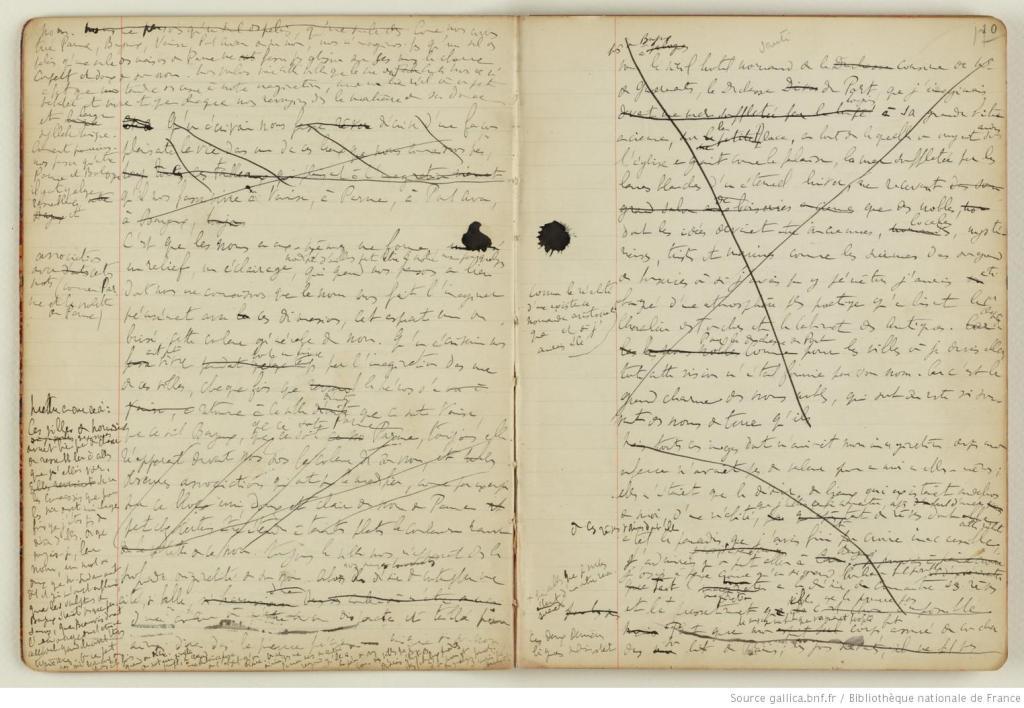
L’omniprésence des sens jalonne la Recherche, ce sont de
nombreux repères essentiels à la réminiscence sans pour autant faire de
Proust qu’un écrivain de la sensualité. Cela revient-il à dire que selon
vos propres termes « la Recherche pourchasse l’éternité d’une
sensation » ?
J-P. E. : Je ne pense pas que l’on puisse dire que Proust ne soit
pas un écrivain sensuel. Il y a un gros interdit bien sûr, car nous
n’arrivons jamais à savoir quelles sont ses relations avec Albertine.
Mais cette sensualité ne s’inscrit-elle pas dans quelque chose de
plus vaste, cette idée de pourchasser l’éternité…
J-P. E. : Oui, Proust passe son temps effectivement à rechercher
l’essence du fugace. Qu'est-ce que l’éternité ? Ce n’est pas l’éternité
chrétienne, c’est au contraire le passage lui-même. C’est l’aptitude à
voir ce qui est éternel dans un sourire qui dure dans une nanoseconde…
R. E. : Ou dans le goût d’une madeleine…
J-P. E. : Je pense que la Recherche est un gigantesque
haïku qui, tout en condensant toute chose, dilate le fugace sur
trois mille pages.
R. E. : Proust rend présent le passé. Il décrit des gestes avec
un tel génie qu’on les voit constamment s’esquisser. Les personnages de
Proust, de même, sont en permanence sur le point d’accomplir le geste
qu’il nous décrit. Tout ce qu’on observe sans savoir qu’on l’observe, il
le couche sur le papier pour nous. Lire la Recherche, c’est
passer en revue tout ce dont on est le spectateur sans avoir le courage,
ou tout simplement l’idée, de mettre des mots dessus.
J-P. E. : Soulignons encore l’obsession de Proust pour la
photographie, dès qu’il voyait quelqu’un, il lui demandait sa photo.
Brassaï a écrit un très beau livre sur Proust et la photographie.
L’auteur de la Recherche estimait qu’elle lui permettait
d’entrevoir l’éternité de ce qui ne dure pas chez un être.
R. E. : Voici, pour la sensualité, un passage auquel je pensais :
« Avant qu'Albertine m'eût obéi et m'eût laissé enlever ses souliers,
j'entr'ouvrais sa chemise. Les deux petits seins haut remontés étaient
si ronds qu'ils avaient moins l'air de faire partie intégrante de son
corps que d'y avoir mûri comme deux fruits ; et son ventre (dissimulant
la place qui chez l'homme s'enlaidit comme du crampon resté fiché dans
une statue descellée) se refermait à la jonction des cuisses, par deux
valves d'une courbe aussi assoupie, aussi reposante, aussi claustrale
que celle de l'horizon quand le soleil a disparu. Elle ôtait ses
souliers, se couchait près de moi. »
Il y a un grand nombre d’écrivains qui se veulent plus sensuels et qui
le sont moins que lui. Des passages comme celui-là, il y en a beaucoup,
et je suis sûr, en ce qui me concerne, qu’Albertine est pleinement une
femme. Avant d’être le clone littéraire d’Alfred Agostinelli, Albertine
est une vraie femme. Peu d’écrivains savent aussi bien parler des
femmes.
|
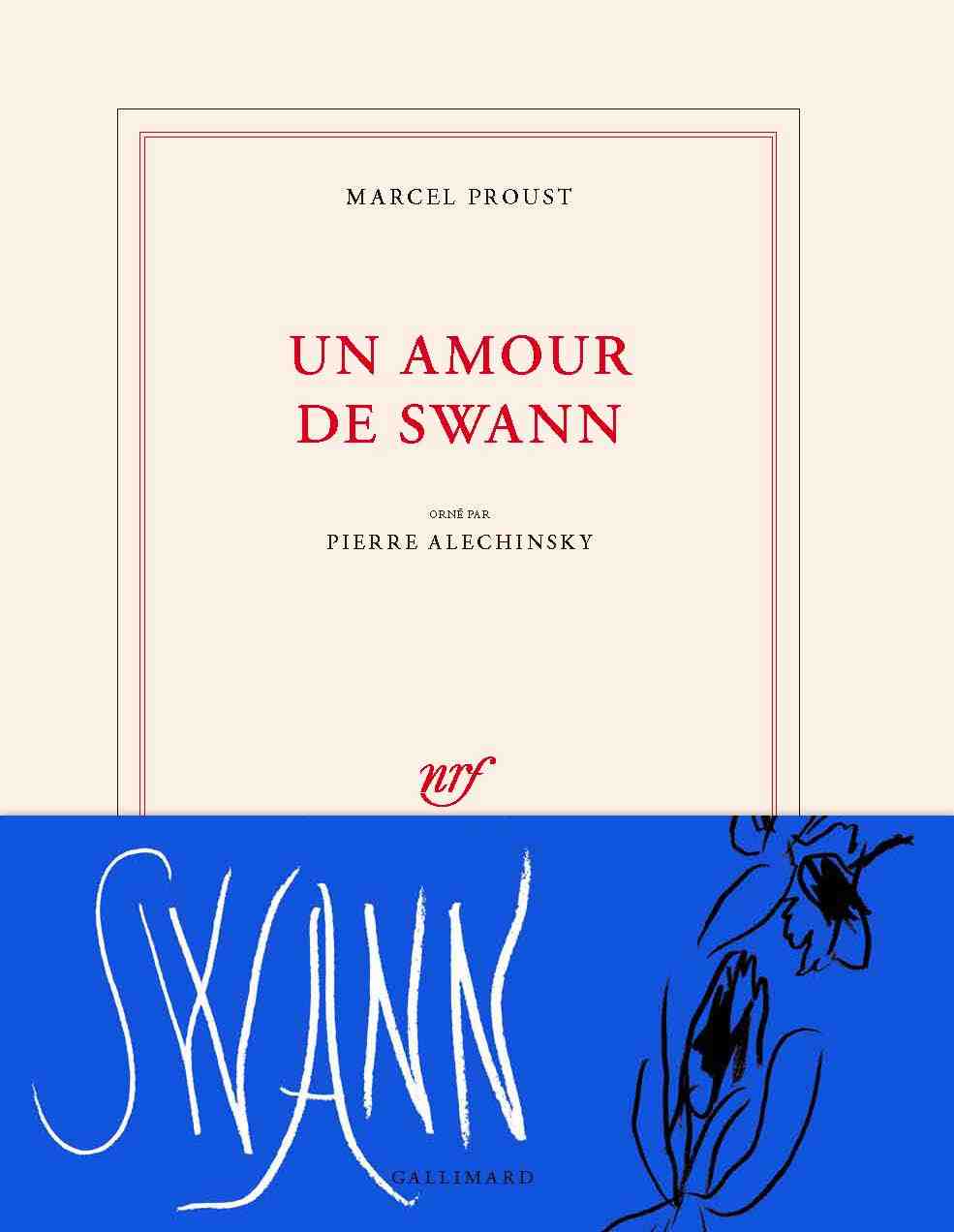 |
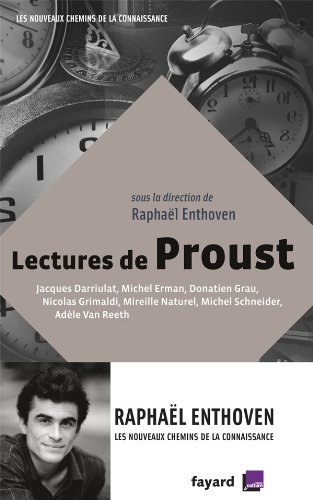 |
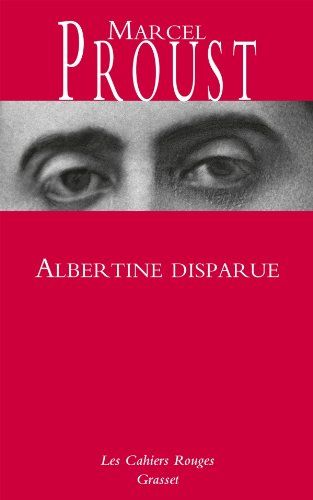 |
 |
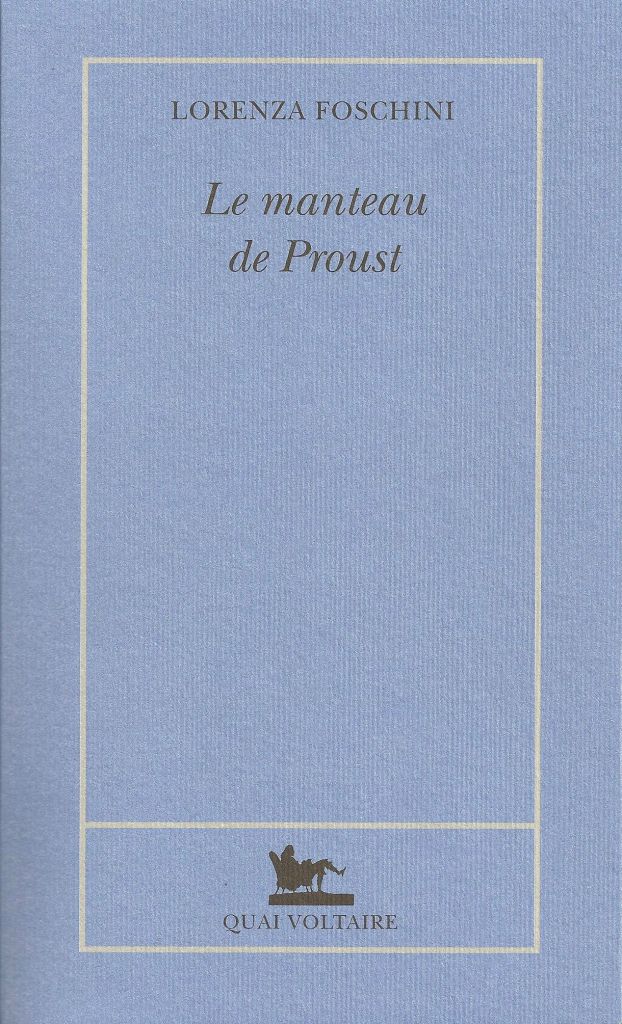 |
|
Interview Dominique Fernandez
15 janvier 2013 - Paris

© DR |
|
C'est à l'école des lettres classiques que l'académicien Dominique
Fernandez a puisé dès son enfance un goût immodéré pour la lecture et
l'écriture - pour ne plus jamais s'en éloigner - si ce n'est pour des
mondes voisins, ceux de la peinture, de la musique ou des voyages qu'il
chérit tant. Cet immortel parle pourtant bien volontiers de tous les
sujets sans affectations et avec la plus grande générosité. Cette âme
sensible au beau est également un homme de son temps qui jette un regard
toujours aussi perçant sur l'univers qui l'entoure, pour en souligner les
avancées, mais aussi les travers, avec une poésie qu'il nous fait partager
dans ses livres et dans cet entretien.
 omment
êtes-vous venu à l’amour des lettres et des arts et quelles sont vos
premières découvertes littéraires marquantes ? » omment
êtes-vous venu à l’amour des lettres et des arts et quelles sont vos
premières découvertes littéraires marquantes ? »
Dominique Fernandez :
« Je suis né dans un milieu littéraire, mon
père était écrivain, ma mère était professeur de lettres. Dès l'âge de 11
ans, j'ai écrit mon premier roman. Je suis né dans cet environnement et
cela n'a pas été une découverte ou une conquête. Mes premiers émois
littéraires ont peut-être été avec la lecture des œuvres de Gustave Aimard,
un écrivain qui a écrit beaucoup de romans d'aventures, notamment en
Amérique. Son style n'était pas extraordinaire, mais il m'a ouvert des
horizons. Est venue très rapidement, au lycée, la lecture des oeuvres de
Stendhal, Balzac… Ainsi que les Grecs et les Latins, car j'étais
latiniste. Cela m'a permis de lire toute l'Odyssée en grec, Sophocle,
Virgile, des auteurs que je continue d’ailleurs à lire aujourd'hui. Je
dévorais littéralement ces oeuvres et j'ai même lu « Guerre et paix
» en trois jours et trois nuits ! Cela a vraiment illuminé ma jeunesse. »
« Vous avez évoqué avec sensibilité le poids et les interrogations que
faisait porter sur vous l’histoire de votre père. En quoi son exemple
a-t-il permis de vous définir dans vos émotions et vos goûts ? »
Dominique Fernandez : "J'avais
une double image du père puisqu'il était un écrivain brillantissime, au
centre de la vie littéraire entre les deux guerres ; de Proust à
Marguerite Duras, il avait couvert tout cet ambitus d'amis personnels et
en même temps il est devenu collabo pendant la guerre après avoir été
presque communiste. J'étais gaulliste en étant enfant et je réprouvai sa
conduite politique. J'étais alors trop jeune pour reconnaître sa valeur
littéraire puisqu'il est mort lorsque j'avais 15 ans et qu'il vivait
séparé de ma mère. Je savais qu'il était un écrivain célèbre et admiré
publiquement par des personnalités comme Gide ou Mauriac. J'avais donc
cette double image d'avoir un père glorieux et à la fois une image marquée
par l’infamie, ce qui était très difficile pour un enfant. Mais, en même
temps, cela a été très important pour moi par la suite."
« Vous a-t-il encouragé pour vos lectures
? »
Dominique Fernandez : "Non,
car je l'ai très peu connu, mes parents se sont séparés alors que je
n'avais que cinq ans et lorsque la guerre a éclaté, je n'avais que dix
ans. J'avais le droit d'aller le voir le dimanche et on sentait qu'il
était très préoccupé par ses choix. Il y avait là des personnalités comme
Drieu La Rochelle, Céline et même Marguerite Duras qui penchait plutôt de
ce côté avant qu’elle n’entre dans la Résistance. Je dois essentiellement
mon goût pour la littérature à d'excellents professeurs au lycée. Nous
baignions littéralement dans l'univers de Racine, Corneille et des
classiques qui m'ont beaucoup marqué. Je me souviens encore très bien de
ces réunions informelles en dehors du lycée que nous tenions avec des
camarades et où nous évoquions des auteurs contemporains comme Proust,
Valéry, Gide et nous nous faisions des petites colles pour tester nos
connaissances. Nous n'avions pas beaucoup d'autres distractions à cette
époque et la lecture était au coeur de nos activités."
___________________
Mes trois
auteurs préférés sont Homère, Tolstoï et Stendhal. Ils m’ont à la fois
fasciné et façonné en même temps."
___________________
« Vous portez un amour immodéré pour la
littérature et dans ce domaine des arts, des noms reviennent parmi de
nombreuses autres références, Tolstoï notamment, que vous n’hésitez pas à
ranger parmi les plus grands»
Dominique Fernandez : "Il
est vrai qu'à l'âge de quinze ans, si vous aimez un texte, il vous marque
à vie ! Avoir lu sa grande œuvre en trois jours et trois nuits, cela
montre combien il a pu me fasciner. Cela m'a vraiment ébloui, cette
narration correspondait à mon idéal même si c'était un texte qui n'avait
pas a priori la force poignante d'œuvres comme celles de
Dostoïevski. Je ne connaissais pourtant rien de Tolstoï et j'ai abordé
cette œuvre l'esprit totalement libre. Je porte le même regard aujourd'hui
sur Tolstoï qu’à l’époque de mes jeunes années. Cela n'a pas changé. Mes
trois auteurs préférés sont Homère, Tolstoï et Stendhal. Ils m’ont à la
fois fasciné et façonné en même temps."
« Stendhal auquel vous venez de consacrer un Dictionnaire amoureux
figure également parmi vos auteurs préférés. Le mot liberté revient
souvent lorsque vous évoquez l’auteur de Le Rouge et le Noir, et de
La Chartreuse de Parme »
Dominique Fernandez :
"Je pense que c’est
en effet l’écrivain le plus libre qui ait jamais existé. J'ai lu Le
Rouge et le Noir quand j'avais 15 ans et c'est très certainement
l'histoire qui m'avait enthousiasmé à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le
recul, c'est cet esprit totalement indépendant qui retient mon attention,
un esprit qui n’est soumis ni aux modes ni à ce que pensent les autres. Il
est pour ainsi dire un écrivain atemporel et on ne sait pas s’il est
classique ou romantique, un grand débat à l'époque, et qui n'a guère
d’intérêt aujourd’hui à mes yeux. Je dirais que Stendhal représente
parfaitement l'indépendance plus encore que la liberté qui a parfois des
connotations politiques. Il décide d'écrire ou non, de voyager ou de
rester, il n'a pas de chaînes ou de liens."
« Stendhal est donc un écrivain indépendant, vous soulignez d’ailleurs
qu’il écrit comme il s’exprime, à la différence de Flaubert par exemple.
Est-ce cela qui vous a séduit ? »
Dominique Fernandez : "Oui,
tout à fait c'est ce qui est le plus important pour moi. Flaubert par
exemple porte une attention extrême à son écriture et cela en devient
laborieux. Stendhal ne prend jamais la posture d'un écrivain. Il n'hésite
d'ailleurs pas à faire remarquer que les chefs-d’œuvre universels ont été
écrits sans faire attention au style. Si vous faites justement attention
au style de Stendhal, vous pouvez remarquer qu'il écrit parfois assez mal
selon les critères classiques : il lui arrive de répéter parfois quatre
fois la même épithète dans une même page ! Il ne se prenait pas pour un
écrivain, mais il écrivait pour son goût. Nous n'avons pas d'autres
exemples dans la littérature et la moitié de son oeuvre est posthume,
seuls trois romans ont été publiés de son vivant. Il n'y avait pas de
calcul chez lui pour une carrière littéraire alors qu'il était consul avec
une carrière diplomatique peu brillante."
« Cette liberté l’autorise à composer un récit où la féerie côtoie la
réalité sans ruptures. Vous présentez Stendhal comme l’écrivain de
l’immédiateté, captant le fugace et sans recomposition – un véritable défi
pour un écrivain !»
Dominique Fernandez : "Stendhal
écrivait très vite si vous pensez que La Chartreuse a été rédigée en 52
jours ! C'est vraiment écrit dans l'instant sous l’impression de l'émotion
reçue. Je n'ai malheureusement pas hérité de cette qualité, car j'ai
tendance à être trop perfectionniste… Je trouve que nous sommes entourés
aujourd'hui par trop d'auteurs médiocres qui prennent la posture
d'écrivains et qui font la leçon partout. C'est ce que j'apprécie beaucoup
chez Stendhal, ce refus de composer un rôle." |
Le dernier livre de Dominique
Fernandez
...
Dictionnaire amoureux de Stendhal,
Plon, 2013.
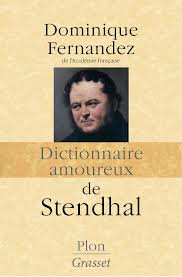 Pourquoi
Stendhal a-t-il abandonné Lucien Leuwen alors qu’il restait si peu à
faire pour l’amener à sa forme définitive ? Pourquoi, chez cet auteur,
le travail de la mémoire prend-il le pas sur l’imagination ? Pourquoi
écrit-il La Chartreuse de Parme en cinquante-deux jours alors qu’il
laisse inachevé Lamiel après deux ans et demi d’ébauche ? Pourquoi Le
Rouge et le Noir n’eut-il aucun succès ? Pourquoi l’art de séduire lui
fut-il étranger ? Autant d’interrogations, autant d’analyses auxquelles
Dominique Fernandez, en fervent stendhalien, en observateur subtil,
répond avec clairvoyance et délicatesse. Pourquoi
Stendhal a-t-il abandonné Lucien Leuwen alors qu’il restait si peu à
faire pour l’amener à sa forme définitive ? Pourquoi, chez cet auteur,
le travail de la mémoire prend-il le pas sur l’imagination ? Pourquoi
écrit-il La Chartreuse de Parme en cinquante-deux jours alors qu’il
laisse inachevé Lamiel après deux ans et demi d’ébauche ? Pourquoi Le
Rouge et le Noir n’eut-il aucun succès ? Pourquoi l’art de séduire lui
fut-il étranger ? Autant d’interrogations, autant d’analyses auxquelles
Dominique Fernandez, en fervent stendhalien, en observateur subtil,
répond avec clairvoyance et délicatesse.
_________________________
« Stendhal jouit de cette même liberté
également dans ses rapports et ses jugements quant à la musique et à la
peinture, des jugements parfois péremptoires et surprenants (si l’on pense
à son traitement du Caravage ou des musiciens allemands). »
Dominique Fernandez : "Nous
retrouvons ici la même ligne que nous évoquions tout à l'heure. Cette idée
d'une subjectivité assumée qui lui permet librement d'estimer que la
musique allemande était une horreur parce qu'elle faisait trop de bruit !
Il aimait la voix italienne, Rossini surtout, et il se fichait pas mal de
ce que les autres pouvaient penser quant à ses goûts. C'est un plaisir
immédiat qui le retient et tant pis si cela le conduit à rejeter des
créations originales. De nos jours, il y a une véritable obsession de ne
pas manquer l'événement, même si ce dernier est plus que contestable.
C'est la même chose en peinture, il aimait beaucoup Guido Reni ou Le
Corrège pour des critères qui pourraient paraître surprenants aujourd'hui.
Telle peinture de Guido Reni avait sa préférence parce qu'elle lui
rappelait une femme qu'il avait aimée ! Il est malheureusement passé à
côté des qualités du Caravage, mais il n'était pas le seul à son époque.
C'est quelque chose à laquelle j'ai d’ailleurs réfléchi puisque, vous le
savez, j'aime beaucoup Caravage. Je me suis demandé si cette ignorance
n'était pas due au fait que les chapelles dans lesquelles étaient
accrochées les oeuvres de Caravage étaient à l’époque souvent dans la
pénombre ; imaginez aujourd'hui ces deux tableaux de l'église de
Saint-Louis des Français à Rome sans électricité qui les éclaire ! Je me
répète, mais on peut affirmer sans hésitation que la règle de Stendhal est
son plaisir, ce qui l’émeut, ce qu'il éprouve. C'est cela qui rend ses
textes si précieux aujourd'hui, car vous entendez littéralement l'homme
qui parle, et d'ailleurs plus un homme ou une femme parlent de leur
singularité, plus ils deviennent universels."
___________________
Stendhal aime
l'art italien, cette atmosphère bien particulière dans laquelle je me
reconnais complètement.
___________________
« La vie de Stendhal est indissociable de
l’Italie qu’il a tant aimée. Quel regard l’amoureux de l’Italie que vous
êtes porte-t-il sur la propre perception de Stendhal ? »
Dominique Fernandez : "Stendhal
a découvert l'Italie à 17 ans, il détestait Grenoble et la France et il a
adoré immédiatement l'Italie. Cela l'a conduit à adopter une théorie pour
le moins contestable selon laquelle la France était le pays des vanités et
l'Italie celui des passions. Malgré ces jugements un peu rapides, il y a
beaucoup de traits qui restent d'une justesse étonnante : il trouve que
Rome est une ville ennuyeuse, que Naples est beaucoup plus joyeuse, que
les Florentins sont insupportables par ce qu'ils disent qu'ils descendent
de Dante alors qu'ils sont plus ou moins illettrés… Il aime l'art italien,
cette atmosphère bien particulière dans laquelle je me reconnais
complètement. Il aimait beaucoup Milan notamment parce qu'il allait à
l'opéra à la Scala avec ces loges où il bavardait avec les comtesses.
L'amour et la musique étaient étroitement liés chez Stendhal. Il a été
heureux en ces lieux, et la force de ce bonheur lui faisait reconnaître
qu'il était devenu connaisseur. C'est d'ailleurs une clé chez cet auteur
que celle du bonheur qui permet de comprendre."
« Le beau idéal est une quête
éternelle de Stendhal tout au long de sa vie, quelle être votre analyse de
cette poursuite, et comment percevez ce beau idéal de nos jours ? »
Dominique Fernandez :
"Ce beau idéal
est une notion très relative comme le souligne lui-même Stendhal qui
change selon les époques et les mœurs. Il cite l'exemple du culte de la
force qui était nécessaire dans l'Antiquité et qui est devenue grotesque
au temps des pistolets. Vous retrouvez les mêmes évolutions dans la
sculpture entre la statuaire massive d'un Hercule de l'Antiquité et la
finesse d'un Canova. C'est une notion qui, je crois, est étrangère à notre
époque, il me semble que chacun aujourd'hui a son idée du beau. On peut
même se demander parfois dans l'art contemporain si on ne peut pas évoquer
le laid idéal ! (rires) La notion de beau aujourd'hui est suspectée
d'élitisme."
___________________
On sent le
renouveau de la Russie dans les rues de Moscou qui dépasse souvent en
modernité New York
___________________
« La musique occupe également une grande place
dans votre vie »
Dominique Fernandez : "Oui,
absolument et si j’évoquais avec vous ce bain littéraire dans lequel je
suis né, il n’y avait pas, en revanche, de musique dans mon enfance. C'est
à 15 ans que je me suis inscrit aux jeunesses musicales, une expérience
inoubliable. Vous arriviez avec votre petit billet pour boucher les places
inoccupées et vous vous trouviez au premier rang d'orchestre. Je me
souviens de ces concerts à la salle Gaveau, Pleyel ou aux Champs-Élysées.
La première grande émotion a été La Symphonie inachevée de Schubert
que je ne connaissais pas. Cela m'a littéralement bouleversé. Et de fil en
aiguille, je suis même devenu critique musical… C’est un peu pour ces
raisons que la Russie est devenue ma troisième patrie, un pays où la
culture a une place qui n’a rien à voir avec ce que nous connaissons ici.
Pour la musique, vous pouvez aller à un opéra différent tous les soirs,
que vous soyez à Moscou ou à Saint-Pétersbourg ! Vous avez 80 théâtres à
Moscou avec une qualité inouïe. C'est un peu cette générosité qui me
faisait apprécier l'Italie sur le plan culturel à une époque, ce qui n'est
plus le cas aujourd'hui ou toute création a été bloquée. Alors qu'en
Russie vous avez véritablement une force de création et une culture
vivante remarquable. On sent le renouveau de la Russie dans les rues de
Moscou qui dépasse souvent en modernité New York, le centre de la ville
est même devenu parfois oppressant du fait de l’omniprésence de l’argent
et une certaine ostentation. Mais, tout le reste de la Russie est resté
inchangée comme au XIX° siècle, avec une générosité et une hospitalité de
ses habitants impressionnantes."
« Quels sont vos projets pour les prochains mois ? »
Dominique Fernandez :
"J'ai un gros roman qui doit sortir au début de
l'année prochaine ainsi que trois albums pour cette année. Le premier
d'entre eux est consacré à l'Algérie romaine et réalisé avec le
photographe Ferrante Ferranti. Il s'agit de sites merveilleux souvent
inconnus comme Djemila, Timgad, Hippone, que j’ai pu apprécier et qui font
l’objet de très belles photographies de Ferrante Ferranti. Un livre doit
également sortir sur l'Académie française, car, curieusement, il n'y avait
aucun livre sur l'architecture et le bâtiment lui-même de cette
prestigieuse institution. Un troisième livre évoquera cette incroyable
croisière en Sibérie que j’ai eu le plaisir de faire, après l’expérience
du Transsibérien, sur le Ienisseï, ce fleuve unique de 3 km de large."
Propos recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
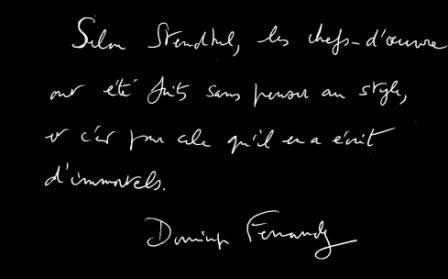 |
|
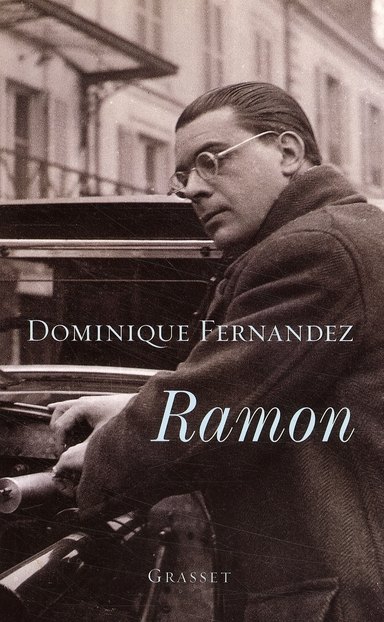 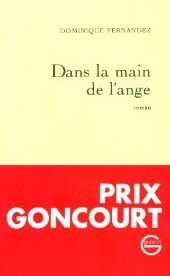 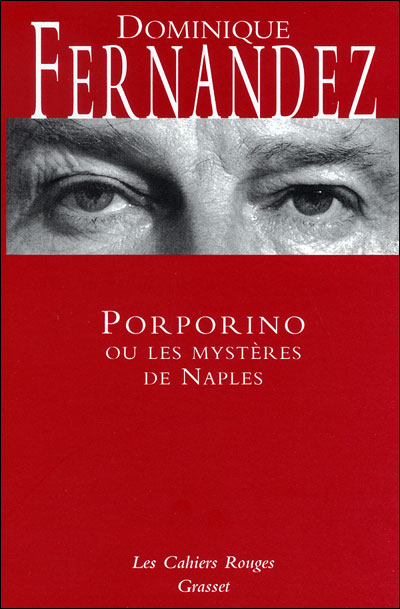 |
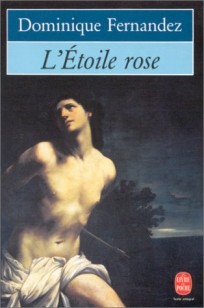 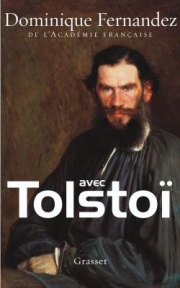  |
|
 |
Interview
Denis WESTHOFF
"SAGAN,
ma mère"
Paris, le 19 décembre 2012
|

Copyright photo ©N.WASSERMANN |
|
|
|

Denis Westhoff, SAGAN, ma mère,
Flammarion
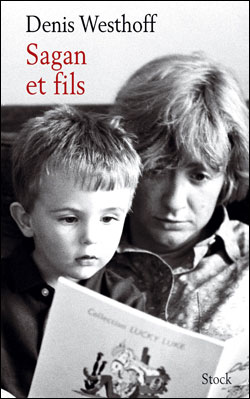
Denis Westhoff, Sagan et fils,
Stock
_________________
"Mon passe-temps
favori, c'est laisser passer le temps, avoir le temps, prendre mon temps,
perdre mon temps, vivre à contretemps. Je déteste tout ce qui réduit le
temps, c'est pourquoi j'aime la nuit. Le jour, c'est un monstre, ce sont
des rendez-vous. Le temps de nuit, c'est une mer étale. Cela n'en finit
pas. J'aime voir le lever du soleil avant d'aller dormir."
Réponse, 1974
_________________

_________________
"Qui n'a pas cru
sa vie inutile sans celle de "l'autre" et qui, en même temps, n'a pas
amarré son pied à un accélérateur à la fois sensible et trop poussif, qui
n'a pas senti son corps tout entier se mettre en garde, la main droite
allant flatter le changement de vitesse, la main gauche refermée sur le
volant et les jambes allongées, faussement décontractées mais prêtes à la
brutalité, vers le débrayage et les freins, qui n'a pas ressenti, tout en
se livrant à ces tentatives toutes de survie, le silence prestigieux et
fascinant d'une mort prochaine, ce mélange de refus et de provocation, n'a
jamais aimé la vitesse, n'a jamais aimé la vie - ou alors, peut-être, n'a
jamais aimé personne."
Avec mon meilleur
souvenir,1984
_________________
|
Le Prix Françoise SAGAN
Denis Westhoff a
créé le Prix littéraire Françoise Sagan - " Le Prix du Printemps"-
en 2009, aux fins de promouvoir et d'aider un auteur jamais encore
récompensé au cours des douze derniers mois; il est remis depuis
trois ans, chaque année, le 1er juin.
Denis Westhoff a
également créé en 2010 l'association Françoise Sagan
ayant pour objet de promouvoir
et d'aider à la promotion de l'œuvre de l'écrivain. |
_________________
" Ce qui
m'intéresse, j'insiste, ce sont les rapports des gens avec la solitude ou
avec l'amour. Et je sais que c'est la base de l'existence; la base de
l'existence de quelqu'un, ce n'est pas de savoir ce qu'est un cosmonaute
ou un trapéziste, mais qui est son mari, son amant ou sa maîtresse."
Réponse, 1974
_________________

copyright photo ©N.WASSERMANN
|
Françoise Sagan fait figure de soleil
radieux dans le paysage littéraire, soleil qui éclipse les scandales que
certains ont voulu retenir d'elle. Après le succès mondial de son roman
Bonjour Tristesse écrit à l'âge de 18 ans, elle enchaînera avec une
facilité déconcertante romans et pièces de théâtre dans un amour
immodéré de la liberté qu'elle chérissait avant toute chose. Lexnews a eu
le plaisir de rencontrer Denis Westhoff, son fils, qui nous offre
aujourd'hui avec la parution de deux ouvrages consacrés à Françoise Sagan,
deux beaux témoignages lui rendant ainsi un émouvant hommage, un hommage
d'amour d'un fils à sa mère. Avec une pudeur qui n'enlève rien à la
légende, Denis Westhoff a accepté de relever le défi : assumer l'héritage
légué par une femme éprise de la vie et le faire rayonner au-delà des
obstacles qui se présentent.
Lexnews
: « Vous consacrez, cette même année 2012, deux ouvrages à votre mère,
Françoise Sagan : Sagan et fils et Françoise Sagan, ma mère.
Or, ni l’un ni l’autre ne se veulent être une déconstruction de la légende
Françoise Sagan, ni non plus – à l’inverse - de purs règlements de comptes
; il s’agit plus d’un au-delà de la légende, du regard d’un fils pour sa
mère et avant tout d’un hommage d’amour… »
Denis
Westhoff : « Oui, même si
peut-être certains attendaient d’autres livres… En tout cas, les premiers
éditeurs qui m’avaient initialement commandé un livre attendaient, c’est
certain, totalement autre chose. Après le décès de ma mère, j’ai été
contacté par un éditeur parisien, il y a plus de deux ans, trois ans même
maintenant, qui comptait sur ma plume pour faire un livre à scandale dans
lequel j’aurais raconté toutes les sottises habituelles sur ma mère, tout
ce qui a été déjà longuement étalé dans la presse et dans la presse people
notamment – ses problèmes financiers, ses problèmes de drogue, d’alcool,
etc. J’ai toujours été opposé à cette idée de faire un tel livre et j’ai
donc dû refuser énergiquement une fois, deux fois, dix fois… cet éditeur
était tellement insistant avec moi, que j’ai fini, à la quinzième
tentative, par demander à Jean-Marc Roberts qui dirige les Éditions Stock
à qui j’avais déjà confié la plupart des titres que j’avais récupérés
suite à mes batailles juridiques avec certains éditeurs et créanciers,
comment se défaire d’un éditeur aussi collant. Jean-Marc m’a tout de suite
proposé de publier cet ouvrage chez lui. Après que nous ayons signé le
contrat, et bien qu’il me laissât toute liberté, j’ai bien vite senti que
je devais me mettre au travail.
_________________
"Fortuitement,
ces biographies m’ont permis de m'exprimer, même si je n’ai pas voulu
faire un livre amer, mais bien et seulement un témoignage d’amour à
l’égard de ma mère, Françoise Sagan. C’est ce qu’elle m’a légué de plus
cher…"
___________
Ce ne fut pas facile, mais une fois lancé, l’écriture est venue seule,
finalement très facilement ; j’ai eu le sentiment que j’écoulais ma
mémoire sur le papier. J’espère que ce plaisir, cette facilité en fin de
compte avec lesquels j’ai écrit ce livre se transmettent au lecteur. J’ai
raconté mes souvenirs avec ma mère, tels qu’ils apparaissaient dans ma
mémoire. J’ai raconté tout ce qui m’apparaissait intéressant, tout ce qui
m’avait touché, ce qui était important et puis aussi tout ce que ma mère
m’avait également elle-même raconté. Elle ne m’a, certes, pas tout dit,
mais il y a des choses qu’elle m’a justement racontées parce qu’elle les
trouvait, elle, suffisamment importantes, ou suffisamment drôles ou
originales pour le faire. J’ai donc écrit tout cela en le respectant avec
en quelque sorte une double protection : son filtre à elle, et en second,
le mien. J’ai tenu à remettre d’aplomb certaines vérités qui avaient été
déformées par des biographes, des journalistes qui ont souvent écrit des
choses stupides ou inexactes sur ma mère. Je pense notamment à une
certaine biographe et à cette histoire de trous de cigarette dans les
pulls de ma mère : cette affirmation mensongère m’a subitement
profondément énervé et exaspéré. J’ai trouvé que de parler de cette
manière d’un écrivain comme Sagan était proprement grotesque et méchant.
Fortuitement, ces biographies m’ont permis de m'exprimer, même si je n’ai
pas voulu faire un livre amer, mais bien et seulement un témoignage
d’amour à l’égard de ma mère, Françoise Sagan. C’est ce qu’elle m’a légué
de plus cher… »
Lexnews
:
« Après la disparition de votre mère, vous
mettez plus de deux ans à accepter la succession à hauteur de plus 1
million d’euros de passif. Cependant, devant vos témoignages, il est
évident que Françoise Sagan, votre mère, ne vous a pas légué que ce lourd
passif, mais vous a surtout légué une passion de vie, de cœur… De toutes
ses passions, lesquelles avez-vous partagées avec elle, lesquelles
avez-vous héritées ? »
D.W.:
« La liberté, bien sûr. C’était une femme passionnément éprise de liberté.
C’était pour elle une vraie nécessité. Il n’était pas question pour ma
mère de vivre contrainte ou enfermée, de vivre obligée ou dirigée ;
c’était vital, voire même plus que vital, et il n’y avait pas, pour elle,
d’autre choix de vie possible que de faire que ce qu’elle voulait sans
pour autant ne faire que des bêtises. On a dit d’elle qu’elle faisait
cinquante bêtises à l’heure, ce n’était pas toujours vrai. Il fallait
seulement qu’elle puisse voir ses amis lorsqu’elle le souhaitait,
travailler lorsqu’elle en avait envie, partir à la campagne si elle le
désirait ; elle avait ce besoin de liberté, qu’elle a toujours eu
d’ailleurs depuis l’enfance la plus tendre. Elle a toujours eu une grande
indépendance, ses parents l’ont toujours laissée faire tout, tout ce
qu’elle voulait. Ce n’était pas une liberté de rébellion, mais bien une
liberté innée, et puis acquise ou plutôt sauvegardée, que ses parents lui
ont transmise. Ses parents étaient des personnes très libres, ils étaient
ouverts, pleins d’humour et plutôt originaux. Sa mère était une femme
cocasse, son père était un homme original, parfois autoritaire, mais qui a
toujours fait ce qu’il a voulu. Et donc, elle a hérité de tout cela. Et du
fait d’avoir été une enfant inespérée et aussi gâtée par des parents si
libres, elle a toujours eu cette liberté, ce goût de liberté. Cette
liberté, elle la vivait de façon aussi intense parce qu’elle était douée
d’une grande intelligence. Et, je ne vois pas comment les choses pouvaient
en être autrement pour elle. Si elle avait grandi dans une famille avec un
père autoritaire et une mère qui l’aurait enfermée dans sa chambre, elle
aurait été extrêmement malheureuse, elle serait partie, elle aurait foutu
le camp. Ce goût de la liberté, elle me l’a, je crois, transmis. J’ai vécu
cette liberté au quotidien, mais sans nécessairement le savoir, parce que
pour moi tout cela était normal. Avec cependant de sa part à elle un très
grand souci de me donner certaines règles de vie ; elle estimait qu’un
petit garçon devait avoir des repères indispensables, qu’il devait se
conformer à certaines règles morales. Au fond, elle m’a transmis son
éducation assez bourgeoise… Elle tenait à ce que mes repas soient pris à
heures fixes, que j'aille au lit à telle heure, que j’aille à l’école
habillé correctement, j’avais ma chambre, mes repères, mon lit, mes
jouets, mes copains… j’étais un petit garçon normal avec une vie normale.
Elle considérait que certains repères pour un enfant lui permettaient
d'acquérir un équilibre, d’être plus fort. Je pense maintenant qu’elle
n’avait pas tort.... Elle est née Françoise Sagan, elle est née douée ;
elle avait cette rapidité d’esprit incroyable et cette lucidité, cette
bienveillance… »
_________________________
"Elle ne m’a
jamais parlé de cela – c’est cette amie qui me l’a confié - mais elle
savait que l’ange l’avait quittée."
___________________
Lexnews
: « Le jeu, les voitures, la vitesse…étaient pour elle moins des moyens
d’une vie flambée, brulée qu’un goût du bonheur, un goût de la vie…Goût
également partagé par votre père… »
D.W.
: « Oui, bien sûr, elle m’a aussi
transmis cet amour de la vie. Nous roulions parfois à plus de 200-240 km/h
dans sa Maserati, mais sa conduite était rassurante : souple, précise et
attentive. Elle ne prenait jamais — en tout cas avec moi — de risques
inconsidérés. Elle surfait sur cette crête entre ce qui était rassurant et
ce qui pouvait être fatal, tout en détestant l’un et l’autre. J’ai aussi
le souvenir de routes presque vides dépourvues de radars… Il n’y avait pas
de sa part une recherche de fuite ou de destruction, jamais de risque
inutile –mis à part ses problèmes de drogue qui concernent un autre aspect
de sa vie. Au jeu, elle s’arrêtait toujours lorsqu’elle sentait que la
chance la quittait, qu’une partie pouvait s’avérer fatale, en tout cas
fatale pour sa liberté. Tout au long de sa vie, elle a gardé ce rapport si
fort et particulier avec la chance qui refusait de la quitter. Cette
chance qui lui donné ce talent pour l’écriture, cette chance qui lui a
permis de connaître un succès mondial à 18 ans, cette chance qui lui a
fait échapper à la mort lorsque son Aston Martin s’est retournée sur
elle... Cette chance qui faisait qu’elle trouvait toujours une place pour
se garer devant chez elle en voiture ! Paradoxalement, elle se sentait à
la fois privilégiée, sentiment qu’elle réprouvait, et pas tout à fait
mécontente non plus de cette chance. Ce besoin d’aller au casino devait
correspondre, je crois, à un besoin de remettre les pendules à l’heure, de
s’assurer que la chance ne l’avait pas quittée et qu’elle pouvait encore
se mettre en danger. Là encore, elle surfait sur cette crête... C’est pour
ces mêmes raisons que ma mère n’aimait pas ce qui était trop stable, trop
défini, figé ou tracé. Elle aimait que les choses changent tout le temps,
qu’il n’y ait pas de fixité. Et, je pense que cette chance parfois devait
l’angoisser. Le jour où elle a commencé à avoir tous ses ennuis – morts de
ses proches et amis, problèmes de santé, financiers, juridiques…, tous les
ennuis de la terre, dans les années 90, elle a vu sa chance tourner. Elle
considérait vraiment que celle-ci avait tourné. Elle avait, d’ailleurs, à
cette époque expressément dit à une de ses meilleures amies avec qui elle dinait, une amie avec laquelle elle partageait tout, pour qui elle avait
une très grande amitié, que sa chance l’avait quittée. Elle le dit comme
une certitude, alors même que ma mère était d’une pudeur extrême. Elle ne
m’a jamais parlé de cela – c’est cette amie qui me l’a confié - mais elle
savait que l’ange l’avait quittée.
Lexnews : «
Françoise Sagan avait un goût immodéré, une véritable passion pour la
littérature, la poésie, vous a-t-elle influencé, guidé dans vos goûts
littéraires ? »
D.W.
: « Ma mère avait le goût de la
littérature depuis son plus jeune âge, depuis qu’elle avait cinq ans, et
elle m’a, bien sûr, beaucoup encouragé à lire dès que j’en ai eu l’âge.
|
Elle m’a guidé dans mes choix littéraires, et je ne me suis pas gêné pour
lui demander des conseils. J’allais la voir, il y avait des livres partout
dans la maison, et parfois j’étais un peu perdu, et je lui demandais ce
que je pouvais lire. Nous avions ensemble des conversations fréquentes et
nos discussions passaient toujours d’une manière ou d’une autre par la
littérature ; elle me disait : « Tiens, j’ai lu tel livre, c’est un livre
épatant, je te le conseille… » J’étais donc un peu sur ses traces. J’avais
souvent des livres du programme scolaire qui me tombaient des mains, des
auteurs qui me semblaient illisibles. La plupart du temps, elle me
rassurait sur ce qui était bon et ce qui l’était moins. De ce point de
vue, elle m’a énormément rassuré et encouragé à lire de « bons livres »,
ce qui était facilité par le fait que nous avions souvent des goûts
similaires en littérature.
Lexnews
: « Je suppose que vous avez, bien sûr, lu les ouvrages de votre mère,
Françoise Sagan… »
D.W.
: « Oui, à des époques différentes.
J’en ai également beaucoup relu depuis quelques années puisque je m’occupe
maintenant des droits. Je suis donc amené régulièrement à donner mon
accord, à autoriser certaines exploitations, cinématographiques ou
théâtrales, des œuvres de ma mère. Cela suppose donc que je relise
régulièrement certaines œuvres, que je me replonge dans certains livres
parce que parfois les gens ont des idées d’adaptations un peu biscornues.
Mais je relis aussi également ses livres par plaisir. D’une certaine
manière et à l’image de Proust, on redécouvre parfois certains passages,
et on s’aperçoit alors parfois que certaines choses vous avaient échappé…
»
Lexnews : «Y
a-t-il un ou plusieurs titres de Françoise Sagan que vous préférez plus
particulièrement ? »
D.W.
: « J’aime beaucoup Des bleus à l’âme,
Un peu de soleil dans l’eau froide… ou encore Un certain sourire.
Mais, je tangue pas mal. Bizarrement, mes goûts changent. Concernant la
fin de son œuvre, j’aime beaucoup son détachement, ce regard sur elle-même
dans Derrière l’épaule. C’est un texte, à l’image de Des bleus à
l’âme ou de Avec mon meilleur souvenir où je la retrouve, je la
reconnais, je la sens à chaque page. C’est beaucoup plus fragrant que dans
les romans où le filtre de la fiction installe plus de distance.
_______________________
" En fait,
leur divorce n’a été ni une séparation de corps ni une séparation de cœur,
ils sont restés amants bien longtemps après leur séparation."
____________
Lexnews
: « Cet hommage à votre mère, à Françoise Sagan, ces deux ouvrages, ce
sont aussi un hommage à votre père, à l’admiration que vous lui portez
également… vos parents ne se sont en fait jamais séparés de cœur…
D.W. : «Oui, je lui ai consacré
un grand chapitre, il y avait aussi beaucoup de choses à écrire sur mon
père… En fait, leur divorce n’a été ni une séparation de corps ni une
séparation de cœur, ils sont restés amants bien longtemps après leur
séparation. D’ailleurs, ils sont enterrés ensemble, côte à côte, dans le
petit cimetière de Seuzac. Et je suis moi-même étonné de ces gens qui se
disent surpris de savoir qu’ils reposent ensemble. Je pense qu’ils se sont
toujours aimés et toujours ressemblé quels que fussent leurs différences.
Mon père a toujours eu une passion pour ma mère et ma mère réciproquement
pour mon père. Il m’a paru important d’écrire aussi sur l’homme qui
m’avait élevé. Mon père était un personnage assez original. C’est en
écrivant ce livre que je me suis aperçu à quel point ma mère et mon père
se ressemblaient. Finalement, ils avaient beaucoup de points communs : le
même goût de la vie, la même passion pour la liberté, et le même refus de
l’autorité. Ils avaient aussi la même passion pour les arts : mon père
pour la musique, ma mère pour la littérature et pour la peinture.
Lexnews
: « Vous acceptez donc la succession en 2007, vous négociez alors avec
l’administration fiscale, puis vous renégociez les contrats d’édition,
vous créez le prix littéraire Françoise Sagan en 2009, en 2010
l’association Françoise Sagan… Pour vous, il était intimement impensable
de renoncer à cette succession ? Et, le plus dur vous semble-t-il être
aujourd’hui accompli ? »
D.W.
: «Oui, en 2007, j’accepte la succession de guerre lasse alors que rien
n’est vraiment avancé, négocié. C’était un coup de poker, mais il fallait
que je saute le pas à un moment donné. Je n’ai jamais envisagé de
renoncer. Pas une seconde. C’était, là, dans mon esprit dès la fin, dès
que j’ai vu ma mère, dans cet état de solitude, d’abandon et de douleur…La
voir seule, abandonnée dans son lit à Honfleur avec tout cet acharnement
des créanciers autour d’elle. Tout cela m’a paru révoltant, infect après
tout ce qu’elle avait fait au cours de sa vie. Il m’a paru évident de
reprendre sa succession, de m’occuper de ce qu’elle avait laissé, de ne
pas la laisser disparaître totalement. Cela a été compliqué, mais je crois
qu’aujourd’hui le plus difficile a été accompli. J’ai vraiment bataillé
avec tout le monde, l’administration fiscale au premier chef. Au début, je
n’obtenais que des refus et puis les choses ont changé, surtout après
l’arrivée de Monsieur Sarkozy à l’Élysée. Je crois que j’ai eu beaucoup de
chance, mais j’ai aussi tellement voulu débloquer cette situation que les
choses ont fini par arriver. Aujourd’hui, je pense avoir fait les deux
tiers du chemin.
___________________
"Je me bats
aujourd’hui pour que ma mère, Françoise Sagan, soit de nouveau reconnue,
qu’elle retrouve sa place. Et donc, ce n’est pas tout à fait fini…"
___________________
Lexnews
: «Parallèlement, vous avez également bataillé sur le plan éditorial. Vous
avez renégocié les contrats d’édition de votre mère, notamment après vous
être aperçu que certains n’étaient pas honorés, que nombre de ses livres
n’étaient plus réédités. Et, comment est perçue, aujourd’hui, en ce début
de XXIe siècle, selon vous, l’œuvre de Françoise Sagan ?
D.W.
: «Je me suis effectivement aperçu qu’il
n’y avait qu’un livre sur dix qui était encore édité. Ses romans ne se
trouvaient plus — ou presque — en librairie. Sur le plan éditorial,
c’était un désert et surtout une pagaille absolue. A l’exception de
Bonjour Tristesse et de deux ou trois autres romans, les Éditions
Julliard n’éditaient plus ses œuvres. Après avoir demandé des explications
sur cette absence d’éditions, on me répondit « Qu’à l’exception de
Bonjour Tristesse qui reste une œuvre culte, les romans publiés dans
les années 50, 60 ,70 ont connu le destin habituel des œuvres de fiction.
Au fil du temps, l’intérêt des lecteurs s’émousse et les ventes se
tarissent. » Qu’à cela ne tienne, leur dis-je, rendez-moi donc les droits
puisque vous ne les exploitez plus. Je m’étais engagé à rééditer les
œuvres de ma mère, il fallait que je rembourse la dette importante qu’elle
avait laissée. C’est aussi à cette époque que j’ai rencontré Jean-Marc
Roberts des éditions Stock à qui j’avais confié, entre-temps, les livres
qui avaient été publiés chez Flammarion et Toxique, le journal de
sa cure de désintoxication qui fut publié de manière confidentielle au
début des années 60. La réédition de ce texte de ma mère a suscité un réel
engouement du public, les autres rééditions connurent aussi un très bon
accueil. Personne n’avait oublié Sagan, elle demeurait un écrivain
apprécié non seulement par les lecteurs de sa génération, mais aussi par
une tranche de gens plus jeunes que - j’imagine - Sagan devait
intriguer... Bref, ce succès chez Stock m’a encouragé à poursuivre cette
tâche que je m’étais fixé et à demander à Julliard de me restituer ces
droits qu’il n’exploitait plus. Il a refusé, le ton est monté et nous
sommes, aujourd’hui encore, en procès. Sincèrement, je ne m’attendais pas
à devoir affronter l’éditeur traditionnel de ma mère un jour. J’ai
retrouvé récemment un article paru dans Paris Match quelques mois avant sa
mort où elle soupçonne son éditeur de la « piller ». Toutes ces histoires
sont « assommantes » si je devais employer l’un des mots qu’elle utilisait
souvent. Ces tracas m’ont tellement ennuyé, je souhaitais tant que Sagan
soit autre chose que des audiences dans des palais de justice, des
expertises comptables, que j’ai créé un Prix Françoise Sagan en 2009 pour
promouvoir et aider un auteur de talent à se faire connaître hors des
grands prix littéraires. Le prix est remis chaque année au mois de juin.
Juin c’est le printemps et j’ai nommé ce prix « le prix du printemps ». Et
le 21 juin c’est le jour de sa naissance « Le 21 juin c’est ce jour
faste pour la France qui vit naître, à quelques lustres d’intervalle
Jean-Paul Sartre,
moi, et plus récemment Platini… » Je me bats
aujourd’hui pour que ma mère, Françoise Sagan, soit de nouveau reconnue,
qu’elle retrouve sa place. Et donc, ce n’est pas tout à fait fini… »
Propos recueillis par L.B.K.
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
Interview Eugène Green
Paris, 20
septembre 2011

©Catherine
Hélie – Gallimard |
Eugène Green est un magicien, un
magicien qui a la surprenante habitude d'échapper à toute appréhension
et de faire disparaître toute tentative de classement, de
catégories... Il serait possible de présenter cette personnalité
attachante comme un homme de
théâtre, mais immédiatement, l'écriture à laquelle il s'est adonné avec
gourmandise efface les planches et met en avant la feuille noircie
d'une écriture aussi envoutante que profonde. Eugène Green pourrait-il
être un de ces fantômes si présents dans ses créations ? Ils auraient alors fort à faire avec ce
trublion du paysage culturel français et international. Eugène Green
impressionne tous les supports et la pellicule du cinéma parvient très
bien à rendre cette communauté universelle à laquelle il nous
invite. Découvrons un esprit libre au XXI° siècle !
___________________
|
Vous êtes connu pour avoir le
premier réhabilité le théâtre baroque, à l’image de ce qui s’est
fait pour la musique ou la danse. D’où vous vient cet attrait pour
cette parole baroque, étant originaire des Etats-Unis, pays pour
lequel vous n’avez pas hésité à dire qu’il n’avait pas de langue ?
» |
|
Eugène Green : « Dès mon plus jeune âge,
alors que j'étais encore enfant, j'habitais en Barbarie (NDLR :
nom généralement donné par Eugène Green aux Etats-Unis) et je
lisais alors du Shakespeare et ses contemporains. J’aimais
beaucoup ce théâtre, mais je ne reconnaissais pas du tout ce que
j'avais lu dans ce que je voyais et entendais. Il y avait un réel
décalage entre le texte et ce qui était énoncé, un décalage qui
n'a fait que s'accentuer avec le temps dans les années soixante.
Une fois arrivé en France, j'ai réellement découvert le théâtre de
Molière, de Racine et de Corneille en les lisant, un théâtre qui
m'a touché très directement au cœur. Mais j’ai pu malheureusement
constater la même chose en allant voir les représentations sur
scène. Dans le meilleur des cas, je m'ennuyais… J'étais convaincu
qu'il fallait redécouvrir les systèmes de représentation en
fonction desquels ces textes ont été écrits. Par ailleurs, je me
suis intéressé à la musique ancienne –renaissance et baroque- même
si je n'étais pas moi-même musicien. J'ai été impressionné à la
fin des années soixante par la manière dont cette musique avait
fait l'objet de redécouvertes. Les pionniers de la musique
ancienne qu’étaient Leonhardt et Harnoncourt dans les années
cinquante avaient préparé le terrain de ce qui allait être
développé à partir de la fin des années soixante. Même s'il y
avait déjà quelques détracteurs virulents qui allaient stigmatiser
ces « baroqueux », leur immense travail allait bientôt être
considéré comme allant de soi par la plupart des gens. J'ai alors
pensé qu'il était possible de faire la même chose pour le théâtre.
À la fin des années soixante-dix, j'ai pu constater qu'il n'y
avait aucun travail théorique sur cette question. Il fallait alors
retrouver un langage ancien, bien au-delà de quelques figures de
style qui auraient pu décorer une pièce jouée à l'ancienne… Il ne
s'agissait pas de donner un vernis superficiel avec de la gestique
baroque comme cela a pu être fait, mais bien comprendre ce théâtre
baroque dans son contexte. Il m'est apparu très rapidement
nécessaire d’étudier toute la civilisation baroque. Mon intérêt
pour cette civilisation n'était pas le fruit du hasard, hasard
auquel je ne crois d'ailleurs pas ! Cette démarche a réellement
apporté une réponse existentielle à des questions que je me posais
par rapport à ma vie. C'est quelque chose que j'ai développé dans
La parole baroque : par, exemple l'oxymore baroque, qui
consiste en la possibilité d'accepter en même temps deux vérités
qui, selon la raison, sont exclusives et contradictoires. À mon
avis, une grande partie des malheurs de la civilisation, depuis le
XVIIIe siècle, vient de cet oubli et de la toute-puissance de la
raison. J'ai fait ce travail avec beaucoup de passion, puisqu'il
ne s'agissait pas seulement d’une recherche intellectuelle, mais
également d’une nécessité artistique, et d’une réponse à des
questions existentielles. »
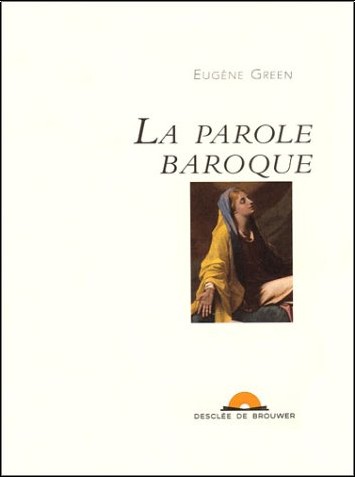
|
____________________
Connaissez vous la filmographie
d'Eugène Green ?
2001 : Toutes les nuits avec Alexis
Loret, Christelle Prot et Adrien Michaux
2002 : Le nom du feu (court-métrage) avec Christelle Prot et Alexis
Loret
2003 : Le Monde vivant* avec Christelle Prot, Adrien Michaux, Alexis
Loret, Laurène Cheilan, Achille Trocellier et Marin Charvet.
2004 : Le Pont des Arts* avec Natacha Régnier, Denis Podalydès, Adrien
Michaux et Olivier Gourmet
2006 : Les signes (court-métrage) avec Christelle Prot, Mathieu
Amalric, Achille Trocellier, Marin Charvet
2007 : Correspondances (court-métrage) avec Delphine Hecquet, François
Rivière, Christelle Prot
2009 : La Religieuse portugaise* avec Leonor Baldaque, Adrien Michaux
(*Le Monde vivant et Le Pont des Arts
sont disponibles en DVD aux éditions Montparnasse, La Religieuse
portugaise aux éditions Bodega )
____________________
|
« Vous êtes souvent très discret
sur vos raisons quant au choix du français alors même que vous
auriez pu retenir la langue qui vous a vu naître. » |
|
Eugène Green : « Dès l'âge de 11 ans, j'ai
réalisé que pour moi la chose la plus importante était le langage.
J'ai pris très tôt conscience que l'on existait à travers une
langue, que le monde se comprenait par la langue et qu’en Barbarie
il n'y avait pas de langue… Initialement, j'ai eu comme projet
d'aller en Angleterre, d’y apprendre l’anglais, et de travailler à
partir de là. Mais les choses ont fait que, après un an passé à
Munich – où j’étais souvent aussi à Prague et en Italie - je me
suis rendu en France dans l'espoir de perfectionner mon français.
Si je connaissais la littérature française ancienne, je n’avais
par contre que peu de familiarités avec la littérature
contemporaine. Il m’est apparu rapidement que si la littérature
britannique m’intéressait, elle ne me passionnait pas autant que
les littératures latines. » |
|
« La parole est intimement liée à
l’esthétique et à l’idée de sacré, éléments indissociables du
XVII° siècle. Comment avez-vous rétabli ces ponts souvent ignorés
de nos contemporains ? » |
|
Eugène Green : « Je crois que cela s'est
fait de manière très intuitive, dès mon plus jeune âge. Je ne
pouvais pas expliquer alors ce que j'ai compris depuis. Dans mon
roman La bataille de Roncevaux, le personnage central est
un jeune Basque du nord, né avec deux langues, l'une de son pays,
l'autre de l'Etat. Alors qu'il se trouve sous un pommier, il
énonce le nom du pommier en français, puis en basque. Avec cette
énonciation, il réalise qu'il ne s'agit pas de la même chose, que
le pommier n'est pas le même, et que le monde extérieur également
a une double existence. C'est quelque chose que j'ai intuitivement
compris très tôt, et dont j’ai trouvé la confirmation dans la
culture qui précède le XVIIIe siècle. Ces choses-là sont
essentielles pour moi, que ce soit dans l'écriture, le théâtre ou
le cinéma. »
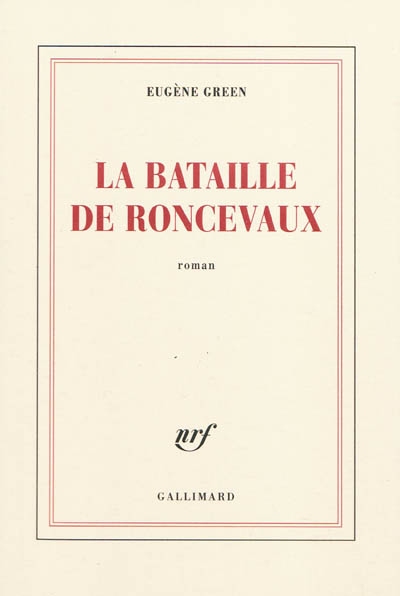
|
|
« C'est pourtant une réalité peu
souvent admise par nos contemporains ! » |
|
Eugène Green : « Oui, si on exprime ces choses-là de manière
abstraite, cela peut paraître un peu abrupt, mais si l’on fait la
démarche d'expliquer ces rapports entre la parole et le sacré, de
nombreuses personnes peuvent être sensibles à ces questions. J'ai
eu beaucoup de mal à proposer cette vision avec le théâtre
baroque, cela a été une galère de près de vingt-cinq ans ! Même si
j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, cela a été surtout de la
souffrance. La dernière chose que j'ai faite pour le théâtre, a
été un sermon de Bossuet que j'ai déclamé à l'église
Saint-Étienne-du-Mont en 2001. J'ai prononcé ce sermon en chaire,
éclairé par des bougies, alors que la pénombre gagnait petit à
petit [… Il faut vous imaginer,] et qu’apparaissait sur le dessous
du baldaquin la colombe du Saint-Esprit ! L'église était comble…
L'émotion était très forte. » |
____________________
Eugène Green et la restitution
de la parole baroque
« La voyelle latente
[ə] se prononçait partout, sauf là où l'élision prosodique
l'avait déjà rendue inexistante. Une consonne latente suivie d'une
autre consonne était considérée comme imprononçable, même en
déclamation, mais toute consonne suivie d'une voyelle devait se
prononcer (autrement dit, toute liaison était obligatoire), et une
consonne en contact avec le vide (c'est-à-dire avant tout arrêt de la
voix, et obligatoirement à la rime) devait s'articuler également. »
( La parole baroque,
Desclée de Brouwer)
____________________
|
« Vous soulignez souvent que
l’écriture a été au cœur de votre vie. Comment considérez-vous les
rapports entre écriture et parole, les liens sont parfois ténus
lorsque l’on pense à certains de vos films où le langage parlé se
confond avec l’écriture. » |
|
Eugène Green : « Je pense que la parole est
forcément sacrée. La langue est non seulement un ensemble de signes,
mais aussi un lieu, quelque chose de physique, qui doit être
incarné, et qui passe forcément par le corps humain. Et en même
temps, la parole est une énergie. La littérature est pour moi
toujours orale. J'ai le sentiment profond que toute écriture est
faite pour être incarnée. D'ailleurs, lorsque je suis chez moi, je
lis toujours à haute voix. Selon moi, notre tradition théâtrale est
toujours fondée sur une rhétorique. Même la commedia dell’arte est
fondée sur une rhétorique. Le texte doit être incarné et devenir
ainsi une parole vivante, c'est d'ailleurs tout le travail que j'ai
fait sur le théâtre baroque. Et lorsque j'écris mes romans, cela va
dans le sens de la simplification en un maximum d'énergie concentrée
en un minimum de parole. Les personnes qui n'aiment pas mon écriture
critiquent justement cette simplicité, mais celle-ci n'est
qu'apparente et ne survient qu’au prix d'un très grand effort. Je
crois que l'invention du cinéma a été une tentative de retrouver ce
sens réel de la parole. Le cinéma reprend les trois aspects de la
parole qui sont plus faciles à définir en français que dans les
autres langues : le mot, la parole, le verbe.
Cet aspect de la parole a disparu de la pensée dominante à partir de
la fin du XVIIIe siècle. Le cinéma peut arriver à reconstituer
quelque chose qui opère de la même façon. A un premier niveau, le
cinéma est une captation de la parole matérielle, ce qui correspond
au mot. Ensuite, la parole acquiert, par le biais de chaque plan,
une vie et une énergie propres. Chez les plus grands cinéastes, ce
peut être également l'occasion d'une rencontre entre l'homme et le
sacré, l’équivalent du verbe. Le cinéma est ainsi parole faite
image, puisque ce sont des images qui fonctionnent exactement comme
la parole avant le XVIIIe siècle. J'ai toujours voulu faire du
cinéma depuis l'âge de 16 ans. C'était l'époque où en regardant
Le désert rouge d'Antonioni, j'ai été convaincu de vouloir
suivre cette voie. Cela a mis beaucoup de temps à se concrétiser, et
c'est par un chemin détourné que je suis arrivé au cinéma. J'ai pu
bénéficier d'une extrême liberté en n’ayant fait aucune école.
Lorsque j'écris un scénario, j'ai absolument besoin de « voir »
chaque plan du film. Ainsi, beaucoup de choses sont déjà prévues
avant même la réalisation du film. Lorsqu'on a l'impression de
choses un peu bizarres dans mes films, c'est en fait ma manière
d'approcher la réalité. Je ne trouve aucun intérêt à montrer dans un
film ce que l'on peut voir dans la vie. Si l'on ne montre qu'une
réalité extérieure, ce n'est pas la peine de faire un film. Je
cherche plutôt à faire apparaître l'énergie spirituelle qui est là,
mais que nous ignorons la plupart du temps dans notre vie
quotidienne. C'est la magie du cinéma que de pouvoir montrer aux
spectateurs ce qu’ils n'auraient pas vu dans la vie réelle. Lorsque
je place ma caméra entre les deux personnages, c'est une manière de
mieux percevoir ces réalités.» |
|
____________________
Eugène Green et l'écriture
La Parole Baroque, 2001, Desclée
de Brouwer
Présences : Essai sur la nature du cinéma, 2003, Desclée de Brouwer
La Rue des Canettes (dédié à Marin Charvet) : cinq contes, 2003,
Melville
Le Présent de la parole, 2004, Desclée de Brouwer
La Reconstruction, 2008, Actes Sud
Poétique du cinématographe. Notes, 2009, Actes Sud
La bataille de Roncevaux, 2009, Gallimard
Un conte du Graal, 2010, Gallimard
La Religieuse portugaise, 2010, Diabase
La communauté universelle, 2011, Gallimard
____________________
|
« La Religieuse portugaise, votre dernier film, semble
aimanté par l’atmosphère bien particulière de cette ville que vous
chérissez tant, Lisbonne. Recèle-t-elle les secrets d’un passé qui
vous serait familier, mais que nous ne connaîtriez pas encore ? » |
|
Eugène Green : « C'est en effet une impression
que j'ai souvent, cette impression que j'ai d'ailleurs également
pour la langue française, celle d'une réminiscence de type
platonicien et non d'une découverte. Avec Lisbonne, et la langue
portugaise, c'est un peu la même chose. Il est possible que dans
d'autres existences, j'aie parlé français et également vécu à
Lisbonne ! Je suis passionné par le grand mythe portugais de Celui
qui est caché, Dom Sebastião. J'ai même écrit des textes inédits de
poésie avec une sorte d'épopée sur ce mythe du Encoberto, à
travers six incarnations : selon le mythe, Dom Sebastião devait
revenir plusieurs fois sous des formes différentes, sans être
reconnu. Ce ne sera que lorsqu'il reviendra en étant reconnu qu'il
établir le Cinquième empire universel. J'ai cette idée de la
réincarnation, et de souvenirs qui sont plus anciens que notre
existence. J’éprouve un peu ce sentiment à Lisbonne. » |
|
Votre dernier roman, La communauté
universelle, semble lui-même profondément nourri de cette idée
de lien qui unit l’humanité par-delà les classes sociales, les
lieux, les peuples et même le temps historique. Un rythme
crescendo va progressivement réunir dans un tourbillon tous les
êtres de cette histoire. »
|
|
Eugène Green : « Vous faites là un excellent résumé du roman !
Je crois profondément à la fiction, c'est d'ailleurs une idée
baroque. C'est une façon d’aborder de plus près la réalité, mais de
nos jours c'est quelque chose de très suspect… Le noyau central de
cette histoire m'est venu il y a une dizaine d'années quand j'étais
invité à Londres pour présenter mon film Le monde vivant au
festival de cette ville. J'ai eu l’idée d’une rencontre entre des
personnes issues de milieux différents, de religions différentes, et
même cette idée d'une conversation entre un fantôme et une jeune
femme. » |
|
« Vous partez d'une citation de maître Eckhart sur
l'indivisibilité du divin, il semble qu’il ait dans votre livre un
parallèle entre cette indivisibilité du corps divin avec le corps
humain et cette notion de lien qui nous unit tous. »
|
|
Eugène Green : « C'est en effet quelque chose qui est présent.
Dans ce roman, qui n'est pas très long, il y a beaucoup de
traditions religieuses qui se rencontrent. Je vois cela d'une
manière un peu dialectique et le seul moment où je me permets un
jugement personnel serait peut-être le petit sermon laïque tenu par
l’ex-prêtre de l'église anglicane à partir d'un sermon de maître
Eckhart. Pour moi, Eckhart est le plus grand maître spirituel !
Lorsqu'il dit que la réalité de Dieu c'est l’Un, on comprend tout à
fait qu'il ait pu être inquiété par l'Inquisition. Il affirme qu'il
y a un château fort dans l'âme ou Dieu lui-même dans ses trois
personnes ne peut entrer ! C'était évidemment quelque chose de très
hérétique au XIVe siècle, alors que pour lui ce n'était pas du tout
contradictoire avec sa foi chrétienne. Toujours selon Eckhart, la
réalité de Dieu n'a ni de forme, ni d'aspect et on a alors besoin de
métaphores et d'images. Mais le problème vient alors de ces
métaphores qui se transforment en dogme rationnel et intellectuel
alors que ce ne devait être que des chemins menant vers la réalité
de l’Un. Toutes les religions usent de ces métaphores et de ces
images. C'est une des forces du christianisme que d'avoir donné une
forme corporelle à la divinité. C'est cela qui explique la fin du
roman : l'humanité de l'homme est un des liens de la communauté
universelle, même s'il y en a d'autres. Plus on monte vers la
réalité de Dieu, plus on s'éloigne de tout, ce qui est une idée
platonicienne. Paradoxalement, plus on s'approche de l’Un et que
l'on s'éloigne de notre condition terrestre, plus on s'approche
également des êtres humains et donc également de la beauté du monde.
Je pense que les religions sont simplement des accès à cette
dimension. Par contre la réalité de l’expérience spirituelle relève
de la mystique. Mais en règle générale, la mystique est mal vue par
l’orthodoxie… Si vous observez la tradition mystique, dans la
plupart du temps, elle est intimement liée à la sensualité. »
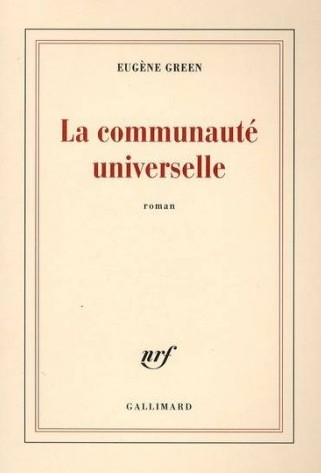
|
|
« Votre rapport au temps peut surprendre la pensée
rationaliste. Vous avez un traitement bien particulier quant aux
fantômes ! » |
|
Eugène Green : « Je pense qu'un des grands drames du monde
contemporain, et qui va de pair avec la perte de la spiritualité,
réside dans la perte du présent. Pour moi, le présent est le seul
temps réel, qui comporte tout ce qui a été et qui sera. Il est dans
ce cas tout à fait logique que les fantômes soient présents
puisqu'ils font partie de ce qui a été et de ce qui sera, ce que
l'on retrouve dans un très grand nombre de civilisations. Le passé
est très important, la culture est également très importante, mais
tout cela est intimement lié au présent. Ce sont souvent des choses
que les gens ne comprennent pas dans mon travail dès qu'ils notent
une référence culturelle, ils jugent cela réactionnaire, alors que
pour moi, c'est vivre dans le présent ! C'est pourquoi j'aime vivre
à Lisbonne, où le présent me semble plus réel parce qu'il y a le
passé et l'avenir qui sont toujours présents. Je m'intéresse
beaucoup au fado, et je souhaite intégrer de nombreuses évocations à
des grands fantômes de l'histoire portugaise dans un futur film
consacré à cette musique. Vous savez qu'au cœur du fado est présent
cette notion de saudade qui bien souvent est mal comprise :
c'est à la fois un regret de ce qui a été et un désir de ce qui doit
venir, les deux sont présents dans cette saudade qui est
alors bien plus qu'une simple nostalgie. Et lorsque l'on entend les
choses ainsi, les fantômes ont toute leur place… » |
|
« Est-ce que ces fantômes pourraient être notre mémoire justement
? » |
|
Eugène Green : « On peut le voir ainsi, mais comme il s'agit
d'une énergie réelle et précise, pour moi c'est aussi une réalité !
Si je n'ai jamais vu de fantôme, j'ai par contre souvent ressenti
leur présence, et dans des lieux où d'autres personnes avaient
constaté les mêmes phénomènes. Dans toute mon œuvre, ces fantômes
sont présents. Ils font partie de cette communauté universelle. »
|
|
« Comment Eugène Green observe-t-il notre société et nos sociétés
souvent malades de leur modernité. Quel est cet espoir que l’on
perçoit souvent dans vos créations ? » |
|
Eugène Green : « C'est quelque chose qui me surprend parfois
moi-même. Effectivement, je trouve que le monde va très mal et j'en
suis très triste. Mais parallèlement, je n'arrive pas à exprimer
quelque chose qui soit sans espoir. Je pense que si l'on a une vie
spirituelle, on garde forcément une certaine lumière, et je cherche
toujours à retrouver cette lumière dans les ténèbres, ce qui est la
démarche de beaucoup de mystiques. Quand j'étais plus jeune, alors
même que j'étais plus optimiste, j'étais plus négatif ! Et
maintenant, j'éprouve de la joie en créant un travail artistique.
Par contre, j'ai beaucoup de mal à supporter ce qui est glauque. Or,
notre société a tendance à développer de plus en plus cet état des
choses, voire même à l’encourager. Il y a une certaine obscénité à
étaler d’une manière complaisante la misère et la souffrance. Je
n'arrive pas à désespérer ! C'est peut-être complètement irrationnel
et bête, mais dès que je suis à Lisbonne, je n'arrive pas à déprimer
!
Ce qui m'horrifie maintenant, c'est que nous sommes gouvernés par
des gens sans aucune culture. Je comprends tout à fait que les
priorités économiques et sociales priment, mais la culture ne doit
pas être considérée comme un loisir et encore moins comme un produit
économique. La culture doit être présente dans tous les domaines de
la vie de la société. »
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
|
Interview Alberto Manguel
Paris, vendredi 2 octobre 2009
 |
Né en Argentine en 1948, Alberto Manguel a passé ses premières années à
Tel-Aviv où son père était ambassadeur. En 1968, il quitte l’Argentine,
avant les terribles répressions de la dictature militaire. Il parcourt le
monde et vit, tour à tour, en France, en Angleterre, en Italie, à Tahiti
et au Canada, dont il prend la nationalité. Ses activités de traducteur,
d’éditeur et de critique littéraire le conduisent naturellement à se
tourner vers l’écriture. Composée d’essais et de romans, son oeuvre est
internationalement reconnue. Depuis 2001, Alberto Manguel vit en France,
près de Poitiers. |
|
Faire la
rencontre d'Alberto Manguel, c'est un peu croiser sur son chemin à la fois
un encyclopédiste, un rêveur, un poète, un amoureux de la vie, surtout
lorsqu'elle est écrite noir sur blanc... Une heure passée avec lui vous
fait tourner beaucoup de pages pour sa plus grande joie ! Rencontre avec un
merveilleux magicien de la littérature...
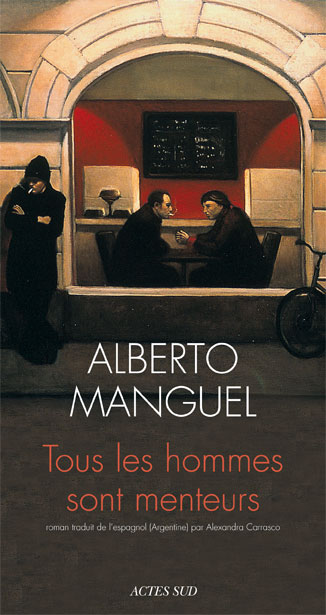
LEXNEWS : « Quel regard portez-vous sur ces
instants très secrets et particuliers qui vous ont fait basculer dans
l’univers de la lecture ? »
Alberto Manguel : « Je dois tout d’abord vous avouez que les
instants que vous évoquez ne sont pas pour moi des particularités. Au
contraire, les moments de rapport social me semblent beaucoup plus
extraordinaires et particuliers. Déjà enfant, je passais énormément de
temps tout seul pour des raisons familiales un peu complexes, car j'étais
élevé par une nourrice avec qui je passais l’essentiel de mes journées. Je
n'avais pas la compagnie d'autres enfants et donc mon univers était celui
des livres. C'était dans les livres que je retrouvais le dialogue, la
connaissance du monde et les amitiés. Ce n’est que beaucoup plus tard,
vers l'âge de 7-8 ans, lorsqu'un enfant est déjà formé, que j'ai commencé
à avoir une vie sociale en allant à l'école. Ces instants que vous appelez
des particularités correspondent à la vie normale quant à moi ! Je dois
faire un effort conscient pour communiquer dans un groupe... Je me sens
souvent mal à l'aise lorsqu'il y a plus de trois ou quatre personnes ! Il
faut s'y faire… »
LEXNEWS : « Pensez-vous que cet accès à la
lecture soit quelque chose qui puisse être cultivé ou au contraire relève
du plus grand des hasards ? »
Alberto Manguel : « Je crois qu’il s’agit là de quelque chose
d'inhérent à l'espèce humaine. Le fait que cette capacité soit cultivée ou
non par la suite dépend des circonstances sociales, mais en tant
qu'espèce, je crois que nous sommes disposés à la lecture. Nous avons
tendance à lire le monde comme une histoire, comme quelque chose qui a du
sens. Nous regardons un paysage et la première impression ne relève pas du
hasard, nous croyons d'une façon confuse et vague que l'emplacement d'un
arbre ou d'une étoile a un sens. J'appellerais cela la syntaxe du monde
que nous pensons reconnaître et que nous sommes en fait en train
d'inventer. Richard Dawkins, qui pour moi est un penseur essentiel de
notre époque, darwinien, a une théorie qui me plaît beaucoup sur l'origine
de l'imagination : il soutient que pour nous défendre dans un monde
difficile, comme toute autre créature vivante, nous développons certaines
facultés et que l'espèce humaine a développé la faculté d'imaginer une
situation, de recréer le monde avant de mieux affronter cette situation.
Un lapin apprend ce qu'il doit faire devant un renard qu’en sa présence,
alors que nous, nous pouvons imaginer ce que c'est que d'être devant un
renard, un lion ou M. Sarkozy ! Il s’agit d’imaginer comment nous
répondrions, quelle attitude nous adopterions. Cette faculté se développe
d'une façon très sophistiquée, non seulement en imaginant nos actions,
mais également en imaginant toute une histoire autour de cela, des mythes,
des romans, des poèmes, des oeuvres philosophiques et donc toute la
littérature. La littérature est notre meilleure façon de connaître le
monde pour mieux y vivre. Cependant, il s'avère que les sociétés que nous
avons bâties, pour des raisons autres, n'encouragent pas cette lecture. »



LEXNEWS : « Certains vont vite conclure à une
fuite face à la réalité dans ce que vous décrivez ? »
Alberto Manguel : « Absolument, vous allez alors entendre tout
le contraire de ce qui est, non seulement on va le dire, mais qui plus est
on va totalement pervertir ce sens de la lecture en créant ce que
j'appellerai aujourd'hui une idéologie de supermarché, une idéologie qui
vous offre un soi-disant accès aux livres mais vous laisse à la surface
des choses. »
LEXNEWS : « D’une lecture gardée pour vous dans
l’univers secret de l’enfance, vous êtes passé à une lecture partage, don
de soi pour les autres, dont vos livres se font l’écho : quelle transition
a permis cet altruisme ? »
Alberto Manguel : « Ce n'est pas un altruisme, je crois que
c'est la démarche naturelle de la lecture. Vous passez de l'apprentissage
d'un texte au partage de ce texte. Ce qui est initialement un monologue
devient nécessairement un dialogue, il y a peu de lecteurs qui peuvent
garder pour soi-même leurs lectures. Encore une fois, c'est une société
qui n'encourage pas cette confidence, qui veut faire croire à chaque
lecteur qu'il est unique et qu'il doit donc avoir une sorte de pudeur de
dire « tiens j'ai lu ce livre qui est merveilleux »… Vous entendrez toutes
ces idées préconçues qui sont absolument fausses, mais qui se manifestent.
Ce n'est pas un hasard si 90 % des lecteurs sont des femmes dans la
littérature…
Pour revenir à votre question, la démarche naturelle est de passer d'une
connaissance privée particulière du texte à un partage de cette lecture. »
LEXNEWS : « Dans Tous les hommes sont menteurs
vous révélez qu’il est curieux qu’aucun lecteur n’ait souligné que
votre seul et unique thème ne soit l’amour. (p. 137) Est-ce là la source
première ? »
Alberto Manguel : « (Rires…) Oui et non ! Dans le texte, pour
ce personnage qui parle, c'est absolument vrai. Tout tourne autour de
l'amour, c'est la seule chose qui lui importe, l'amour particulier pour
une femme particulière. Dans un sens plus large, c'est cela aussi. Depuis
un an déjà, je lis Dante tous les matins, c’est mon temps de méditation,
je lis un Canto, je me plonge dans un commentaire… Pour Dante, et
il le dit d’ailleurs à la fin à la dernière ligne du poème, il est très
clair que c'est l'amour qui fait bouger le soleil et les autres étoiles.
Le tissu de l'univers est l'amour, il ne s'agit pas d'un amour dans ce
sens rose que les romantiques lui ont donné, mais l'amour dans le sens du
mouvement corporel et psychologique envers l'autre. C'est le fait de
savoir que nous ne sommes pas seuls et que l'on ne peut pas être seul, le
grand péché de l'égoïsme réside dans le fait que l'on ne peut pas survivre
dans cette situation. Je ne veux pas faire ici de la philosophie mystique,
mais c'est en effet une idée qui a nourri toutes les religions du monde et
des sociétés... Cette idée entendue dans ce sens est en effet celle de
toute la littérature, la relation de celui qui parle avec les autres, son
entourage, et le monde. »

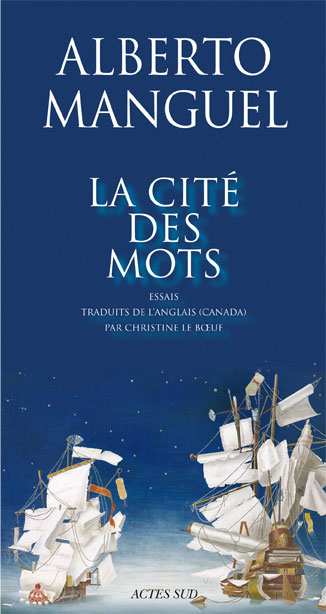
 |
LEXNEWS : « Lire à haute voix, pour les autres, peut
surprendre celle ou celui qui n’y est pas habitué. Qu’aimeriez-vous dire
aux éventuels sceptiques ? »
Alberto Manguel : « Lire à haute voix n'est pas la seule façon
de lire, il faut bien comprendre que lire à haute voix, c’est lire pour
donner de l'envol, et cela on peut le faire tout seul afin d'écouter ce
que le texte dit. Il m'arrive souvent de lire un texte seul à haute voix,
c'est le cas en ce moment pour Dante. N'oubliez pas que c'était notre
première façon de lire, la lecture silencieuse ne commence à être courante
qu'à partir du IXe siècle après Jésus-Christ. La lecture à haute voix
n'est pas seulement une façon de démêler le texte, ce qui était la raison
au début, mais également pour donner une réalité corporelle, physique à la
parole. Il y a d'ailleurs des théories de psychologues qui ont travaillé
sur les possibilités mentales de l'homme préhistorique qui supposent qu'à
l'origine du langage, les premières lectures étaient des hallucinations
auditives, c'est-à-dire que vous voyez une parole et vous l'entendez comme
si elle était présente. Il y a ensuite la lecture à haute voix que vous
faites par exemple à un enfant ou à un ami pour partager ce que vous êtes
en train de lire. Vous ne sortez pas encore réellement de la solitude de
la lecture, mais vous la dédoublez. Ensuite, vous avez une lecture
publique, c'est-à-dire la lecture qui est faite par celui dans une société
qui sait lire à ceux qui ne savent pas lire afin de communiquer un texte,
c'est le cas des premiers journaux par exemple qui, lorsqu'ils arrivaient
à la campagne, étaient lus par la personne qui savait lire. Cela n'est pas
seulement dû à des questions pratiques : si vous prenez par exemple dans
le Quichotte, à un moment donné, l'aubergiste raconte au curé son plaisir
pour les romans de chevalerie et il dit qu’après la moisson, ils se
réunissent et chacun écoute ce qu'il aime : sa fille, les histoires
d'amour, les garçons, les batailles... La lecture se dédouble, mais seule
une personne fait la lecture publique. Après cela, vous avez également une
lecture comme celle que j'avais faite pour Borges où vous prêtez vos yeux
à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vraiment votre lecture, ce n'était pas
moi qui choisissais les textes, qui donnais le ton… Tout cela était entre
les mains de Borges, mais comme il était aveugle, je faisais le parcours
des mots. Et finalement, vous avez la lecture de l'auteur, qui crée le
texte, mais qui veut savoir, à l'image du compositeur qui fait jouer sa
pièce, quelle est sa réception devant un premier public. Nous avons de
tels exemples depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours. Il ne faut pas
oublier non plus la lecture à haute voix faite par une machine qu'il
s'agisse d'une cassette, d'un CD, voire même la lecture d'un texte par un
ordinateur ! Quand nous évoquons la lecture à haute voix, il faut bien
distinguer ce dont nous parlons. »
La profondeur des discussions avec Borges
me semblait être celle qui s’imposait et sa générosité a littéralement
comblé le jeune lecteur que j’étais…
LEXNEWS : « Quels souvenirs gardez-vous de vos
instants de lecture avec Borges, et au-delà de cette mémoire, quelle
lecture avez-vous faite de ces lectures ? »
Alberto Manguel : « C’est vers l’âge de 16 ans que j’ai pu
faire, avec d’autres, écrivains, journalistes, la lecture à Jorge Luis
Borges. La rencontre se fit dans la libraire Pygmalion à Buenos Aires,
librairie que le célèbre écrivain fréquentait. En fin d’après-midi, un
jour qu’il rentrait de la Bibliothèque nationale dont il était le
directeur, il me demanda très poliment s’il me serait possible de venir
lui faire la lecture certains soirs à la condition que je n’aie rien
d’autre à faire ! Et pendant plusieurs années, à raison de trois ou quatre
fois par semaine, je me rendais dans son petit appartement qu’il
partageait avec sa mère et Fany, la bonne. C’était en 1964, et comme je
vous le disais, je n’avais que seize ans, peu conscient de ce que cela
représentait. Ce que j’observais et entendais n’était pas vraiment
étranger à l’univers du livre dont je vous parlais tout à l’heure dès ma
plus petite enfance. Cela ne me semblait pas étrange et, à l’inverse, les
conversations banales du quotidien avec mes amis, mon voisinage ou avec
mes professeurs m’apparaissaient bien plus bizarres ! La profondeur des
discussions avec Borges me semblait être celle qui s’imposait et sa
générosité a littéralement comblé le jeune lecteur que j’étais…
Avec le recul, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, et que je ne
savais pas à l'époque, c'est qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure,
une façon de lire à haute voix où vous prêtez vos yeux à quelqu'un
d'autre. À cela, s'ajoute dans le cas de Borges qu'en même temps que je
faisais la lecture, je l'entendais lire, c'est-à-dire que j'entendais ses
commentaires, non pas des commentaires tels que ceux qu'un professeur
pouvait faire, mais plutôt des réflexions que Borges faisait à haute voix
par politesse parce que j'étais là et cela a été vraiment des instants
uniques. Je n'ai jamais été témoin depuis d'un événement pareil… La pensée
de Borges était d'une liberté totale, cela donnait suite à des idées
originales et cela m'a, d'une certaine manière, encouragé à faire ce qui
est en fait notre lecture naturelle. L'enfant qui lit ne se dit pas je
suis en train de lire un texte du XIXe, de tel genre… Bien au contraire,
il ouvre, il coupe, il suit le personnage ou s'en détache, etc. Cette
liberté est celle avec laquelle Borges lisait, il se fichait littéralement
des écoles littéraires, des théories, des commentaires prestigieux même
s’il les connaissait et souvent même s'y intéressait. Mais il n'avait
aucun sens de l'aristocratie du monde intellectuel, ce qui l'intéressait
c'était les paroles, les idées derrière la parole et la musique derrière
les idées. Lorsque nous lisions un texte, il pouvait très bien associer
Agatha Christie à Platon sans que cela ne soit trivial et sans donner des
excuses ! Il est évident qu'une telle expérience, surtout lorsque vous
êtes un adolescent tel que je l'étais à l'époque, vous encourage à une
grande liberté, à une grande impertinenc voire au respect pour une
anarchie organisée ! Ni Dieu, ni maître, mais avec un certain système !
(Rires…)»



LEXNEWS : « Vous n’hésitez pas à dire que la
lecture peut être un étendard dressé contre la bêtise envahissante. Quel
plan de bataille vous semble s’imposer à l’heure des lectures de plus en
plus courtes et superficielles ? »
Alberto Manguel : « Je crois que l'urgence est en effet là, et
je pense que le problème essentiel est que nous combattions avec des armes
et des principes différents. D'un côté, vous avez ceux pour qui le profit
matériel est la base et le but de la société. Ces personnes souhaitent
miner la poursuite intellectuelle qui justement est tout le contraire.
Cela implique également des ouvriers suffisamment dociles pour accepter
ces normes de travail. Pour ceux-là, évidemment, il ne faut pas encourager
la lecture. C'est une philosophie qui tient un discours de l'ordre du
catéchisme, convaincre les autres que ce dont nous avons besoin, ce sont
des réponses courtes, précises pour l'efficacité. Il faut aller vite et
comme disait Christine Lagarde, il faut travailler plus et penser moins !
Du côté de ceux qui combattent cela, il est nécessaire de ne pas opposer à
un catéchisme, un autre catéchisme. Il ne s'agit pas de donner des
réponses immédiates, mais de laisser des situations ouvertes, de ne pas
aller vite, mais d'approfondir, de prendre son temps. C'est un peu encore
une fois le combat du lièvre et de la tortue !
|
Je ne crois pas
qu'il s'agisse d'un choix délibéré de notre société, mais plus d'une
certaine logique propre à celle-ci, cela dépasse le cadre des personnes
(gouvernants, responsables…). Pour évoquer les jeunes, il est évident
qu'ils ne sont pas stupides même si on leur enseigne à l’être ! Que
voient-ils ? Ils peuvent constater une société qui leur dit : allez vite,
ne réfléchissez pas, vous n'aurez pas d'avenir, et de l'autre côté, une
petite publicité qui leur dit : prenez un livre, lisez ! Ils ne sont pas
dupes, le livre est alors pour eux inutile… Je ne crois pas qu'il s'agisse
d'un complot, mais je pense que tant que nous vivrons dans ce système qui
finira par nous détruire, les choses n'iront pas autrement. »
Toute ma vie, et même encore maintenant,
les paroles dans les livres me donnent un moyen pour saisir ce que je vis.
Je conçois mal la possibilité de connaître quelque chose sans mots...
LEXNEWS : « Un de vos personnages de Tous les
hommes sont menteurs, Andrea, dit de vous : …Pour Manguel, rien
n’est vrai, à moins que ça ne soit écrit dans un livre. Quelle
différence faites-vous entre fiction et mensonge, et la vérité a-t-elle
encore une place dans votre univers littéraire ? »
Alberto Manguel : « Il y a deux questions dans votre question,
pour la première qui tient à ma personne, j'espère que le personnage qui
porte mon nom et qui est décrit ne correspond pas à la réalité ! Il est en
effet prétentieux, pédant… Quant à la phrase que vous citez, c'est
peut-être un peu vrai. Je ne dirais pas les choses de la même façon : Bien
que dans mon enfance, la connaissance du monde s'est faite surtout à
travers les livres, cela ne veut voulait pas dire que je ne pouvais pas
avoir une expérience pour laquelle je n'avais pas lu et qui n'était donc
pas vraie. Mais, il est vrai que toute ma vie, et même encore maintenant,
les paroles dans les livres me donnent un moyen pour saisir ce que je vis.
Je conçois mal la possibilité de connaître quelque chose sans mots, je
m'approche de cette philosophie linguiste radicale selon laquelle il n'y a
pas de connaissance possible sans paroles. Je ne fais pas une distinction
entre vérité et mensonge ni de dire, ce qui est banal, que la vérité est
relative. Je crois que nous avons dans notre imaginaire essentiel une soif
d'absolu, nous voulons que notre expérience du monde soit en elle-même
absolue. Lorsque je vois un arbre tout en sachant que je ne voie de cet
arbre que le côté sud, il demeure néanmoins important de savoir en même
temps que l'arbre existe tout entier en soi même. S’il y a bien une
réalité physique avec un poids, une mesure, il n'y a pas à mon avis une
connaissance de la chose tout entière. Non seulement cela nous échappe en
tant qu'être humain, mais cela échappe également à la chose elle-même.
Rien ne peut être connu dans l'absolu parce que cet absolu n'existe pas. »
LEXNEWS : « C'est d'ailleurs la conclusion de
votre livre ! Cela constitue-t-il l’univers littéraire selon vous ?»
Alberto Manguel : « Tout à fait ! C'est l'univers littéraire,
mais d'une façon positive. On peut aussi dire cela d'une façon négative :
quel malheur de ne pas avoir d'absolu. Non, pour moi, il y a une
infinitude de visions de réalité auxquelles nous pouvons avoir accès même
si nous n'aurons pas accès à toutes car nous ne sommes pas immortels.
Cette plénitude du monde est là pour que nous puissions la saisir et cela
est très réjouissant pour moi, c'est d'ailleurs le sens de la bibliothèque
même. La bibliothèque est par sa nature infinie, car vous pouvez toujours
y ajouter des volumes, et cette bibliothèque universelle est là devant
nous constamment. Vous constatiez tout à l'heure qu'il y a des personnes
qui ne lisent pas, cela ne veut pas dire que la bibliothèque est absente.
C'est un peu le cas de la petite histoire de Kafka, la terrible histoire
des portes de la loi avec cet homme qui reste toute sa vie au seuil de la
salle de la loi et qui, avant de mourir, voit soudainement ces portes se
fermer. Le gardien lui dit alors que ces portes se referment parce
qu'elles n’avaient été conçues que pour lui ! L'accès est pour chacun
d'entre nous qui veut être lecteur, c’est pour cela que je dis que la
lecture est une activité d'élite, élite à laquelle tout le monde peut
appartenir. »



LEXNEWS : « Écrire est une manière de garder
le silence… dites-vous, ce silence est-il la condition du dialogue
intérieur du lecteur ? »
Alberto Manguel : « Je crois qu'il y a une différence entre la
condition de l'écriture comme silence parce qu'elle accepte ses propres
limites, sa propre ambiguïté alors que pour les lecteurs c'est un peu le
contraire : le lecteur, à partir de cet aveu de silence, construit une
infinitude de textes, de dialogues, de paroles. Le Quichotte avoue
l’impossibilité de sa propre narration, mais donne lieu à des générations
de lecteurs qui multiplient à l'infini ce qui paraît être un silence et
qui devient finalement un silence assourdissant ! Je suis un lecteur
friand de théologie et ce qui me passionne dans cette discipline, ce sont
toutes ces constructions élaborées à partir de rien ! Et à partir de ce
rien, se construit une cohérence entre ces textes donnant un siège à la
parole du monde et tout peut être construit à partir de là. Je trouve
fascinant qu'à partir de ce grand silence, le plus fort de toute notre
histoire, il soit possible de construire des Babel de voix, de dialogues…
Encore une fois, en lisant Dante, vous pouvez retrouver tous ces grands
théologiens et lire des conclusions merveilleuses : au moment de l'accès à
l'amour de Dieu, au moment de la grâce, les contradictions d'Aristote, à
savoir quelque chose ne peut pas être et en même temps ne pas être,
deviennent une réalité vraie et belle selon Dante ! C'est évidemment
quelque chose qui ne peut pas être compris entièrement à l'image des
théorèmes mathématiques dont la complexité me fascine et, en même temps,
j'accepte que cette chose que je ne comprends pas soit vraie et belle ! »
LEXNEWS : "Merci Alberto Manguel pour
cette ode à la lecture, cet amour irrépressible pour ce qui est écrit et
source de vie et de rêves. La bibliothèque de Babel n'est pas prête de
s'effondrer avec vous et nul doute que votre témoignage encouragera le
plus grand nombre à chérir ces petits morceaux de papier reliés qui
accompagnent toute votre vie !"
Propos recueillis par Philippe-Emmanuel
Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés

 |
|
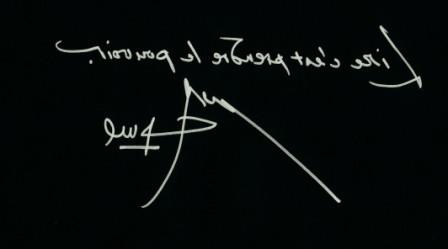 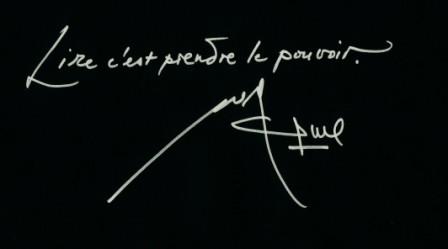 |
|
Interview Henry
BAUCHAU
Louveciennes, le 29 avril 2010 |
|
En hommage à Henry Bauchau disparu à l'âge
de 99 ans, nous republions l'interview que le grand écrivain et poète
avait accordée à notre revue.
Henry Bauchau,
psychanalyste, poète, dramaturge, essayiste, romancier, est l’auteur d’une
des œuvres les plus marquantes de notre temps. Il vit à Louveciennes.
Derniers ouvrages parus chez Actes Sud : Le Boulevard périphérique (2008
et Babel n° 372, Livre Inter 2008), Poésie complète (2009), Les Années
difficiles (1972-1983)(2009), et Déluge (2010).

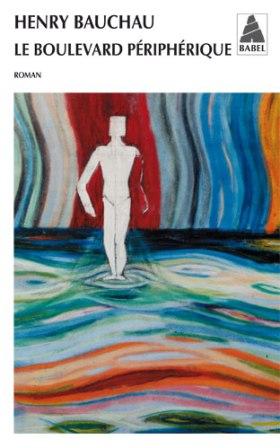





pour plus d'informations :
Pôle de recherches Henry Bauchau
constitué à l’Université catholique de Louvain à l’initiative de Myriam
Watthee-Delmotte et des chercheurs du Centre de recherche sur l'imaginaire
http://bauchau.fltr.ucl.ac.be
|
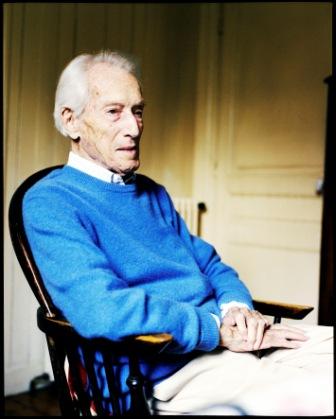
©Jean-Luc Bertini
Notre revue a eu le grand privilège de rencontrer Henry
Bauchau dans la maison de Louveciennes où il vit actuellement. Ce grand nom de la
poésie et de la littérature a accepté de répondre à nos questions avec une
rare délicatesse et attention. L'entretien s'est déroulé dans un cabinet
de lecture donnant sur un beau jardin ombragé par de grands arbres,
douceur appréciée par cette chaude journée de printemps. A l'âge de 97
ans, Henry Bauchau laisse une forte impression à toute personne qui le
rencontre tant sa force et, en même temps, sa fragilité transparaissent
derrière des phrases prononcées à voix douce mais toujours sûre !

LEXNEWS : « Psychanalyse et poésie pourraient de
prime abord sembler incompatibles. Or votre parcours démontre qu’il n’en
est rien. Comment avez-vous réuni ces deux approches et pour quelles
raisons ? »
Henry BAUCHAU : « la réponse à votre
question est tout d'abord d'ordre pratique. Dans ma jeunesse, je me suis
intéressé à la poésie et j’ai commencé à écrire certains poèmes, sans
beaucoup de succès d'ailleurs ! À la même époque, j'ai entrepris ma
première psychanalyse. À partir de ce moment, j'ai réalisé que la poésie
prenait de plus en plus de place. J'ai ainsi écrit un livre de poèmes,
puis une pièce de théâtre. J'habitais à l'époque la montagne et il m'est
apparu très rapidement qu'il était difficile de s'occuper de théâtre en
étant aussi loin. J'ai donc renoncé temporairement au théâtre et je me
suis tourné vers le roman. Avec l’écriture de romans, je me suis aperçu
que la poésie ne disparaissait pas, pas plus qu'elle ne disparaissait du
théâtre, elle prenait simplement une autre forme moins abrupte et plus
claire que dans la poésie moderne.
Par ailleurs, me trouvant dans une situation difficile, et puisque j'avais
fait une psychanalyse didactique, je me suis dit que je pourrais exercer.
Je travaillais dans un hôpital de jour comme psycho pédagogue, j'ai ainsi
commencé à prendre des patients en dehors de cette activité dès les années
76. On peut donc dire que je suis devenu psychanalyste un peu par hasard !
Pour revenir à votre question, le rapport que vous évoquez entre
psychanalyse et poésie avait déjà concerné certains écrivains, je pense
notamment au poète Pierre Jean Jouve. J'ai réalisé d’ailleurs ma première
analyse avec sa femme, Blanche Reverchon-Jouve. Je me suis rendu compte
non seulement qu'il n'y avait pas contradiction, mais que bien au
contraire la psychanalyse, par l'inconscient, ouvrait la porte à un monde
gigantesque. Tout cela est arrivé progressivement, au fur et à mesure de
l'avancement de mon analyse. C'est par cette analyse que j'ai pu réaliser
que l'écriture était le métier que je désirais. »
_________________
Je pense que l'inconscient est la grande
source d'imagination et pour cela il faut que l'on ait un libre rapport
avec son inconscient
_________________
LEXNEWS : « Le thème de l’artiste qui noue un
dialogue très intime avec son œuvre est récurrent dans vos écrits. Quelle
est la place de l’inconscient dans ces échanges et dans quelle mesure
est-il source d’inspiration ou au contraire de dévastation si l’on songe à
votre dernier roman Déluge ?»
Henry BAUCHAU : « Je pense que
l'inconscient est la grande source d'imagination et pour cela il faut que
l'on ait un libre rapport avec son inconscient. Il faut être débarrassé
des obstacles psychiques qui nous empêchent d'être en contact avec
nous-mêmes. Cela n'est pas possible tout le temps, mais lors des moments
d'inspiration, c'est à ce moment-là qu'il se manifeste. Je me rappelle
qu'à cette définition, Blanche Jouve ajoutait que l'on jetait ainsi un
charme sur le monstre, car il y a un monstre en effet dans l'inconscient.
Cet inconscient est toujours barbare et le problème à son contact est
d'arriver à filtrer cette inspiration dans des voies artistiques ou des
activités qui ne tournent pas à la violence. C'est par la beauté ou
l'intérêt du récit que l'on jette ainsi un charme sur ce monstre…
Je pense que
l'on peut dire que l'art est apaisant et si on apprend la part artisanale
de l’art, on peut faire passer la violence dans son art sans blesser les
autres. Dans « Déluge », le personnage Florian est un malade, il a
peur. La violence ressurgit en lui en même temps que la désespérance et le
désir de beauté. Il cherche peu à peu sa voie et finit par trouver une
sorte de père avec le capitaine du vaisseau qui l’a pris en affection. Ce
sera également en progressant avec l'aide d’une femme médecin qu'il va
apprendre à canaliser ce feu qui brûle en lui(...)
|
(...) À un
moment donné sans le vouloir elle lui inspire ce qu'il doit faire
notamment lorsqu'elle lui dit que pour noyer son feu, il lui faudrait le
déluge... Dans ce roman, je reviens d’une certaine au fonds biblique qui a
marqué un grand nombre de mes oeuvres, et Florian est un peu comme Noé ! »
LEXNEWS : « Justement, dans vos deux dernières
parutions (Le boulevard périphérique et Déluge), un
personnage est atteint d’une grave maladie et, plus généralement, blessé
de la vie. Quelle importance ont ces atteintes à la vie dans votre
écriture ? »
Henry BAUCHAU : « Je pense qu’il est
possible de se rapprocher mutuellement par sa blessure et que l'on peut
s'apaiser l'un l'autre grâce à cela. Dans Le boulevard périphérique,
celui qui dit « je » se rapproche de sa belle-fille, et en même temps, a
peur de s'éloigner d’un de ses malades. Il doit faire un effort pour qu'en
lui leurs places restent ouvertes. Dans Déluge, la blessure de
Florian est une blessure de la peur, d'une enfance épouvantable, et les
deux autres personnages sont également blessés. C'est à ce moment-là qu'il
y a un acte très important : Florian, qui aime Florence, renonce à elle
parce qu'il se rend compte qu'il n'a plus l'âge et qu'il n'est pas l'homme
qu'elle pourra aimer. Je pense que le psychanalyste est fondamentalement
un être qui a été blessé, il faut qu'il ait une empathie et cette empathie
vient de cette souffrance. »
_________________
L’homme n'est pas condamné à être ce
qu'il a été
_________________
LEXNEWS : « Quelle place réservez-vous au temps
dans votre écriture ? Les réminiscences sont fréquentes dans vos récits,
ont-elles une fonction cathartique ? »
Henry BAUCHAU : « Je ne crois pas que
l'on puisse vivre que sur le plan du présent. Ce présent est constellé
d'espérances, de croyances en l'avenir, et en même temps, il est envahi
par des souvenirs de toutes sortes, profonds ou circonstanciels. Pour moi,
il est très important de bien faire sentir qu'il y aura toujours un
arrière-fond et qu’ensuite l’homme n'est pas condamné à être ce qu'il a
été. Si vous prenez le personnage de la jeune femme qui meurt dans Le
boulevard périphérique, c'est une jeune femme occupée de son fils, de son
mari, de mode et qui n'a pas de grandes préoccupations. Elle est maintenue
dans l'espérance jusqu'au bout par les médecins, mais l'inconscient veille
et, dans ses derniers moments, elle est prête à mourir, parce qu'elle a
compris inconsciemment depuis longtemps qu'elle ne s'en sortirait pas. Je
pense qu'il y a des réminiscences qui nous viennent tout d'un coup de
choses que nous avions oubliées et qui surviennent un moment donné de
manière très importante. »
LEXNEWS : "Le voyage participe au vaste récit
initiatique de vos œuvres (Œdipe sur la route). Le destin, la
fatalité ne s’opposent pourtant pas à une certaine modernité ouverte à
l’invention. Comment parvenez-vous à concilier ces contraires ? "
Henry BAUCHAU : « Le thème du voyage
est un thème qui traverse pratiquement toute mon oeuvre. Avant Œdipe
sur la route, vous avez déjà dans le Régiment noir le héros
principal qui part en dehors de toute idée chronologique faire la guerre
de Sécession, de même Antigone retourne à Athènes malgré tous les
obstacles qui lui sont annoncés. C'est le voyage de la vie, c'est le
voyage du destin… Je pense qu'il s'agit d'une oeuvre ouverte, vers
l'avenir ou bien vers l'oubli... Je ne sais pas ! Notre époque change
tellement que nous ne pouvons pas prévoir ce que sera notre monde dans
cinquante ans. Et en même temps, je me sens très en retard par rapport aux
jeunes générations qui ont une telle connaissance des nouvelles
technologies qui changent la face du monde. Je pense que ces évolutions
qui s'accélèrent tellement vont modifier très profondément la société.
Vous savez, j'ai 97 ans et j'ai passé ma jeunesse jusqu'à l'âge de 10/11
ans à l'époque du cheval comme moyen de communication. Tout petit enfant
pendant la guerre de 14-18, j'ai vu les canons allemands qui passaient par
longues files sur nos routes tirés par des chevaux ! Et maintenant, nous
sommes à une époque où tout s'amenuise et devient de plus en plus
dangereux. Je ne me sens pas moi amenuisé ! Quand je vivais à Paris, j'ai
un peu couru comme tout le monde, mais je me suis toujours efforcé de
mettre des bornes à ces courses effrénées. J'ai le sentiment
qu'aujourd'hui un trop grand nombre de personnes n'a plus le temps de
rien, toujours à courir entre le travail et l'ordinateur, à faire des
queues interminables… »
_________________
J'ai essayé avec mes oeuvres
d'actualiser les problèmes que se posaient des personnes il y a quatre
siècles avant Jésus-Christ, problèmes que je ne peux même pas imaginer
_________________
LEXNEWS : « Quelles leçons avez-vous retenues des
temps mythologiques qui inspirent certaines de vos œuvres ? Et pensez-vous
que le lecteur du XXI° puisse encore parvenir à y déceler des hiérophanies
qui perpétueraient cette longue tradition ? »
Henry BAUCHAU : « J'ai essayé avec mes
oeuvres d'actualiser les problèmes que se posaient des personnes il y a
quatre siècles avant Jésus-Christ, problèmes que je ne peux même pas
imaginer. Or les problèmes actuels peuvent être néanmoins appréhendés au
regard de cette expérience sans pour autant les transposer intégralement.
C'est en ce sens qu'une transmission est possible. Mais avant tout, cela
se transmet comme une belle histoire ! »
LEXNEWS : « Merci Henry Bauchau, nous retiendrons en effet
cette belle histoire que vous avez léguée à vos lecteurs grâce à votre
écriture, une réflexion qui nourrira également à n'en point douter les
jeunes générations qui pourront redécouvrir ces leçons éternelles de
l'homme !"
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
 |
Un message adressé par Henry BAUCHAU à nos
lecteurs :
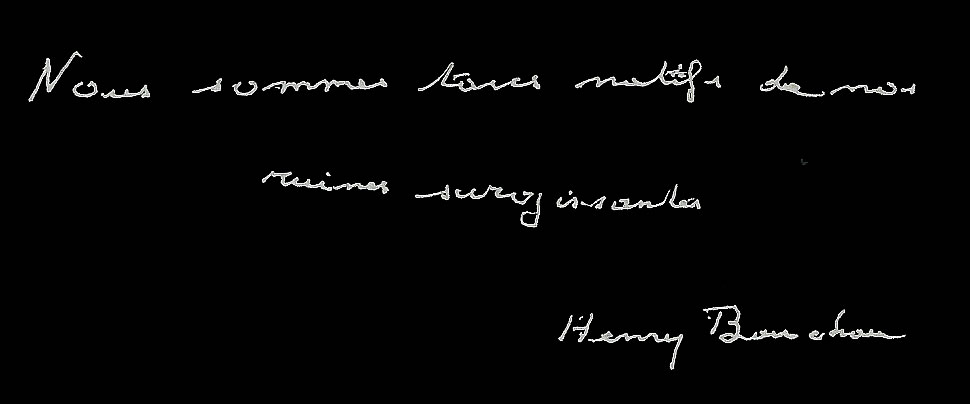
(Nous sommes tous natifs de nos ruines surgissantes)
|
|
Interview Adonis
Paris, le jeudi 4 juin 2009 |
|

© LEXNEWS
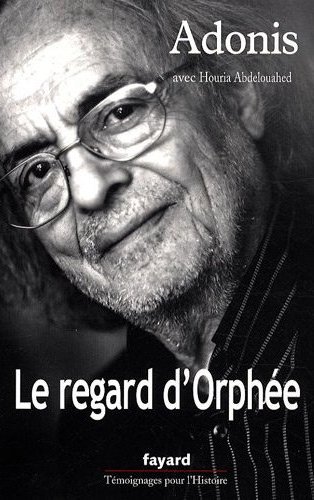
son dernier livre paru aux éditions Fayard

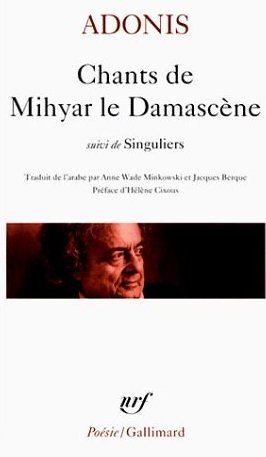
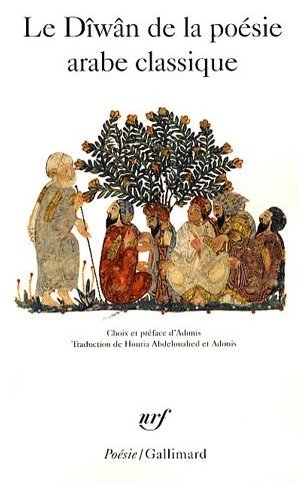

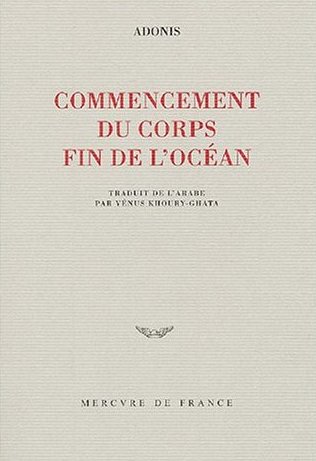

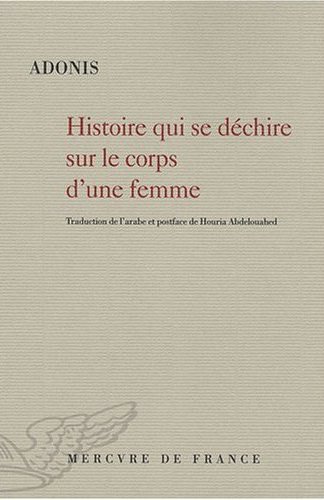 |

© LEXNEWS
Lexnews a eu le grand privilège de rencontrer l'un
des plus grands poètes contemporains de langue arabe. Personnage entier
qui n'hésite pas à dire les choses telles qu'il les pense, il a su
dépasser les cadres de la poésie classique pour nourrir un vrai dialogue
original avec sa vie - véritable odyssée - et le monde qu'il parcourt
inlassablement. Sa voix est aussi douce que ses poésies sont fortes,
trempées dans un acier nietzschéen sans concessions. L'homme est un
personnage de conviction, et un poète à l'âme délicate qui nous invite à
mieux percevoir les vibrations infimes de nos existences...

LEXNEWS : « Votre rapport à la terre date de la
plus petite enfance. Le fait d’avoir connu très tôt les labeurs de cette
terre a-t-il eu une influence sur votre manière de considérer le monde et
sur votre poésie ? »
Adonis : « Il faut faire une
différence entre la terre et la nature, je ne suis pas assez pris par la
nature et cela n'entre pas ontologiquement dans ma vision poétique. Cela
ne m'empêche pas bien sûr d'apprécier la nature quant à ses variations sur
la beauté et pour cette dimension autre de notre existence. Ce qui est au
coeur même de mon travail, c’est l'être humain. Mais, la terre en tant que
matière première, cela me touche beaucoup. La terre a chez moi une
dimension verticale et c'est une verticalité poétique. Ces premières
années que vous évoquiez ont joué un très grand rôle et je suis convaincu
que pour mieux vivre le présent, il faut passer par l'enfance. L'enfance
n'est jamais un passé, mais toujours devant nous et, dans ce sens, elle
joue un grand rôle. Écrire un poème, c'est comme labourer un champ. »
LEXNEWS : « Votre père avait plus le rôle d’un
initiateur que celui d’un père traditionnel. Comment voyez-vous cette
relation aujourd’hui ? »
Adonis : « J'ai malheureusement
découvert cela trop tard après sa mort. C'était un ami plus qu'un père
classique. Il ne m'a jamais imposé des interdits ou des obligations y
compris dans les matières religieuses, il me disait toujours : « décider
c’est facile, mais il faut avant réfléchir ! ». C'est en ce sens que j'ai
découvert par la suite qu'il était un ami. Il a très certainement eu une
grande influence sur moi, même si je ne suis pas parvenu à l'estimer de
manière suffisamment précise. C'est à partir de sa mort que j'ai commencé
réellement à le connaître et à le comprendre. Il ne faut pas oublier que
j'ai quitté la maison à l'âge de 13 ans, ce qui était très jeune. »
LEXNEWS : « Ne peut-on pas dire que votre père
vous a légué cette extrême liberté ? »
Adonis : « Ce serait plutôt à un
psychanalyste de répondre ! Mais il est vrai que mon père m'a fait lire
les plus grands poètes et il me laissait toujours libre d'aimer ceux que
je préférais. Il ne m'imposait jamais son goût, goût plutôt classique le
concernant. »
LEXNEWS : « Une terre qui vous apprend très tôt
ses exigences et un père qui s’efface progressivement vous conduisent à
une indépendance rapide. Mais indépendance ne rime pas avec fermeture sur
soi. Votre vie entière semble rythmer ou rimer avec l’ouverture. »
Adonis : « Oui, je le crois fermement
et j'oeuvre dans cette direction tous les jours. Ma vie sans cette
ouverture n'aurait pas de sens pour moi. Mais être ouvert nécessite aussi
une réponse, un espace de l'autre. L'ouverture dans une société close est
quelque chose de très difficile. Il faut acquérir une grande culture pour
accepter la liberté de la démocratie, pour accepter l'autre différent de
soi. L'ouverture contrairement à ce que l'on pourrait penser n'est pas une
facilité. Vous ne pouvez pas créer de la grande poésie dans une culture
qui n'est pas grande. Il faut donc une grande culture dans tous les sens
pour créer de la grande poésie. Je pense que c'est un trait commun à de
nombreuses sociétés. La révolution surréaliste a eu beaucoup de
difficultés à être acceptée ici même en France, pays de la Révolution.
Comment voulez-vous créer chez nous avec la religion qui imprègne cette
idée que les musulmans sont les meilleurs des peuples ? Dans ce contexte,
il est très difficile d'envisager une liberté libre... Si l'on désire être
libre, même ici en Occident, il faut alors envisager la mort. Si vous ne
pouvez pas dire à votre bien-aimée ce que vous pouvez dire à un ami, cela
signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre amour. Cet
exemple est significatif pour notre religion : si vous acceptez l'idée que
l'on ne peut rien ajouter aux ultimes vérités, que l'homme doit alors
obéir et seulement interpréter, alors nous ne pouvons pas être libres dans
un tel contexte. »
LEXNEWS : « Vous serez de ce fait non seulement
indépendant vis-à-vis de votre famille, mais également de votre terre.
Cette lucidité nietzschéenne vous conduira même à une indépendance
critique vis-à-vis de la religion. »
Adonis : « C'est en effet une attitude
ancienne et qui continue encore aujourd'hui. Il m'arrive encore au XXI°
siècle de voir certains de mes textes censurés par des éditeurs ou des
journaux par peur des répercussions que cela pourrait avoir. Il y a des
sujets sur lesquels, même ici en France, il n'est pas possible d'écrire...
Si les pays musulmans avancent des justifications religieuses, ici en
Occident, cela n'est même pas le cas ! Cette question de la liberté est
donc à repenser y compris en Occident. Pour moi, le monothéisme n'a pas
été un progrès dans l'histoire de l'humanité, mais au contraire un coup
d'État, un commencement de décadence. Mais, si je dis cela dans les pays
musulmans, cela ne sera jamais publié. Je crois que la pensée occidentale
ne peut pas ouvrir un véritable espace pour de nouvelles idées si elle ne
repense pas elle aussi le monothéisme. »
LEXNEWS : « Et pourtant de ce rapport à la
religion peuvent naître des créations artistiques très belles comme en
témoigne l'histoire de l'art dans les différentes sociétés ? »
Adonis : « Si vous faites la
comparaison entre la créativité païenne et la créativité religieuse,
quelle différence ! Et même au sein de la créativité religieuse, ces
artistes n'étaient souvent pas des religieux dans le sens conservateur que
j'évoquais. C'était plutôt des rebelles, des révoltés. Pour moi, la
religion à proprement parler est anticréation, et contre l’art, sauf si
vous vous conformez à la lignée du grand Créateur. Les grands créateurs
étaient pour la plupart des païens même au sein de l'Islam. C'est un
phénomène extraordinaire, nous avons deux piliers dans notre culture : la
religion et la poésie. Tous les grands poètes étaient athées, tous sans
exception ! Mais l'essentiel ici, c'est que la société a accepté la poésie
comme si la poésie représentait l'inconscience du peuple et la religion,
l'institution. Je me demande toujours pour quelle raison la société a
accepté la poésie alors même qu'elle a refusé tous les mystiques. À ma
connaissance, personne n'a cherché à expliquer ce phénomène. »
LEXNEWS : « L’homme est au centre de la création
dite vous. Nietzsche et Héraclite vont faire de vous un électron libre,
toujours en mouvement. La fixité vous fait peur. Votre muse se
nomme-t-elle l’inconnu ? »
Adonis : « Oui, même si ce n'est pas
quelque chose de facile, car la mémoire est toujours là. J'essaie toujours
de me libérer de la mémoire. Au fond, pour mieux vivre, il faut tuer la
mémoire. On ne peut pas vivre pleinement en s'appuyant sur la mémoire. Si
vous parvenez à une certaine distance de votre mémoire, vous vous rendez
compte que vous êtes devant le chaos, l'inconnu. Comme je suis toujours à
la recherche de quelque chose que je ne connais pas, ma poésie est une
recherche de cet inconnu. Comme vous le dites, ma muse peut être cet
inconnu. »
|

© LEXNEWS
LEXNEWS : « A l'image de ce
regard d'Orphée, vous ne voulez pas vous retourner ? »
Adonis : « En effet, je ne veux pas me
retourner et c'est pourquoi je dis toujours que l'enfance n'est pas un
retour. Pour être un poète, il faut toujours être un enfant, sans mémoire,
sans théorie, toujours devant, comme l'amour qui n'a pas de mémoire. »
LEXNEWS : « un éternel présent
? »
Adonis : « Oui, un éternel présent.
L'amour ne se répète pas, c'est toujours un commencement. »
LEXNEWS : « Vous avez été très influencé par
Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud et Mallarmé. Quelles sont les émotions,
les découvertes que ces poètes ont pu faire naître chez celui qui a baigné
très tôt dans la poésie islamique ? »
Adonis : « J'ai découvert ces poètes
très tard et je n'ai pas été réellement influencé, mais plutôt instruit
par eux. Une fois que j'ai lu Baudelaire, j'ai mieux découvert nos plus
grands poètes comme Aboû Nouwâs qui évoquait les mêmes idées à savoir le
problème de l'unité de l'éphémère et de l'éternel, l'esprit de la ville,
des bars et des rues… Baudelaire a été un stimulant pour mieux comprendre
notre poésie ancienne et classique. Ce grand poète a créé un grand espace
pour mieux voir le monde. »
LEXNEWS : « Le processus qui conduit à la
création poétique est souvent mystérieux pour le lecteur. Pouvez-vous nous
aider à placer des mots sur ce qui vous conduit à créer cette partition de
mots ? »
Adonis : « Pour moi, il n'y a pas de
règles dans la poésie. Je n'ai jamais écrit un poème sur une table de
travail, mais en marchant dans les rues. Nous sommes en train de parler et
cela fait naître de la poésie en ce moment même… Dans la pratique, des
vers que je pensais être le début d'un poème s'avéreront être la
conclusion de ce même poème ! Il n'y a aucune logique pour écrire un
poème. C'est un hasard, mais un hasard extraordinaire que l'on ne peut
expliquer. La structure d'un poème et la dernière forme d'un poème peuvent
par contre être l'objet d'un travail raisonné répondant à certaines
règles. Je crois que ce qui est essentiel dans la poésie, c’est que l'on
ne peut pas la définir. Si vous prenez quatre ou cinq poètes aux antipodes
les uns des autres, cela ne vous empêchera pas d'aimer leur poésie si
différente. Imaginez que vous aimiez Mallarmé, et en même temps que vous
aimiez son contraire avec Baudelaire ou Rimbaud. C'est comme en amour,
pourquoi aimez-vous cette femme et pas une autre ?»
LEXNEWS : « Y a-t-il au départ une émotion ?»
Adonis : « Oui, mais qu'est-ce qu'une
émotion ? Qu’est-ce qu'un sentiment ? Peut-on faire une différence ?
L'émotion est peut-être une autre pensée, mais on ne peut pas mesurer
cette dernière. L’être humain est un tout et je crois que tout est mêlé,
nos pensées et nos émotions ensemble. Je ne vois pas comment démêler le
degré de l'émotion et de la pensée chez Rimbaud par exemple. Comment
séparer ces choses ? Pour l'instant, il faut avouer que nous sommes dans
l'ignorance, les poètes n'ont pas écrit là-dessus et les psychanalystes
peuvent difficilement aborder ces choses-là. »
LEXNEWS : « La langue arabe doit exprimer des
expériences humaines universelles, rappelez-vous. Vous faites le reproche
aujourd’hui aux Arabes de ne pas se pencher suffisamment sur ce legs. Ne
connaît-on pas la même tendance, et pour d’autres raisons, en Occident ? »
Adonis : « Le poète arabe actuel n'a
pas une vision du monde ou de l'être humain. Il reste à la surface des
événements, des problèmes humains à l'image en effet du poète occidental.
Ce qui règne, c'est une vision narrative prosaïque. Il y a d'ailleurs deux
grandes formes pour exprimer une chose : ou bien vous la voyez comme une
chose devant vous et vous la décrivez, ou bien vous la voyez dans son
sens, dans sa profondeur, avec autre chose que l'oeil. Nous sommes
actuellement, même s'il y a heureusement des exceptions, en Orient et en
Occident, dans une narration de ces choses et non une métaphysique des
choses. On ne peut pas comprendre le visible sans comprendre l'invisible.
Ces poètes essayent maintenant d'effacer l'invisible et de rester au
niveau du visible. C'est un peu comme si le monde n'était qu'un écran,
mais il y a des choses derrière cet écran ! »
LEXNEWS : « D'où l'importance que vous donnez la
philosophie ? »
Adonis : « Oui et de manière plus
générale à la pensée. La poésie pour moi ne peut pas être séparée de la
pensée. La poésie et la pensée sont organiquement liées. »
LEXNEWS : « C'est ce que les poètes préislamiques
avaient parfaitement compris. »
Adonis : « Absolument ! Et même les
grands créateurs islamiques.»
LEXNEWS : « L’Occidental est particulièrement
inculte quant à la connaissance de cette poésie arabe classique. Vous lui
avez consacré un recueil récemment traduit. Quels sont les difficultés et
les défis pour la découvrir ? »
Adonis : « Il faut avant tout une
volonté d'ouverture, souhaiter connaître l'autre. Or, je ne vois pas cette
volonté ici en Occident. N'importe quel écrivain américain trouve un écho
dans les médias aujourd'hui en Occident ce qui n'est pas le cas pour un
écrivain arabe sauf dans des contextes particuliers qui relèvent souvent
de la manipulation. Il y a beaucoup d'a priori contre les Arabes. »
LEXNEWS : « Comment lever ces a priori ? »
Adonis : « Bien entendu, je suis mal
placé pour évoquer cela, car je n'ai jamais eu de difficultés pour publier
mes livres et j'ai beaucoup d'amis qui m’ont aidé pour cela. Mais il faut
une réelle ouverture sur une culture, une civilisation, des amitiés
individuelles... Cela fait défaut en Occident. Pour quelle raison ? Il y a
certainement des raisons politiques, de nombreuses raisons inconscientes,
le refoulé religieux, politique… Je crois beaucoup en la rencontre, les
rencontres, les amitiés, ainsi qu'une politique européenne culturelle pour
accélérer cette connaissance par le biais d'éditions et de traductions de
qualité. C'est d'autant plus important que les Arabes sont ouverts à cette
démarche. Il faut également une certaine hospitalité qui dépasse les peurs
des fondamentalismes. Nous avons ce sentiment dans le monde arabe d'être
négligés et cela donne une amertume. »
LEXNEWS : « Merci Adonis pour
ce beau témoignage qui encouragera très certainement nos lecteurs non
seulement à découvrir votre poésie mais, grâce à elle, l'ensemble de la
poésie de langue arabe encore trop méconnue dans notre pays !"
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
La signature d'Adonis pour nos
lecteurs :
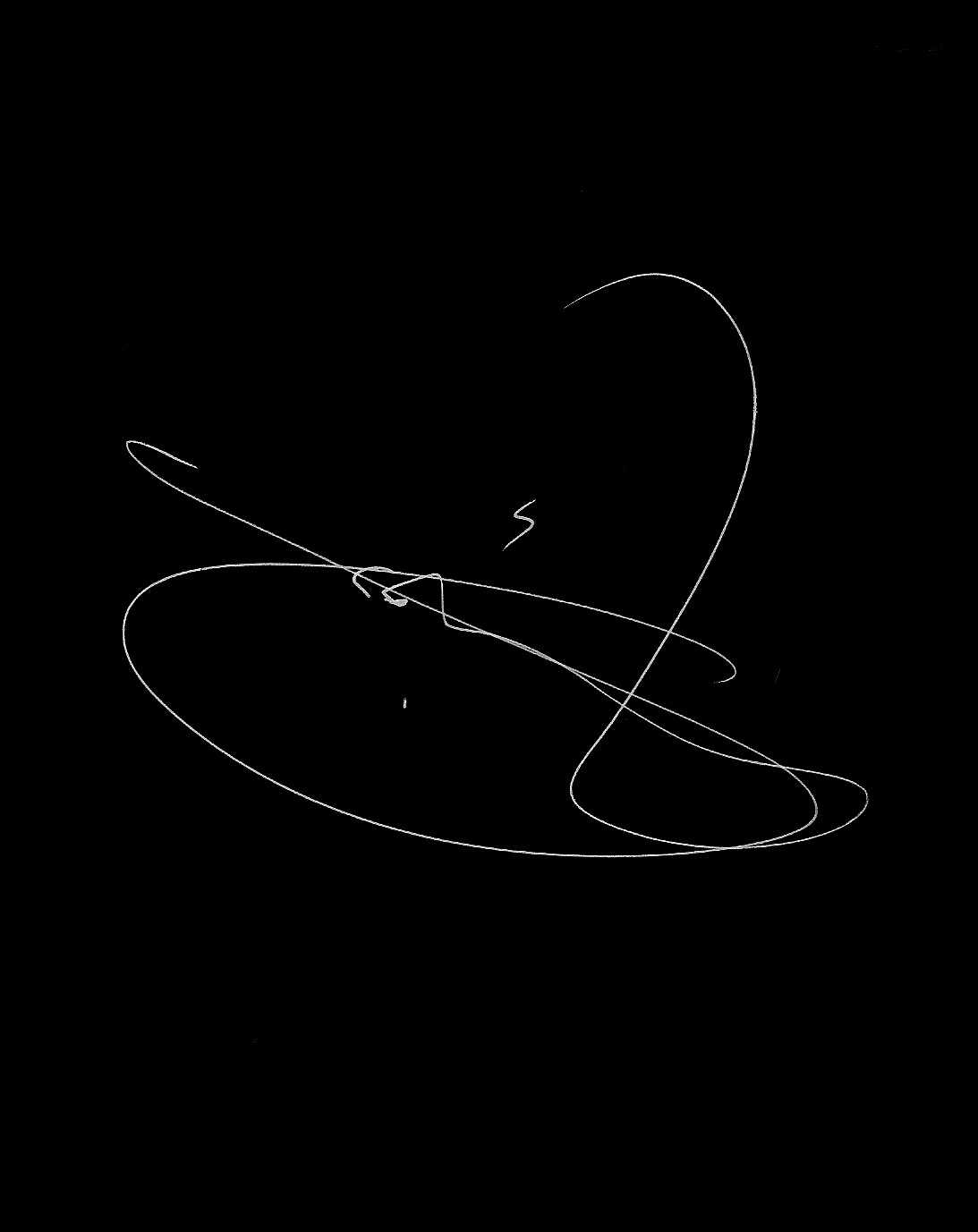 |
ENTRE TES YEUX ET
MOI
quand je plonge mes yeux dans les tiens
je vois l’aube profonde
je vois l’hier ancien
je vois ce que j’ignore
et je sens que passe l’univers
entre tes yeux et moi
(cité de Poèmes pour l’amour et la mort,
Mémoire du vent Poésie Gallimard / Gallimard, NRF, p. 22 ) |
ORPHEE
Amoureux je dévale la pente
pierre dans les ténèbres de l’enfer
mais j’irradie
j’ai rendez-vous avec les prêtresses
dans la couche du dieu ancien
Mes paroles sont vents agitateurs de vie
mes chants étincelles
Je suis la langue d’un dieu à venir
Je suis le charmeur de poussière
(cité de Le charmeur de poussière
, Mémoire du vent Poésie Gallimard / Gallimard, NRF, p. 48 ) |
LE PONT DES LARMES
Un pont de larmes chemine avec moi
se brise sous mes paupières
Dans ma peau de porcelaine
un chevalier d’enfance
attache ses chevaux avec les cordes du vent
à l’ombre des branches
et d’une voix prophétique nous chante :
« Ô vents, ô enfances !
Ponts de larmes brisés
derrière les paupières ! »
(cité de Le charmeur de poussière
, Mémoire du vent Poésie Gallimard / Gallimard, NRF, p. 51 ) |
|
Les Rencontres de LEXNEWS
: Un métier, une passion ...
|
|
 |
LA DOGANA
Editeur
Interview de Florian RODARI
17 décembre 2008 |
|
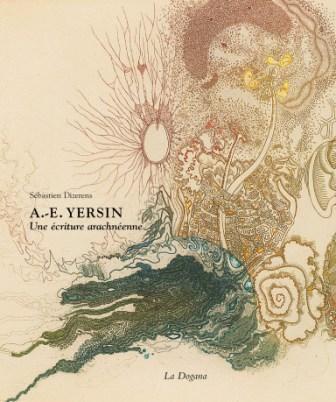
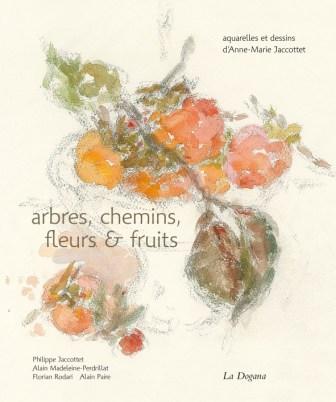


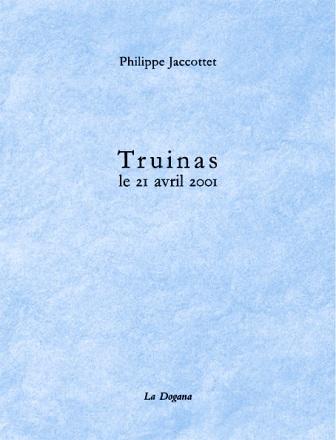 |
|

©
Photo François Raoul-Duval
Florian Rodari dirige depuis 1981 les Éditions La Dogana
créées dans ce beau pays qu'est la Suisse, à Genève. C'est la poésie qui est
le fil conducteur de ce magnifique travail entrepris dans des domaines aussi
différents que les essais, les souvenirs, des méditations et même des lieder
chantés. L'excellence est au coeur de ce processus créatif, les Éditions La
Dogana ne retenant que ce qui fait écho à la beauté. Beaux papiers, superbe
mise en page, textes raffinés... offrent le plaisir du bel objet, écrin
indissociable de la belle pensée. Voyage en Helvétie avec un esthète du
livre !



LEXNEWS : « Quel a été le parcours qui
vous a mené aux éditions La Dogana ? »
Florian Rodari : « j'ai baigné très tôt dans l'univers des lettres.
Mon père était journaliste, mon oncle (Philippe Jaccottet) était poète et
traducteur, et tous nous aimions les livres à la maison. Nous avons
également découvert que nous avions un cousin célèbre en Italie, Gianni
Rodari, qui écrivait des livres pour enfants. L'environnement a
manifestement joué dans mon parcours ! J'ai assez naturellement commencé des
études de lettres à l’Université de Genève. Pour gagner ma vie, à vingt ans,
je suis entré au musée de Genève, au Cabinet des estampes pour y classer des
collections de gravures anciennes. Il y avait là une équipe à l’esprit très
ouvert. Grâce à elle j'ai vite appris le métier de conservateur puisqu’ils
m’ont généreusement laissé monter seul des expositions et fabriquer leur
catalogue. Quand je suis devenu responsable de la Revue de Belles-Lettres,
en 1971, au moment de la rédaction du numéro consacré au poète Paul Celan,
j’ai aussitôt mis en pratique ce double regard de lecteur et d’amateur
d’art. Conduire une revue littéraire, c’est un atout formidable pour un
futur éditeur, car on apprend à découvrir d’autres voix, à accorder dans un
livre des approches différentes… Je lisais essentiellement des poètes,
j’écrivais un peu et je rédigeais de plus en plus souvent des textes sur
l’art. Cette activité multiple je l’ai menée de front pendant presque
quarante ans déjà. On ne se rend pas toujours compte du temps qui passe,
surtout en ce qui vous concerne ! Je pensais pratiquer chacune de ces tâches
comme des hobbies et finalement je me rends compte qu’elles étaient devenues
des activités principales. Les choses se sont enchaînées : vers 1979 on m’a
demandé de diriger le Musée de l’Elysée à Lausanne, mais cela n’a pas duré
longtemps. A peine quatre ans : le désir de faire des livres et d’écrire
était si obsédant que, devant les surcharges et les tracas administratifs,
j’ai renoncé. Les éditions Skira m’ont alors demandé de travailler pour eux
et d’écrire un ouvrage sur le collage. Ils se sont aperçus que je savais
fabriquer des livres et, c’est comme ça que je suis devenu directeur de
collection chez eux. En 1993, Skira a subi la crise du livre de plein fouet.
Il fallait trouver quelque chose. Depuis longtemps, avec mes amis artistes
de l’atelier de Saint-Prex, avec qui j’avais préparé plusieurs projets dans
le cadre de mon activité à la Fondation Cuendet (où sont conservées des
planches de Dürer, Rembrandt, Corot et de bien d’autres maîtres de
l’estampe, nous avions envie de monter une exposition sur l’invention de la
gravure en couleur. Nous avons proposé de la montrer à la Bibliothèque
nationale de France où, grâce à l’appui de Maxime Préaud, nous avons pu
concrétiser ce projet qui a porté le beau nom d’Anatomie de la couleur.
Cette exposition a été pour moi le point de départ de nombreux autres
engagements. Dans la foulée, on m'a en effet demandé de monter au Drawing
Center de New York une exposition sur les dessins de Victor Hugo, puis deux
ans plus tard sur l’œuvre graphique d’Henri Michaux. Au même moment, Jean
Planque, un oncle de ma femme qui avait travaillé comme conseiller de la
galerie Beyeler, m'a demandé de m'occuper de la Fondation qu’il voulait
constituer à partir de sa collection de tableaux. Voilà pourquoi,
aujourd'hui, je partage mon temps entre cette Fondation et les éditions La
Dogana. Ces dernières prennent une place grandissante ! Nous comptons
aujourd'hui plus de soixante titres avec plus de quarante auteurs, des
traductions, des rediffusions, et nous sommes insuffisamment nombreux pour
cela, il faut ainsi préserver un équilibre toujours précaire. »
LEXNEWS : « Quel a été le point de départ de la création des éditions La
Dogana ? »
Florian Rodari : « Les éditions de La Dogana sont nées en 1981, de la
décision d’un petit groupe d'amis: un imprimeur, un ami peintre et amateur
de musique, et moi-même. L’idée de départ était d’éditer des textes dont
nous n’avions publié que des extraits dans la Revue de Belles-Lettres. Nous
avons mis de l'argent en commun, en nous promettant de ne jamais commencer
un nouveau livre tant que le premier ne serait pas remboursé, mais peu à peu
tout cela s’est emballé ! Et à partir de 2000, les orientations se sont
diversifiées, beaux-arts, musique.»
LEXNEWS : « Le nom La Dogana peut surprendre pour une maison d'édition ?
»
Florian Rodari : «La Dogana signifie « douane» en italien. Comme un
employé des douanes qui ne fait pas que stopper la marchandise, un éditeur
est celui qui permet à un texte étranger d'être vu et partagé, de passer une
frontière. Après l’avoir réceptionné, nous l’examinons et nous lui délivrons
en quelque sorte un visa! Pour moi, un éditeur est essentiellement celui qui
permet à un texte d'être lu. C’est pourquoi nous accordons tant de soin à
l’aspect extérieur de nos ouvrages »
LEXNEWS : « La forme et la présentation sont essentielles dans votre
choix de faire connaître ces textes que vous évoquez, ce qui nous ramène à
votre propre parcours. »
Florian Rodari : « C'est en effet d’une importance capitale ! La
typographie, le papier, la gravure... J'ai toujours marqué une attention
très grande au dessin de la lettre, à la mise en page, aux marges ; mes
recherches dans le domaine de l’estampe m’ont beaucoup apporté. J'aime lire,
je peux dévorer en quelques jours des livres, même mal imprimés, mais je
crois que les textes des poètes ont besoin d’autre chose qu’un simple
contenant, ils ont besoin d’espace pour résonner, pour se déployer, surtout
de nos jours. Je me rappelle qu’un ami avait publié sa version des poèmes de
Leopardi, un des auteurs que je préfère, et que je lui avais reproché
d’avoir confié ces traductions à un éditeur qui n’accordait pas le moindre
soin à la respiration des textes ! Quelques années plus tard, j’ai réédité
ces poèmes sous une forme qui satisfaisait mon goût de la mise en page :
nouvelle édition qui pouvait paraître une opération aberrante sur le plan
commercial, mais qui, malgré tout, s’est avérée être un très beau succès...
».
LEXNEWS : « Le livre n'est pas qu'un
écrin, il fait corps avec le texte... »
Florian Rodari : « Absolument, je crois que l'on avance dans un livre
page par page, que les lettres accompagnent la pensée, formant peu à peu la
magie d’un volume. Le rapport du contenu et de la police de caractère censée
le déployer est primordial à mes yeux et il faut accepter de mettre en page
chaque livre différemment (...) |
(...)
Au tournant du siècle, nous avons décidé de renouveler un peu l’aventure.
Peteris Skrebers et moi-même, nous nous sommes dit : pourquoi ne
ferions-nous pas un livre d'art ? L’ouvrage consacré à « Quinche» (un
peintre suisse NDLR) est le fruit de ce pari et cela a très bien marché,
grâce à la générosité de l'artiste qui, en nous offrant des dessins, a
permis de financer cet ouvrage. La qualité de l’impression était telle que
l'on nous a demandé quelques années après de réaliser un nouvel ouvrage
consacré au peintre italien Gregorio Calvi di Bergolo, grand et beau livre à
l'image de ceux que je pouvais réaliser chez Skira, plus de 200 pages et 120
illustrations couleur. Par la suite, nous sommes allés plus loin encore.
Nous avons en effet décidé d’associer poésie et musique dans une série
d’ouvrages consacrés à l’art du lied, en donnant naissance à des livres qui
contiennent un CD enregistré irréprochable sur le plan technique. Nous avons
travaillé pendant près de six mois avec un graphiste afin d'éviter cette
insatisfaction souvent éprouvée devant ces emballages en plastique qui
renferment des textes mal traduits et illisibles. Deux livres d’un nouveau
genre, un Hugo Wolf et un Schumann, sont parus grâce à la participation de
la mezzo-soprano Angelika Kirchschlager. Cette expérience a créé des envies
chez d’autres chanteurs qui sont venus vers nous pour renouveler
l'expérience. Nous avons en projet un Mahler pour lequel Jean Starobinski a
écrit une étude. Nous voudrions multiplier ces approches à l'avenir... »
LEXNEWS : « Vous venez de faire
paraître de très belles éditions consacrées à des œuvres de peintre très
différentes l'une de l'autre…»
Florian Rodari : «Oui, d’un côté une aquarelliste, Anne-Marie
Jaccottet, et de l’autre un graveur au burin, Albert-Edgar Yersin, on ne
peut pas faire plus différent, en effet, même si ces deux artistes, nés en
Suisse, se sont bien connus. Yersin a suivi un parcours assez exceptionnel
dans la mesure où il a exercé la gravure toute sa vie, exclusive et, dans ce
domaine, la technique qui nécessite la plus grande patience, la plus grande
habileté de la main : le burin, presque abandonné aujourd’hui. C’est que cet
artiste aime la résistance du cuivre dans lequel il enfonce son burin. De
même lorsqu’il s’est mis à graver sur pierre, c’est la ductilité du matériau
qui l’a séduit. J'entendais récemment à la radio qu’on disait de lui qu’il
était surréaliste ; ce n'est absolument pas le cas. En conduisant sa pointe,
cet artiste se laisse certes guider par les propositions du hasard, mais
c’est pour retrouver une géographie intérieure. Il est plus proche de Dürer
ou de l’inextricable forêt allemande que des incertitudes du surréalisme. »
LEXNEWS : « On a en effet l'impression à le voir d'une vision
microscopique alternant avec une vision macroscopique. »
Florian Rodari : « C’est très juste, il est toujours en train de
jouer sur l'échelle des proportions, d’opposer les contraires, et en cela,
il est héraclitéen. Il reconnaît l'univers dans l’atome, et inversement,
l’animalcule, le lichen peuvent contenir à ses yeux l’infini stellaire. L’un
de ses textes préférés est L’Aleph de Borges, et il est beaucoup plus
proche, selon moi, d’un Michaux, à qui il dédie une planche, que d'un
Breton. À l'image de Victor Hugo, il aimait recréer à partir du spectacle
des choses vues et de leurs correspondances formelles d'autres possibles.
Grâce à ce don d’observation, Yersin a inventé en gravure des structures qui
n'existaient pas jusqu'alors. Dans les années 60 il a eu la chance de
collaborer avec Pietro Sarto, son élève, qui s’était aperçu que cette
manière de graver « appelait » en quelque sorte la couleur. Ils se sont mis
à tirer ses cuivres en couleurs et c'est à partir de cette époque tardive de
sa vie que les gravures de Yersin ont trouvé leur public.
La deuxième œuvre que nous révélons aujourd’hui, qui est en France aussi peu
connue que celle de Yersin, manifeste du même coup une sensibilité
diamétralement opposée. Contrairement à Yersin qui doit creuser son cuivre
avec une attention de tous les instants, Anne-Marie effleure à peine sa
feuille de papier pour que la lumière y tremble et que tout ce qu'elle aime
voir et qui l’entoure, les fruits, les fleurs, les arbres… soit perçu comme
subrepticement. A ce propos, les pages que Philippe Jaccottet consacre à sa
femme est d’une justesse extrême : il reconnaît à cette artiste qui
travaille depuis toujours à ses côtés, discrètement, une volonté qui a
permis, à force de retours opiniâtres à l’atelier, de capter ce moment qui
passe, si difficile à saisir, si fragile. Ce livre se veut un hommage à
cette peinture qui a été faite en silence à côté de son propre travail et
dans la même direction. Ni l'un ni l'autre n’a jamais cherché à affirmer
quoi que ce soit. Philippe Jaccottet dit dans un poème que l'effacement est
sa manière de resplendir, mais c'est exactement la même chose avec
Anne-Marie. »
LEXNEWS : «Il y a ainsi une convergence entre ces deux esprits créatifs.
»
Florian Rodari : « Oui, tout à fait. Ils ont d'ailleurs réalisé de
nombreux ouvrages ensemble, notamment un livre lumineux, contenant une prose
du poète sur le Cerisier dont les fruits se retrouvent fréquemment dans les
aquarelles d’Anne-Marie Jaccottet. Il y a dans les compositions de cette
dernière qui n’ont l’air de rien une lumière aussi intense que celle que
contiennent les poèmes de Jaccottet, même si chez lui toute méditation
repose sur un socle très sombre, très nocturne. »
LEXNEWS : « Comment entreprend-on de tels livres au XXIe siècle ? »
Florian Rodari : « Le plus dur, c'est de trouver les artisans qui
veulent bien encore vous suivre sur ce chemin. Il est, en effet, de plus en
plus difficile de dénicher des papiers de belle main et tout aussi difficile
de trouver un imprimeur qui prenne le temps de réfléchir à la qualité des
reproductions. Inévitablement, tout cela a un coût ! J'ai la chance de
travailler depuis 30 ans avec le même imprimeur, j'ai ainsi fidélisé des
rapports. De telles entreprises nécessitent énormément de temps et je ne
sais pas si les gens aiment encore ce genre de livres. Je crois tout de même
que la qualité dans ce domaine attire encore les amateurs. Moi-même,
j'éprouve un réel plaisir à faire de tels livres et j’espère que ce plaisir
transparaît d'une certaine manière dans le résultat final. Mon but serait de
faire éprouver ce même plaisir aux autres… »
LEXNEWS : « Vous défendez ainsi une vision d'esthète du livre en
considérant que cela n'est pas dépassé à notre époque. »
Florian Rodari : « Non, en effet, comme je vous le disais, je crois
qu'il y a encore des amateurs. Bien entendu, en terme commercial, nous ne
sommes pas dans la logique qui se développe actuellement. Les artistes dont
nous parlions tout à l'heure travaillent sur du papier, dans une distance et
une temporalité qui est celle du livre d’autrefois, non celle de
l’ordinateur. Mais pourquoi les textes qui les accompagnent devraient-ils
être sur un autre support et dans une autre dimension que ce qui a donné
satisfaction depuis des siècles ? C’est si pratique de tenir en mains un
volume de quelques centaines de grammes à peine ! Changer de support ne se
justifie pas vraiment. Je crois que nous sommes nombreux à croire à cette
réalité, et l'édition ne se porte pas si mal que cela. À la fin des années
90, lorsque Skira a mis la clé sous la porte, il disait : « Je m'en vais
avec le livre ! » Je trouvais cela un peu hâtif et prétentieux. Il est vrai
qu'aujourd'hui il n'est plus guère possible d’entreprendre ce que Skira
réalisait il y a cinquante ans, avec ses chantiers de photographies,
construisant tout exprès des échafaudages pour photographier les fresques de
Piero à Arezzo. Mais, si ce genre d’ouvrages n'est plus possible, il me
semble néanmoins qu’il restera toujours de la place pour des livres qui sont
en relation avec les besoins et les données de l’époque dans laquelle nous
vivons. »
Merci, Florian Rodari, pour ce témoignage
qui laisse une lueur d'espoir pour la beauté et l'excellence au début de ce
XXI° siècle. Grâce à des éditions comme la votre, le beau livre a encore de
longues années devant lui !
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
| |
 |
Éditions La Dogana
Distribution: Les Belles-Lettres
www.ladogana.ch
|
| |
Interview Diane de
SELLIERS, la passion de l'édition d'art...
|
|

© Giacomo Bretzel |
LEXNEWS : « Quelles sont les
origines des Editions Diane de Selliers qui portent votre nom ? »
Diane de SELLIERS :
« Le livre m’accompagne en fait depuis mon enfance dans la mesure ou j’ai
toujours aimé lire et que j’ai accompli des études littéraires. J’avais comme
objectif de travailler comme critique culturel et littéraire. J’avais réalisé un
mémoire sur un sujet d’édition. Belge de nationalité, je suis arrivé à Paris et
j’ai commencé à travailler dans une maison d’édition. Après cette expérience,
j’ai décidé de monter ma propre maison d’édition, afin d’éviter certaines
contraintes et grâce à l’insouciance de mes 25 ans !
J’ai commencé avec des guides qui n’avaient pas besoin d’un
nom d’éditeur. Ces éditions permettant de financer le reste de mes projets. A
l’origine je n’avais pas d’objectif de collection, cela l’est devenu par la
suite. J’avais découvert de superbes gravures mises en couleur par OUDRY au
XVIII siècle dans une librairie ancienne. En les consultant, je me suis dit
qu’il n’était pas possible que ces superbes gravures restent inconnues de tous
et mon sang d’éditeur n’a fait qu’un tour ! J’ai pris le risque de lancer
l’ouvrage avec l’intégralité des textes des Fables de La FONTAINE et des images.
Cet ouvrage est sorti en 1992 et nous en sommes aujourd’hui à la cinquième
édition. Par la suite, j’ai souhaité réaliser un autre livre consacré quant à lui
aux contes du même auteur. Mais je n’avais pas d’illustrations pour ces
derniers. C’est alors qu’à l’occasion d’une exposition au Musée du Petit Palais
consacrée à FRAGONARD et le dessin au XVIII° s, j’ai eu l’occasion de découvrir
dans la dernière salle, soixante lavis de FRAGONARD pour une édition manuscrite
des Contes de La FONTAINE. Il s’agissait de dessins qui n’étaient pas, et ne
sont plus, montrés au public. »
LEXNEWS : « Quelles sont les
difficultés pour traiter ces sources originales ? »
Diane de SELLIERS :
« Pour ce dernier livre, la réalisation a été très délicate en raison de la
difficulté d’obtenir ces lavis en photogravure dans de bonnes conditions. Nous
avons été obligés d’aller voir les originaux avec les techniciens de l’atelier de
photogravure grâce à la coopération essentielle du Musée. Si vous prenez les
lavis de FRAGONARD, la plus grande difficulté réside paradoxalement dans les
blancs ! Rendre les blancs vivants et restituer les nuances de blanc dans les
visages par exemple est une tâche particulièrement délicate. »
LEXNEWS : « Cela exige donc un
gros travail artistique en amont ? »
Diane de SELLIERS :
« Oui, tout à fait. Il y a énormément pour ces livres de réflexion pour
être le plus fidèle possible à ces œuvres, et en même temps pour ajouter un plus,
compte tenu des moyens techniques à notre disposition et de la modernité de
l’ouvrage ».

LEXNEWS : « Quel est le point
de départ de vos projets ? »
Diane de SELLIERS :
« J’ai toujours réalisé un livre dès que j’ai l’alliage de l’artiste et du
texte. Pour les Fables, c’est le hasard qui m’a mis en présence des textes et de
cette iconographie. Quant aux Contes, cela a résulté d’une démarche volontaire
jusqu’à ce que je trouve une illustration qui ait la même force narrative que le
texte. C’est grâce à un ami que j’ai eu l’idée du troisième livre. Il m’avait
parlé d’une Divine Comédie de DANTE illustrée par BOTTICELLI qui devait se
trouver en Italie. Après de longues recherches, j’ai pu travailler sur des
dessins de BOTTICELLI qui se trouvaient dispersés à Berlin et au Vatican. Pour
analyser ces œuvres de BOTTICELLI, j’ai pu bénéficier du concours du
conservateur du Musée de Berlin, grand spécialiste du peintre et qui était alors
à la retraite. C’est d’ailleurs de cette collaboration qu’est née l’idée du
Faust de GOETHE illustré par DELACROIX. Les 18 lithos de DELACROIX ne
suffisaient pas elles seules pour illustrer ce projet. Je suis donc partie à la
recherche de tous les travaux et dessins préparatoires de DELACROIX sur ce
Faust ! J’ai ainsi pu constater que le thème de Faust avait obsédé le peintre
pendant toute sa vie, ce qui m’a fourni un grand nombre d’études préparatoires.
La recherche de la qualité est ainsi au tout premier plan. »
LEXNEWS : « Il est même
possible d’ajouter, eu égard au résultat, qu’il s’agit d’un véritable travail
de recherche en tant que tel ! »
Diane de SELLIERS :
« Il est vrai que chaque livre exige un immense travail préparatoire
allant de 3 à 5 ans. Ce sont de véritables jeux de piste, qu’il faut à chaque
fois parvenir à remonter. La meilleure récompense de cette entreprise vient des
diverses institutions qui très souvent après un premier refus d’autorisation
quant à l’exploitation des sources reviennent sur leur décision dés qu’ils ont
pris connaissance de l’ampleur du travail accompli.
Mon éditeur italien m’a donné le thème de l’ouvrage
suivant, le Décameron de BOCCACE. Les miniatures n’étaient pas suffisantes pour
retenir l’attention du lecteur tout au long de l’ouvrage. Je souhaitais quelque
chose d’extrêmement vivant qui reflétait la Toscane à l’époque de BOCCACE. Nous
avons contourné le problème en prenant des détails de fresques qui montraient
des scènes de la vie de tous les jours. Ces fresques sont à elles seules un
véritable témoignage de la vie profane associée au thème mystique. Nous avons
pris tous ces détails dés qu’ils pouvaient être en rapport direct avec le texte.
Je pense que c’est le premier livre qui a offert un véritable travail de
création iconographique dans notre collection. La Légende Dorée de VORAGINE me
tentait depuis plusieurs années, mais la richesse iconographique me paralysait
jusqu’à ce que je réalise que les décorations d’Eglise me serviraient
directement pour cette illustration. La tâche a été immense : les photographes
se sont rendus dans de nombreuses églises en Italie pour y effectuer leurs prises,
avec au final des surprises sur le rendu de certaines fresques ! ».

LEXNEWS : « Quels sont pour
vous les rapports entre l’œuvre et l’iconographie, cette dernière venant
accompagner un texte qui renvoie lui même à ses propres images ?Cela fait il
naître des doutes chez vous quant à ces rapports ? »
Diane de SELLIERS :
« Je n’ai pas le sentiment de ressentir ces doutes quant aux relations
entre texte et image car ces relations sont à la base même de mon travail. Je
m’implique tellement dans ce souci d’harmonie entre l’iconographie et le texte
qu’il me semble que le résultat implique une symbiose. Si vous prenez l’exemple
de VORAGINE, rares sont les personnes qui lisent l’œuvre sans iconographie. Une
fois que les images accompagnent le texte de la Légende dorée, le texte reprend
toute sa saveur car les interprétations des peintres de ces fresques se
nourrissent à la spiritualité émanant du texte lui-même ! Votre question me
semble par contre plus concerner un livre comme celui du Don Quichotte de
CERVANTES. C’est en effet très différent car nous nous trouvons en présence d’un
artiste contemporain, Gérard Garouste, qui a sa propre interprétation de
l ‘œuvre. Il n’est pas un illustrateur mais bien un artiste. Il a tellement
plongé dans l’esprit du texte qu’il a fait une œuvre de créateur dans le cadre
d’une œuvre originale appartenant à CERVANTES. Cela lui offre des opportunités
de rebondir sur une phrase correspondant à une idée de sa lecture de l’œuvre !
Donc je ne pense pas que cela puisse en aucune façon réduire la liberté de
lecture, bien au contraire. Nous veillons à ce qu’il y ait un équilibre entre le
texte et l’image afin qui ni l’un ni l’autre ne prenne le dessus. Pour le
« Voyage en Italie » de STENDHAL, l’iconographie a été particulièrement
difficile à réunir en raison de la diversité des thèmes abordés. Nous avons
cherché à reproduire dans la mesure du possible l’univers de l’auteur tel qu’il
l’avait connu à son époque. Nous avons saisi sur ordinateur tous les mots de
personnes, de lieux, de scènes de genres,… Les recherches ont été faites dans
les plus grandes bibliothèques telles celles de Paris, Rome, Londres,… avec
comme cadre temporel une période très courte : 1800-1840. Nous avons ainsi
réalisé un travail très rigoureux sur le thème de l’Italie par rapport à nos
entrées informatisées. Cela a été un travail de titans ! ».
LEXNEWS : « Diane de SELLIERS,
merci pour toutes ces explications qui rendent plus passionnant le métier qui
est le votre, et dont nous présenterons régulièrement les nouveautés ! »
LEXNEWS A
LU POUR VOUS ...
OVIDE "Les Métamorphoses"
illustrées par la peinture baroque, 576 pages format 24.5 x 33 cm en volumes
reliés pleine toile sous coffret illustré, titres de couverture aux fers à
dorer, papier couché mat 170 g.

Ce ne sont pas moins de 360 peintures dont un grand nombre
inédites qui viennent mettre en lumière l'éternel récit d'Ovide, legs éternel de
la littérature antique latine ! A oeuvre d'exception, édition exceptionnelle,
tel est le cas de la présente sortie de l'ouvrage préparée sous la direction
éclairée de Diane de Selliers.
Une centaine de peintres italiens tels le CARAVAGE,
CARRACHE, CASTIGLIONE, ... mais aussi espagnols,français ou du Nord éclairent un
texte dont la poésie a inspiré de tous temps les artistes les plus divers. C'est
sous l'éclairage baroque que les Métamorphoses ont trouvé un regard nouveau
quant à la présentation édition, un choix judicieux au regard du texte dont les
vertus bucoliques et la force des thèmes évoqués se partagent avec passion et
ardeur. La Nature, les dieux et les hommes tissent entre eux des liens
inextricables que seuls des choix souvent violents viennent interrompre,
la superbe iconographie des Editions Diane de Selliers venant souligner ce trait
de caractère tel le plus cadre pour une peinture délicate. Point de double
langage ou de choix excessif, tout est mesure dans un univers qui portant porte
en soi les valeurs extrêmes des passions humaines. L'art baroque transgresse
souvent l'ordre établi par la sage Renaissance et pourtant cet éclairage
pictural se veut respectueux de la célèbre oeuvre latine !
Retrouvons dans une édition d'exception, nos racines
antiques en compagnie de Jupiter, Sémélé ou encore Bacchus, goûtons les joies
d'une mythologie accessible non seulement par la beauté du texte mais également
par la contemplation du regard sur des oeuvres tout autant immémoriales...
Un travail à la fois délicat et artistique pour lequel un
regard plus attentif révèlera une démarche digne des oeuvres scientifiques les
plus rigoureuses !
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
Pour plus de renseignements :
www.editionsdianedeselliers.com
|

|